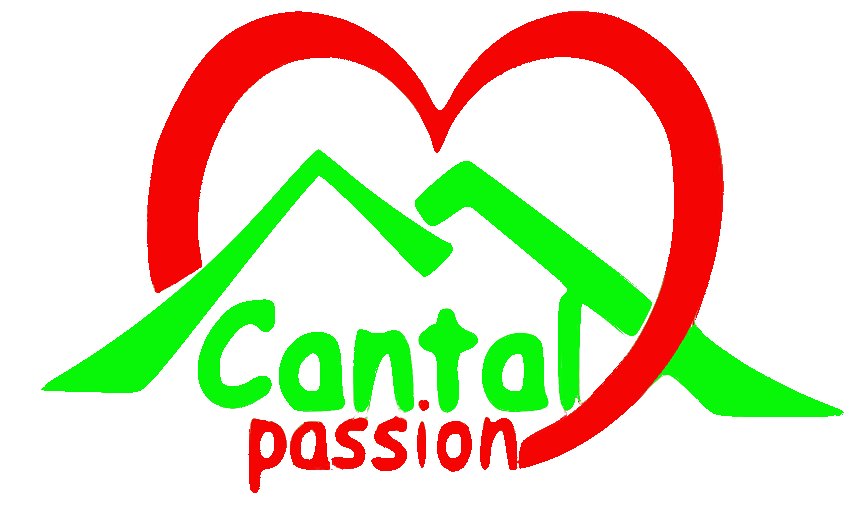VI. BAGARRE
Un soir de Mai, - nous avions alors déjà élu domicile dans les bois de la Fombelle -, Bernard arrive, accompagné de Marcel, son fidèle ami des premiers temps de la Résistance, et nous annonce la grande nouvelle : le lendemain matin, nous irons attendre les miliciens aux Estresses, sur la Nationale d'Aurillac à Maurs. Un des leurs, franc-garde du Puy-de-Dôme, ayant été tué, l'enterrement doit avoir lieu à Maurs. Le corbillard sera suivi d'un car transportant les figures les plus représentatives de la Milice d'Aurillac. Il s'agit d'attaquer le car. Joie parmi nous. Enfin le baroud ! Joie mêlée, d'ailleurs, d'un certain recueillement.
On a beau avoir accepté "tous" les risques, et avoir mené une vie pénible et dangereuse depuis plusieurs mois, il ne reste pas moins que le baptême du feu est une expérience angoissante. Qui peut dire comment il se comportera lorsqu'à ses oreilles siffleront les premières balles ? Dès huit heures le lendemain, une camionnette nous emmène par des chemins détournés; nous sommes une bonne douzaine, et nous avons emporté tout un échantillonnage de nos armes : mitraillettes, fusils, revolvers, grenades Mills, Gammons, incendiaires, et deux F.M.; sans oublier quelques bidons de pinard.
Arrivés sur la route, il nous faut choisir un emplacement convenable. C'est malheureusement notre première embuscade et nous n'avons aucune science en la matière; alors qu'à peine deux mois plus tard... dommage ! Nous nous en remettons à la technique de nos deux chefs qui ont été militaires et en qui nous voudrions avoir toute confiance. Nous nous plaçons enfin, échelonnés au-dessus de la route, sur une pente couverte de fougères, qu'assombrissent les premiers feuillages des châtaigniers. Nous nous planquons le mieux possible, nous abritant derrière un camouflage artificiel de fougères, nos ustensiles déballés et prêts à servir à nos côtés. Tout le monde est installé maintenant, les deux F.M. en position prennent une grande partie de la route en enfilade. Tout est redevenu tranquille. Couché sur le dos, fumant une cigarette, je contemple le paysage.
Au delà du ravin profond qui borde la route, en face, des pentes cultivées; un paysan crie après ses boeufs, un chien -aboie, des coqs chantent; le toit rouge d'une ferme égaie la note verte des bois. Tout est si calme, si calme... Un ciel assez lourd, comme si quelque menace était suspendue; pas de vent. Un cuir, une chemise à carreaux, un pantalon de golf... j'étais habillé ainsi lorsque j'allais camper. Cette ressemblance ne me déplaît pas : il y a chez le campeur et chez le maquisard ce même amour de la liberté... Le temps passe. Cigarettes... Aucune impatience, aucune fébrilité; j'ai demandé du feu tout à l'heure, à François, notre benjamin, dix-sept ans, oh ! sans aucune intention cachée; sa main ne tremblait pas lorsqu'il m'a tendu l'allumette. Un roulement de voiture ? Non, ce n'est pas cela. Les occupants ne se sont douté de rien, naturellement; c'est amusant ! Dix heures trente; un bruit de moteur : le corbillard. Au moins, ils sont exacts. Maintenant, nous sommes dans le bain. Le prochain ronflement, ce sera "eux". D'ailleurs, nous possédons toutes les précisions voulues : Joseph, le frère de Bernard, est parti en moto d'Aurillac après les miliciens, a doublé le convoi. nous a rejoints, renseignés sur l'heure approximative de leur passage et sur la couleur du car. Le voilà; il approche; un dernier virage; il apparaît, passe devant mes yeux, je distingue les silhouettes à l'intérieur, mais je suis un des derniers du côté amont, et je ne peux tirer avant d'avoir entendu le coup de sifflet. Ça y est ! Les rafales partent de tous côtés, les grenades explosent; le car ralentit; il essaie de repartir. Un incendiaire devant le capot, un nuage de fumée, il stoppe, mais assez loin. "Bébé" qui était encore à ma gauche, et moi, nous nous précipitons. Ils ripostent. Les balles sifflent. Un cri : "Couchez-vous".
Évidemment, on aurait pu y penser. Hélas tellement désagréable, ce sifflement des balles, ce "djiou" rapide et sec. Toutes les armes sont déchaînées. Rafales, explosions ont déchiré le silence et retentissent furieusement dans la vallée; l'écho intensifie encore le vacarme. Je rejoins Fernand. Il est beau, Fernand, debout sur un rocher, F.M. sous le bras, lâchant ses rafales sans guère viser, cheveux embroussaillés, l'oeil mauvais, écumant ! Cela dura plus de vingt minutes, jusqu'à ce que le dernier milicien ait cessé de riposter. Très courageux, d'ailleurs, les hommes de Darnand, il faut le reconnaître. Ils ont sorti, sous notre feu, leurs blessés du car et les ont portés à l'abri vers le ravin, et les hommes valides continuaient le combat. Sept des leurs ont été grièvement blessés, surtout par la première rafale de ' Bis_cotte", petit boulanger Bitterrois, qui, bien placé, a pris le car par le travers au moment où il passait devant lui. Pas de morts, pas de quoi être fiers; aucun n'aurait dû cri réchapper. Une grosse faute a été commise, et l'excuse d'un de nos F.M. enrayé n'est pas tellement valable : la route, du côté du ravin, n'était balayée par aucune de nos armes; précaution cependant élémentaire, que nous apprendra la première des leçons que nous recevrons en Juin; cela a permis aux miliciens de s'abriter vers la vallée. Le car reste seul sur la route, lamentable, vitres brisées, la chaudière du gazogène tire-bouchonnée; nous recueillons une mitraillette, un chargeur gravé au nom du propriétaire, Goutel, avec une croix gammée !... Quelques insignes, ces fameux gammas que "Biscotte" conservera précieusement. Il l'a bien mérité.
Nous revenons vers notre camionnette, mais le coeur très lourd. "Popo", le cousin de Pierre et Jean, a reçu une balle en plein ventre; nous n'avons que nos pansements individuels pour le soigner et il s'affaiblit. Quelques heures après, il s'éteint parmi nous. Un médecin appelé en toute hâte n'a rien pu tenter.
Chez nous, au maquis, lorsqu'un coup dur était décidé, il y avait toujours trop de volontaires, aussi avais-tu considéré comme un privilège de partir avec nous, pauvre Paul, vers ta destinée. Tu avais, toi aussi, consenti certain sacrifice. Tout de même, mourir ainsi, à pas même vingt ans... Tu étais si doux; dans notre milieu rude, où l'énervement constant rendait parfois difficiles les relations, tu n'étais jamais emporté, toi, tu étais toujours prêt à rendre service. Tu n'étais pas directement menacé lorsque tu as décidé de rejoindre tes cousins. Mais c'était une question de devoir, et simplement, sans grandes phrases, sans haine, semblait-il, tu es venu. Que les boches aient pu faire de toi, le Gadz'Arts d'Angers, de toi, avec ton âme de gosse souriant, un guerrier; que tu ais obscurément senti que tu devais, toi aussi, agir et combattre, c'est bien là la preuve de leurs crimes inexpiables, et aussi de ta noblesse, car tant d'autres ont accepté de subir cette oppression que tu n'as pu supporter. Oh ! je ne dirai pas que tu as été un héros. Les grands mots... et puis tu ne comprendrais pas. Tu as fait ton travail, simplement.
Son enterrement a été poignant. La mort même ne lui donnait pas le droit d'être inhumé dans un cimetière. Il restait un hors-la-loi. Et nous l'avons enterré dans nos bois. Un piquet d'honneur entourait le cercueil porté sur six épaules qui, après un très bref discours, fut descendu dans un trou hâtivement creusé. Une simple croix, et sur un couvercle de container qui y était appuyé : "Paul C., mort pour la France le..."