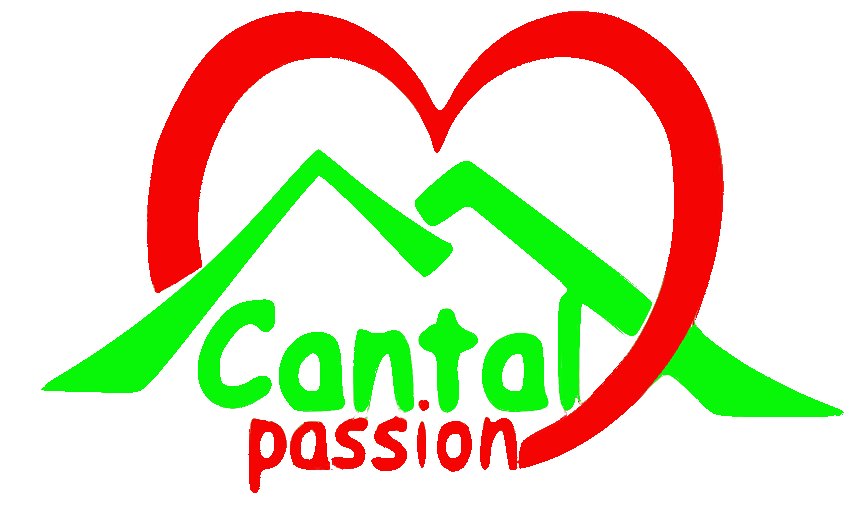IV. TENSION
Ainsi, au fil des jours, se succédaient nos espoirs et nos déceptions, nos joies et nos lassitudes, mais aussi cette tension nerveuse, assez déprimante et exténuante, qui nous rappelait que nous n'étions que des hors-la-loi, par les alertes incessantes auxquelles nous étions soumis. Il y avait toujours des paysans craintifs pour qui le promeneur insolite était un espion. Belloni, le traître du Lot, l'homme à la balafre, avait rôdé par chez nous dès Février, puis les boches, deux camions de Russes blancs en manœuvre. étaient allés un après-midi d'Avril jusqu'à Parlan. Visites dans les fermes : "Pas terroristes ici, Madame ?" A Sargalhiol, où nous habitions alors, nous avions planqué tout le matériel en deux heures dans les bois. Déménagement de romanichels, transport de sacs, de cellules de containers. Et puis nous avions attendu, sans affolement. Le soir, rien ne s'était passé. Nous avons célébré notre victoire théorique avec un demi litre de gnole. Et Valadou, le milicien de Roumégoux, à dix kilomètres, était parti à Vichy, et il ne devait pas être sans connaître notre activité. Et les G.M.R. à Latronquière, à huit kilomètres. Et l'affaire du cercle rouge : une carte de la région, dressée à la Kommandantur d'Aurillac, sur laquelle notre zone était entourée d'un trait rouge. Et le "mouchard", l'avion boche qui survolait "Chénier" les lendemains de parachutage, et qui passait régulièrement tous les matins juste au-dessus de nous en Juin.
L'invasion du Lot par les boches en mai, qui sont allés jusqu'à Sousceyrac, à cinq kilomètres des bois de la Fombelle où nous nous trouvions alors. Jamais une journée de répit, jamais la sensation d'être en parfaite sécurité, pas même le dimanche, lorsque nous allions chez les parents de René, bien compromis eux aussi, et chez qui l'atmosphère familiale retrouvée n'excluait pas la surveillance de la route à chaque bruit de moteur perçu le soir.
S'endormir chaque soir sans être tellement certain de se réveiller le lendemain matin, et cependant dormir d'un sommeil calme et même pesant... Ne jamais partir sans le revolver, lourd dans la poche: l'inquiétude pour les copains en mission qui reviennent en retard, les repas, avec une arme à côté de la main; les gardes de nuit, dans les bois, dans la neige, sous la pluie, le sentiment de porter sur soi la responsabilité du sommeil des autres. La nécessité d'être toujours aux aguets, car l'ennemi pouvait être n'importe où, dans ce bois d'où nous surgissions, le long de cette route que nous parcourions, mitraillette au côté. attentifs au moindre bruit, devinant derrière les fenêtres aux volets clos d'une ferme isolée ou d'un hameau une quiétude que peut-être troublaient nos pas insolites. Gardes dans la neige, qui rendait encore plus oppressant le silence de la nuit, qui rendait plus nets les milliers d'ombres menaçantes des bois, qui conservait précieuses, les traces de nos rondes. Et les chiens qui, certaines nuits, aboyaient sans répit, se répondant de ferme en ferme, comme si, de toutes parts, des présences insolites étaient signalées. Oh ! Que tout cela finisse ! Pouvoir dire enfin : c'est terminé, et je vis ! Dans la guerre ouverte, au moins, on sait à quoi s'en tenir, et lorsqu'on est au repos on est pratiquement à l'abri. Vous comprenez, vous, qui tous les soirs dans votre bureau bien clos, écoutiez Londres, vous comprenez que nous l'ayions attendu plus ardemment que vous, le jour "J" ?
D'ailleurs, dès les premiers jours, nous étions "dans le bain". Arrivés le 24 Janvier au maquis, nous apprenions le 1 Février que les gars auxquels il avait d'abord été question que nous nous joignions avaient été encerclés et attaqués par les boches à l'aube, à trente kilomètres de notre refuge. Cinq morts sur douze. Alors ont commencé les gardes de nuit. Les six premiers jours, nous avions vécu à peu près comme dans une A.J., nous occupant du ravitaillement; le réveil était brutal. Ma première garde de nuit, de six à huit, la sale heure, celle de l'attaque par surprise, où les silhouettes sont noyées encore dans la grisaille, où l'on approche facilement de l'objectif. Derrière la maison, un pré, puis les bois. Le brouillard, les branches qui s'égouttent et tombent sur les feuilles mortes avec le bruit d'une armée en marche; les yeux fatigués à force de fixer tout et rien, qui voient surgir des lueurs; des branches qui craquent... une bestiole quelconque. Un soir, à onze heures, un coup de feu nous réveille en sursaut. Nous nous précipitons. Michel était de garde; il avait vu une ombre s'avancer vers lui, avait fait les sommations usuelles, qui, restées sans réponse, avaient été suivies d'un coup de mitraillette. L'ombre avait fui. Battue dans les bois. Nous avons appris par la suite que cette ombre était un paysan ivre à qui le coup de feu avait rendu ses esprits, et qui avait détalé à toutes jambes. Heureusement, Michel était un fieffé maladroit.