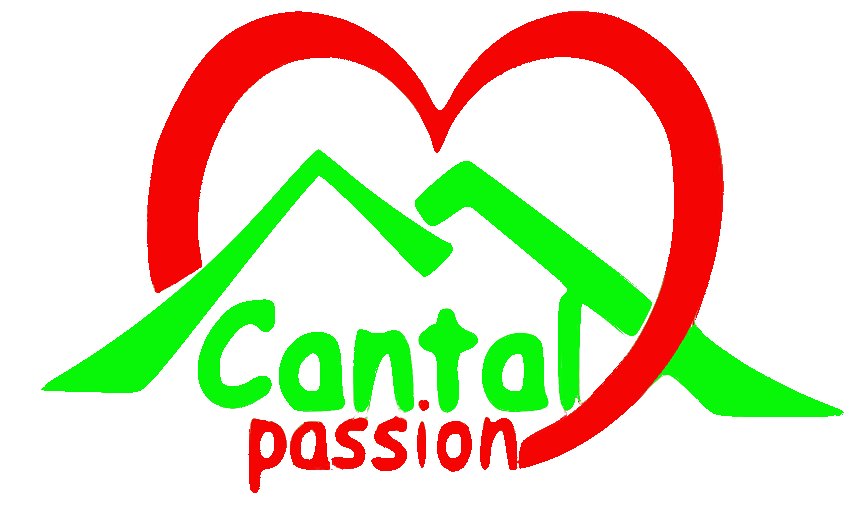Au cours de l'été 1944, les Allemands firent plusieurs fois irruption dans le petit village d'Albepierre. Dans l'hôtel Magnes ou ils passaient les vacances en compagnie de leurs grands parents, de Taticelle, de Tatimo et de Zabeth qui venait de naître, Jeannot et Babou étaient aussi présents. Babou avait six ans et demi et Jeannot quatre ans et demi. L'âge ou les souvenirs marquants de l'enfance ne s'effacent jamais. Ce récit* que fait Jeannot de cette période est romancé mais ne cède rien à la vérité. Il s'appuie sur ses propres souvenirs, sur ceux de son frère, de ses grands parents ,mainte fois interrogés et sur ceux de ses tantes. Particulièrement sur ceux de "Taticelle" qui avait trente ans à l'époque.
Le grand-père, Jean Magnes, se méfiait. Dans le village, tout comme son épouse, lui non plus n'avait pas que des amis… Certains lui reprochaient son engagement politique et se laissaient facilement tromper par la propagande nazie. Ici comme ailleurs le "communiste pas français" recevait un écho favorable à l'oreille de plus d'un.
Certains tiraient de menus profits de la situation et ne voyaient pas d'un bon œil les actions résistantes. Un nombre important de campagnards enfin, reprochait aux résistants d'être à l'origine des massacres d'innocents dans les actions de représailles perpétrées par l'armée allemande. Babou et Jeannot, à diverses occasions, s'étaient trouvés en présence des maquisards dans l'hôtel, et malgré l'attention portée par les adultes à ne point parler devant eux des choses de la guerre, des bribes de conversations arrivaient jusque à leurs oreilles. Ils savaient par exemple que leur mère y avait préparé de fausses cartes d'identité pour les résistants, que Taticelle, leur tante, les aidait à préparer des explosifs, à pétrir les pains de plastic qui serviraient à faire sauter les ponts, que grand-père était un chef du maquis... Les gosses savaient également que du matériel de guerre était entreposé dans de vieux tonneaux à double fond cachés au fond de la cave… Un jour, le grand-père avait jugé utile de prendre les gamins à part :
– Ecoutez-moi bien tous les deux : Ce que j'ai à vous dire est la chose la plus importante que je ne vous ai jamais dite.
Puis après un instant de silence :
– Vous savez que le pays est en guerre contre les " boches " ?
– Oui c'est pour ça qu'on est là, avait rétorqué Jeannot, un large sourire aux lèvres.
Le grand-père n'avait point répondu, sa figure avait pris des accents de gravité, ses lèvres fines s'étaient pincées, légèrement avancées, puis après un autre silence il avait ajouté en détachant bien les mots :
– Si un jour quelqu'un vous demande quoi que ce soit sur le maquis, vous m'entendez bien, quoi que ce soit …
Les deux enfants écoutaient, bouche ouverte. – Vous répondrez une seule chose, une seule : maquis connais pas. Je vous le répète : maquis connais pas. Vous répondrez ?
– Maquis connais pas avait gravement murmuré Babou.
Jeannot avait comme en écho répondu lui aussi : – Maquis connais pas.
Le grand-père s'était alors éclipsé, laissant les deux enfants à leur songerie muette. Ils étaient fiers de pénétrer dans le secret des adultes. Fiers de la confiance que venait de leur accorder grand-père. Le calme était revenu pour de bon autour de la table. Chacun penchait la tête sur son bol de soupe autour duquel les cuillers avaient engagé un discret va-et-vient. C'est grand-père qui mit fin à cette apparente tranquillité :
– Les nouvelles de Gustave sont bonnes ? fit-il, en relevant à peine le nez de sur son bol.
Malgré tous les efforts pour cacher son chagrin et son angoisse, Marcelle ne put empêcher une larme de rouler sur la joue. Elle l'essuya prestement du revers de la manche et répondit d'un ton neutre :
– Il va bien, à part que depuis qu'il est dans cette foutue usine d'aluminium il dit qu'il n'arrête pas de tousser et qu'il a toujours froid.
– Il a reçu notre dernier colis ?
– Oui ; il me demande de lui tricoter un gros pull et des chaussettes de laine ; pour le cas où il devrait passer un autre hiver là-bas et de lui envoyer aussi du tabac, car fumer est son seul plaisir. Il travaille entre dix et onze heures par jour dans la poussière.
– Les salauds ! avait murmuré grand-père en pinçant les lèvres. Les salauds...
Puis il avait ajouté : – Il ne passera pas un autre hiver dans le camp ; les " boches " seront cuits avant. Les Russes vont les écraser chez eux, et nous on va les foutre dehors du pays avant longtemps. Pour bien appuyer sa considération, le grand-père avait prononcé ces paroles en agitant légèrement son laguiole au niveau du visage. Un silence angoissant s'était à nouveau installé. Simone ne supportait pas ce genre de situation.
Elle se risqua à dire : – Quand même… je repense à cette baffe que Gustave a flanquée au gamin ! S'il avait gardé la main au fond de sa poche il serait bien tranquille aujourd'hui. Dans la ferme le travail n'était pas trop dur et il mangeait à sa faim, alors que dans ce camp disciplinaire… – Tais-toi, Simone ; Gustave a bien fait. Ce morveux qui l'a traité de sale " françouse " ne méritait que ça ; une bonne baffe. J'aurais fait pareil, et tout homme qui se respecte en aurait fait autant. – Arrêtez maintenant ; vous n'allez tout de même pas vous chamailler devant les gosses ? Ça suffit avec ces histoires. Si chacun y met son grain de sel on va tous tourner en bourrique, proféra grand-mère en haussant la voix. – A propos de sel, fais donc passer la boîte. Pour une fois t'as pas eu la main trop lourde… Quelques sourires contrariés accompagnèrent la blague du grand-père qui tentait de détendre un peu l'atmosphère, et la conversation s'engagea sur des considérations culinaires. Les pâtes fraîches, découpées en fines lanières avec des ciseaux dans de grandes galettes roulées avec des bouteilles à même la table farineuse étaient fameuses. C'était du moins l'avis des adultes. Ce n'était pas celui de Jeannot qui, gavé de crêpes, promenait les pâtes au fond de son assiette en pensant à ce Gustave qu'il ne connaissait pas mais dont il entendait prononcer le nom tous les jours. Gustave était prisonnier, et malgré les précisions données, Jeannot se l'imaginait tout maigre, menottes aux mains, assis sur un billot de bois dans un cachot tout noir. Il le supposait en compagnie de quelques rats faméliques qui venaient lui disputer les rares quignons de pain sec que ses geôliers, des allemands armés jusqu'aux dents, venaient jeter de temps en temps au pied de sa paillasse pouilleuse... Le calme, qui s'était à nouveau installé dans la cuisine de l'hôtel, devint brusquement étouffant. Au bout d'un certain temps, il fit place à un ronronnement lointain, qui se mit à gonfler au fil des secondes, comme un orage qui descend en grondant doucement de derrière les rochers de Chamalières. Le ciel était pourtant serein et ne laissait présager la moindre bourrasque… C'est Tatimo qui réagit la première. Elle se dressa d'un bond, tous les sens en éveil, se précipita sur le pas de la porte, puis rentra aussitôt en s'exclamant :
– Les " boches ", c'est un convoi de boches !
Dans un silence lourd d’émotion, les adultes blêmirent, échangeant entre eux un regard rempli de consternation. Sans mot dire, grand-père se leva prestement et se déroba par l'escalier de bois qui conduisait à l'étage, et depuis lequel on pouvait rejoindre l'extérieur, du coté de la remise. La grand-mère demanda aux deux enfants d'être bien sages quoi qu'il advienne. – Vous ne savez absolument rien sur la guerre ni sur les maquisards ; absolument rien. – Oui on sait, Papou nous l'a déjà dit murmura Babou. Simone fila avec sa petite Zabeth chez les Seccaud, et Marcelle débarrassa la table en vitesse. – On ne sait pas ce qui peut se passer, tu ne vois pas qu'ils débarquent chez nous… dit grand-mère, le visage inquiet. – Ne parle pas de malheur ! – Et ces foutus tonneaux, ils sont bien fermés ? Marcelle descend vite à la cave ; il ne faudrait pas qu’ils en aient laissé un ouvert… J'ai toujours pensé que c'était dangereux de cacher quelque chose ici dit la grand-mère, les nerfs à fleur de peau. Allez fais vite, je m'occupe de la table. Marcelle était déjà dans la cave, et un coup d'œil rapide lui permit de s'assurer que les tonneaux à double-fond dans lesquels étaient entreposés des munitions et l'argent qu’y cachaient les maquisards étaient bien fermés. Elle eut à peine le temps de refermer la trappe que déjà,dans un grondement assourdissant, soulevant derrière elle un épais nuage de poussière, les voitures allemandes faisaient irruption dans les rues du village, tandis que des officiers s'introduisaient sans ménagement dans la cuisine de l'hôtel. – Monsieur Magnes jean, nous voulons voir le chef ! L'officier s'exprimait en hachant les mots, mais il n'y avait aucun doute : c'était bien le grand-père qui l'intéressait. – C'est mon mari, il est parti aux champs, que lui voulez-vous ? La grand-mère s'était appliquée à prononcer ces mots d'un ton neutre et apaisant. Elle tentait de cacher le cruel émoi qui, subitement, venait de s'emparer d'elle. Après un court instant d'hésitation, l'officier allemand martela d'une voix saccadée dont la vigueur ne laissait aucun doute quant à la détermination de celui qui parlait : – Nous voulons interroger Monsieur Magnes. Puis il montra du doigt la pendule. – Si monsieur Magnes n'est pas rentré avant cinq heures nous fusillerons toute la famille ! Personne ne doit sortir d'ici sans mon autorisation ! Vous avez bien compris ? Au milieu du désarroi général, commença alors la fouille de la maison, puis, dans la salle du restaurant, l'interrogatoire de tous les membres présents de la famille. Son objet était clair, il s'agissait de mettre en évidence le rôle du grand-père dans la résistance et d'obtenir des renseignements sur l'activité du maquis dans la région. Un soldat allemand, débonnaire, prit Jeannot avec lui, sur le banc devant la porte et le fit gentiment sauter sur ses genoux. Il lui confia même sa mitraillette, puis au bout d'un moment se mit à le questionner. – Beaucoup maquis ici. Toi sais où est maquis ? L'enfant répondit par les mots convenus : – Maquis, connais pas ! Jeannot se mit à penser que ces Allemands n'étaient peut-être pas si méchants que voulait bien le dire son entourage. Il savourait le plaisir de jouer avec une mitraillette, se sentant dans une sécurité totale. Il se disait que ces soldats, qui lui prêtaient leurs armes, étaient bien plus gentils que les maquisards, avec lesquels il était impossible de toucher à quoi que ce soit… Mais ce n'est pas pour autant qu'il allait vendre la mèche. A chaque sollicitation du soldat il avait en mémoire la recommandation de son grand-père, et la même phrase revenait dans sa bouche : – Maquis connais pas !
En ce premier jour du mois de Juillet 1944, une chaleur estivale écrasait le petit village et les Allemands étaient particulièrement assoiffés …
Papou Papou
– Nous voulons boire beaucoup bière et limonade, avait demandé le chef.
La Grand-mère n'arrêtait pas de descendre et de remonter les escaliers de la cave, soucieuse de ne point contrarier ses hôtes, et avec l'arrière pensée de les faire boire dans le but de tromper leur vigilance. On ne sait jamais ... Aussi montait-elle beaucoup plus de bière que de limonade ce dont les allemands ne semblaient pas se plaindre.
La maison était étroitement surveillée par des sentinelles en armes, postées aux quatre coins de l'hôtel, et, sur la placette, juste à côté de l'église, Jeannot, depuis les genoux de l'allemand pouvait voir une automobile bizarre surmontée d’un gros fusil tout aussi bizarre. Celui-ci pointait sa bouche noire et menaçante vers l'hôtel, et le soldat qui la dirigeait, avec son gros casque sur la tête, semblait beaucoup moins sympathique que celui qui était occupé à le faire sauter sur les genoux.
Babou, contrairement à son jeune frère avait compris toute la gravité de la situation. Il finit par tromper l'attention des gardes, se glissa dans l'escalier par lequel s'était éclipsé grand-père et partit à sa recherche.
Il n'y avait personne derrière l'hôtel, si ce n'est un allemand qui, mitraillette sous le bras, allait et venait de façon régulière d'un bout à l'autre de la façade arrière.
Babou, dans l'entrebâillement de la porte, repéra son manège, et calcula qu'il aurait le temps, entre deux passages, de franchir l'espace qui le séparait de la porte de la remise.
Son idée était que le grand-père était caché dans ce local.
Lorsque le garde, lui tournant le dos, dépassa la porte derrière laquelle il était caché, Babou, évitant de toucher le moindre petit obstacle, s'élança précautionneusement. Son petit cœur faisait un tel vacarme au fond de sa poitrine qu'il eut peur que l'allemand ne l'entende battre. Il retenait son souffle, l'œil rivé sur les cailloux et les menus branchages qu'il s'appliquait à enjamber sans bruit.
Les quelques secondes qu'il mit pour arriver à la remise lui parurent des siècles, et c’est méthodiquement qu’il en explora les lieux.
La remise était un petit local dans lequel grand-père se plaisait à bricoler. Il y avait emménagé un établi qu'éclairait une fenêtre étroite. Babou prit soin de ne pas passer devant cette ouverture. De part et d'autre de l'établi, bien rangés sur des étagères, les outils attendaient sagement que l'on vint en disposer. Se côtoyaient rabots et varlopes de différentes tailles, des serre-joints en bois, des fers à souder aux becs cuivrés, des équerres, vraies et fausses, dont l'une, la sauterelle, captait particulièrement l'attention des enfants. Les scies aux lames curieuses, mais plus encore l'étau et l'enclume de forgeron, renvoyaient au soleil des tons moirés et chatoyants qui, à l'ordinaire, auraient exercé une véritable fascination sur le garçonnet.
Il ne leur accorda pourtant qu'un regard dédaigneux. De même, les vieilles boîtes de thé aux couleurs exquises et les diverses caissettes de bois pleines de richesses insoupçonnables lui parurent pour une fois indignes d'intérêt. Tout juste s'il jeta un coup d'oeil en leur direction.
Le fond de la pièce était mal éclairé et il s'y avança prudemment. C'était là qu'il pensait trouver le grand-père. Il devina les outils pour le jardinage, la fameuse carriole à bras que grand-père utilisait pour ramener l'herbe des lapins depuis la Pièce Longue, une vieille moto, utilisée par l'oncle Gustave avant qu'il ne parte pour la guerre, et se dirigea tout au fond à droite, derrière une palissade de planches.
Il se risqua à murmurer :
– Papou, Papou.
Aucune réponse. ..
Des gémissements venus d'un peu plus loin
Il entrouvrit avec précaution la porte qui donnait sur le jardinet, fit quelques pas, et ne fut même pas surpris de se trouver nez à nez avec le grand-père. Il était dissimulé près du jardin de la Sartresse, derrière un imposant massif de rosiers et tenait dans la main son colt de résistant, bien décidé à descendre le premier " boche " venu, au moindre signe de brutalité de leur part.
Grand-père fusilla Babou du regard et n'eut même pas le temps de lui dire quoi que ce soit.
Sans perdre un seul instant et usant du même stratagème qu'à l'aller, le gamin regagna l'hôtel et fit part, en cachette, de sa découverte à la grand-mère.
– Maintenant tu ne bouges pas d'ici. Tu m'as fait passer une de ces frousses…Et ne pipe mot à personne de ce que tu viens de me dire. Babou, tout fier de son exploit, trouva bien l'accueil un peu désagréable, mais il se le tint pour dit et, négligemment, s'approcha de son frère qui jouait toujours sur les genoux de l'allemand.
L'idée qu'elle devait absolument sauver les siens avait complètement transcendé la grand-mère. C'était une femme volontaire et audacieuse et dès l'instant qu'elle eut pris connaissance de la cachette de son mari, son plan fut adopté, et désormais rien ne pourrait l'en faire dévier.
Attablés dans la salle du restaurant, les allemands, toujours altérés, vidaient des casiers complets de bouteilles de bière que grand-mère leur apportait avec d'autant plus d'empressement, que l'épuisement du stock des boissons entreposées à la cave devenait une nécessité absolue pour la réussite de son plan.
A peine la dernière bouteille finie, elle proposa aux allemands de se rendre à la remise, derrière l'hôtel, pour en ramener quelques casiers supplémentaires.
L'officier mordit à l'hameçon :
– Bien sûr madame. C'est gentil, merci beaucoup.
Elle était persuadée qu'il lui serait maintenant facile de parler à son mari. Le salut de toute la famille était lié à cette rencontre, cela ne faisait aucun doute dans son esprit. Aussi, quel ne fut pas son désappointement lorsque l'officier se tourna vers deux soldats armés et leur ordonna de l'accompagner ! Il lui sembla un instant que tout s'écroulait, que sa vie, que la vie de toute sa famille, de tous ceux qu'elle aimait, s'arrêtait à ce moment précis. Elle vécut un véritable cauchemar. Des images épouvantables traversèrent son esprit égaré. Toute la famille était alignée devant le mur de la grange Jacomis, et l'officier allemand, juché sur une jeep s'apprêtait à donner l'ordre de faire feu à un peloton de soldats bien alignés. Elle était sur le point de perdre l'équilibre, de trébucher, faillit s'étaler par terre en sortant de l'hôtel, puis jeta un coup d'œil en direction de la grange. Ne faisant plus la différence entre la réalité et le cauchemar qui défilait dans sa tête, elle s'attendait au pire. Elle fut surprise de ne point voir toute la famille dos au mur, de ne point voir le peloton d'exécution. Seule l'automitrailleuse pointait son arme vers l'hôtel…Elle ne fut pourtant pas longue à retrouver ses esprits.
Elle avait lâché les pédales pendant un court instant, mais rien n'était encore perdu. Durant les quelques dizaines de mètres qui séparaient l'hôtel de la remise, aiguillonnée par l'obsession ardente de la délivrance des siens elle ruminait :
Il fallait absolument neutraliser ces deux allemands ; éviter à tout prix que ceux-ci pénètrent avec elle dans la remise et la suivent dans le jardin. Eviter surtout qu'ils découvrent le grand-père, décidé, elle n'en doutait pas, à vider le barillet de son arme sur le premier " boche " qui viendrait à sa rencontre.
Flanquée de ses deux gardiens, elle avançait lentement sur la petite montée qui conduisait à la remise, évaluant les risques de son entreprise et consciente du drame qu'entraînerait le moindre faux pas. Pourtant à cela elle ne voulait pas s'arrêter. Il lui fallait dominer sa terreur et trouver dans les quelques secondes à venir une issue à cet effrayant cauchemar. Mais que faire ? Que faire lorsqu'on a deux mitraillettes pointées dans les reins ?
Elle poussa la porte de la remise, toujours flanquée de ses deux gardiens auxquels s'était jointe la sentinelle de faction, épouvantée à l'idée qu'ils allaient certainement la suivre et peut-être ouvrir la petite porte à battants donnant sur le jardin, lorsque l'attention de ses surveillants fut attirée par des gémissements venus d'un peu plus loin.
Le curé Crueghe s'invite à l'interrogatoire
Les allemands s'éloignèrent de quelques pas, intrigués par ces vagissements suspects, et curieux d'en découvrir l'origine.
La grand-mère comprit sur-le-champ le parti qu'elle pouvait tirer de cette situation. C'était encore une femme alerte bien qu'elle fût un peu forte et déjà handicapée par un début d'arthrose de la hanche.
Elle s'élança vers le portillon situé au fond de la pièce, tout en faisant tinter sur son passage quelques bouteilles vides qu'elle bousculait du pied, poussa délicatement les deux battants de bois, et débusqua aussitôt le grand-père médusé, toujours accroupi derrière ses rosiers.
Les criaillements aigus couvraient presque la voix des " boches " dont on pouvait deviner les silhouettes austères derrière les massifs attenants au jardin.
– Tu enfiles une vieille veste, un vieux chapeau, tu prends un râteau et tu rentres le plus tôt possible par la route du cimetière ; et pas de bêtise, surtout pas de bêtise ! Si tu n'es pas là dans une heure, ils nous fusilleront tous !
Elle avait prononcé cette phrase du bout des lèvres mais toujours avec ce ton ferme et déterminé, qui laissait son interlocuteur sans voix.
Pourtant le grand-père, les yeux rivés vers le cerisier d'où s'échappaient les plaintes ne semblait pas l'écouter. Il tenait son arme braquée en direction des trois ombres, comme pétrifié par la peur. Ses mains tremblaient.
– Si dans une heure tu n'es pas rentré ils nous fusillent tous, tu as entendu ; ils nous fusillent tous !
Elle avait chuchoté ces paroles tout contre l'oreille de son mari et sans qu'il ait pu dire ou faire quoi que ce soit, lui avait lestement subtilisé le revolver.
Les allemands revenaient vers la remise en riant. La course contre la montre continuait. Se débarrassant du colt dans une fosse à purin qui jouxtait le jardinet, la grand-mère pressa le pas en essayant de ne pas faire de bruit, et c'est tout essoufflée, suant à grosses gouttes et transie de peur qu'elle revint à la remise pour se saisir à la hâte d'un casier de bière. Elle avait réussi. Elle éprouva un réel soulagement à revoir les trois " boches " qui venaient nonchalamment à sa rencontre. Ils étaient encore tout émus d'avoir surpris une petite chienne du voisinage occupée à mettre bas, sous un cerisier, à moins de vingt mètres de la cachette du grand-père.
Dans la salle du restaurant, les allemands buvaient de plus belle, mais l'officier qui s'était adressé à grand-mère en arrivant, regardait sa montre de plus en plus souvent et n'avait ostensiblement pas l'intention de laisser passer sans sévir l'heure fatidique.
Quatre coups s'étaient égrainés à l'horloge de l'église ; quatre coups interminables surtout pour la grand-mère qui n'arrêtait pas de nourrir de noires pensées.
– Cet homme quand même, il n'est pas encore là ! Mais que peut-il bien fiche ! Pourvu qu'il ne lui prenne pas la fantaisie de faire une autre bêtise. Avec lui on ne sait jamais ! Voilà plus d'une demi-heure que je lui ai parlé ; Il lui fallait cinq minutes pour s'habiller, moins de dix pour regagner le chemin du cimetière à travers champs et pas plus pour en revenir. Mais bon sang que fait-il donc !
La femme maugréait ainsi en se rongeant les sangs, lorsqu'un vieillard, accompagné d'un soldat allemand fit son apparition dans l'encadrement de la porte. Vêtu d'un vieux veston terreux, un méchant chapeau de paille sur la tête, un râteau sur l'épaule, le dos courbé par le poids d'une vie de labeur et d'une journée éreintante passée dans les champs, prêt à s'effondrer au moindre souffle, tel apparut grand-père, presque méconnaissable aux yeux des siens et surprenant aux yeux des officiers allemands qui entamèrent sur-le-champ son interrogatoire.
A peine celui-ci venait-il de commencer, qu'un autre soldat, de faction devant l'hôtel, fit irruption dans la salle du restaurant, accompagné par le curé Crueghe, en habit de messe.
Le curé Crueghe n'était pas à proprement parler un ami du grand-père. Celui-ci, athée, ne mettait les pieds à l'église que pour accompagner ses proches et les gens du village dans leurs dernières volontés, mais il respectait les opinions de chacun. Il n'était pas dans ses habitudes de dénigrer les gens d'église. Et pourtant..., alors qu'il était encore tout jeune, son oncle était entré en conflit avec le curé du village de l'époque. Cet oncle, très entreprenant et peut-être aussi un brin provocateur, n'avait-il pas installé à plusieurs reprises, le dimanche matin, sur la place de l'église, une sorte de boulier de sa fabrication, et n'avait-il pas eu l'audace de proposer aux fidèles du village de risquer quelques pièces de monnaie en échange d'un gain tout à fait hypothétique ?
Il paraît que les dons à Dieu tarissaient de façon redoutable au profit de la bourse de l'oncle et que les fidèles étaient plus nombreux à risquer leur mise sur la place du village qu'à écouter les sermons de leur prêtre. L'évêché de Saint-flour en avait été informé, aurait pris ombrage de cette industrie et le prêtre aurait alors menacé le trublion d'en appeler aux gendarmes de Murat s'il continuait son petit jeu. Curieusement c'est à cette anecdote que le grand-père se mit à penser en voyant le curé entrer pour la première fois dans la salle du restaurant de l'hôtel.
Jean Magnes fut stupéfait et quelque peu inquiet de le voir saluer les officiers allemands.
Foutue guerre de Merc...credi !
Le prêtre, raide dans sa robe noire, le visage soucieux et blême, demanda à être entendu par le chef.
Pendant un temps qui parut interminable à toute la famille regroupée sous bonne surveillance dans la cuisine, la discussion s'engagea dans la salle du restaurant. Les bribes de conversations qui venaient de cette pièce faisaient naître une lueur d'espoir à la famille réunie. Si l'irruption inattendue du curé avait, dans un premier temps, suscité quelques craintes, celles-ci se dissipaient à présent peu à peu. Il devenait clair maintenant que l'ecclésiastique faisait de son mieux pour disculper le grand-père.
– Nous savons monsieur Magnes résistant et communiste, avait articulé lentement l'officier.
– Non, non, je vous assure, vous faites erreur. Jean Magnes est un retraité paisible. C'est un être usé, incapable d'aider en quoi que ce soit le maquis. C'est un vieillard. Il a tout juste la force de travailler dans son jardin pour nourrir les siens. Je vous certifie que cet homme n'à rien à voir ni de près ni de loin avec un quelconque réseau de résistance. Quant à ses opinions politiques, je suis tout aussi catégorique. Monsieur Magnes n'est pas communiste. Il n'y a pas un seul communiste dans le village. Vous pensez bien que j'en serais informé…
La discussion se poursuivit un long moment encore, et le chef allemand, un pasteur, échangea quelques phrases en langue latine avec le prêtre français. Les allemands discutèrent entre eux un court instant et au grand soulagement de tous, quittèrent la maison. Ils rassemblèrent leur petite troupe et reprirent la route de Murat.
Après leur départ, au milieu des larmes, des rires et des embrassades mêlés, la grand-mère, qui avait déjà pris le balai pour effacer toute trace du cauchemar, avisa une enveloppe que les allemands avaient laissée sous une chaise avant de partir. Elle s'empressa de l'ouvrir. Pour une surprise, ce fut une surprise !
L'enveloppe que l'officier allemand avait,– comment douter que c’était intentionnel –, laissé choir délibérément sous la table du restaurant avant son départ, contenait une lettre manuscrite.
Avec fébrilité la grand-mère commença la lecture, d'abord pour elle seule.
– Le salaud ! disait-elle, la figure rouge de colère. Le salaud ! c'est pas permis de faire des choses pareilles. Un réfugié, nous faire ça à nous ! Ah, il aurait dû y crever à Marseille ! Et dire que je lui ai donné à boire sans le faire payer ! Quel salaud ! J'aurais dû me méfier !
Son mari, blême comme un mort, lui prit la lettre des mains et commença la lecture à voix basse.
Son regard se porta d'abord au bas de la page et se posa un long moment sur le nom et la signature du délateur. Pas un mot ne sortit de ses lèvres pincées. Ses yeux se promenèrent sur la feuille. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises pour lire l'accusation tant son émotion était grande. Son regard était chaque fois attiré par le bas de la page, comme s'il était persuadé ne pas avoir correctement lu le nom et la signature du dénonciateur. Au bout d'un moment, il replia la feuille et la mit dans la poche de son veston. Puis il la ressortit pour bien s'assurer une dernière fois qu'il ne s'était point trompé.
– Ecoutez-moi bien, vous tous. Pas un mot de cette lettre à qui que ce soit. C'est une affaire trop grave pour qu'elle soit réglée à la légère.
– Que comptes-tu faire maintenant ? demanda sa femme, encore sous le choc et quelque peu inquiète. Pas de bêtise au moins ?
– C'est mon affaire. C'est mon affaire et celle des gars qui sont là-haut. On n'en parle plus pour l'instant, ça se réglera comme il se doit ; je vous le répète, c'est une affaire d'hommes.
– Ces salauds de la cinquième colonne… rumina-t-il sans desserrer les dents, de sorte que personne ne comprit ce qu'il venait de dire.
Jean Magnes s'éclipsa une nouvelle fois par l'escalier, fit quelques enjambées en direction de la forêt, puis revint sur ses pas repêcher son revolver dans la fosse à purin. Il passa un long moment devant le banc de menuisier à le démonter, à le nettoyer et à le graisser.
Probablement sermonnés par leurs supérieurs pour n'avoir fusillé ni ramené aucun otage du village, en fin de soirée, les allemands remontèrent une nouvelle fois à Albepierre. Ils n'inquiétèrent point la famille Magnes mais rassemblèrent tous les jeunes du village et en embarquèrent cinq qui, n'ayant pas répondu au service du travail obligatoire, se firent pincer bêtement et furent embarqués par les soldats. La grand-mère, s’avançant vers le camion militaire qui démarrait, tendit un paquet de cigarettes aux malheureux, qui disparurent, noyés dans la poussière, vers une destination inconnue. Les " arapirous ", consternés, l’apprirent bien plus tard, ils avaient été déportés, comme des milliers d’autres innocents vers des camps en Allemagne. Trois n’eurent jamais le bonheur de revoir leur beau village natal.
Le soir venu, on coucha les enfants de bonne heure et sans cérémonie. Marie Louise et ses deux filles s'installèrent dans la cuisine. La mère s'affaira devant la cuisinière et essaya de s'occuper pour ne pas penser. Elle vida les cendres dans une petite lessiveuse de zinc. Elle s'en servirait plus tard pour blanchir le linge. Puis elle récura le four avec de la cendre et du papier journal
– " Bouddie ! " qu'il est sale, mais qu'il est sale ! " se répétait-elle pour se donner de l'ardeur.
Puis, de toute son énergie, elle se mit à frotter le dessus en fonte de la cuisinière. Quand il devint aussi étincelant qu'un miroir elle prit un balai et pourchassa la poussière aux quatre coins de la pièce.
Marcelle, les yeux fixés sur son ouvrage, tricotait un chandail en pensant à Gustave et à la tristesse qu'il aurait éprouvée si par bonheur libéré d'Allemagne, de retour au pays, il avait trouvé la maison vide et en cendres… Cette pensée l'excitait tellement qu'il lui arrivait fréquemment de redéfaire une partie de son travail. Ses doigts agiles faisaient virevolter et cliqueter les fines aiguilles d'acier, et la laine, nouée en maints endroits– parce que récupérée sur des vêtements hors d'usage –, se déroulait de la pelote qui pirouettait de façon saccadée sur son tablier bleu. Marcelle essayait bien de chasser ces images de sa tête, mais pour penser à quoi ? D'autres obsessions, tout aussi sombres faisaient leur apparition. Où était parti son père ? Elle le savait bouillant et déterminé sous son apparence placide. N'allait-il pas faire une grosse bêtise ? Elle sortit de ce labyrinthe ténébreux en se raccrochant à un rayon de lumière. Son père n'avait-il pas affirmé, juste avant l'arrivée des " boches " qu'ils allaient perdre la guerre ? Si seulement il avait dit la vérité… Si la guerre pouvait s'arrêter bientôt, et si tout pouvait redevenir comme avant… Marcelle était mariée depuis près de cinq ans, et à vingt huit ans il lui semblait que sa vie s'était arrêtée. Chaque fois que cette pensée, récurrente, venait la torturer elle se disait : ce n'est pas possible, c'est un mauvais cauchemar, tout va revenir comme avant, Gustave et elle heureux. Ils auraient un enfant… et devant elle s'esquissait une éternité de bonheur mérité et parfait… Oui, tout était encore possible.
– Foutue guerre de mer…credi ! se surprit-elle à murmurer. Elle qui ne disait jamais la moindre
grossièreté ! Cela la dérida intérieurement et elle continua son tricotage, en comptant les mailles à voix basse, pour ne pas se tromper.
Simone, elle, pour passer le temps, avait entrepris de se faire les ongles. Lorsqu'elle ne pouponnait pas, c'était son passe temps favori et elle y mettait une telle application que quand bien même la terre aurait tremblé sous ses pieds, elle ne s'en serait probablement pas rendue compte. Elle avait un caractère jovial et ne retenait que le bon côté des choses. Cela l'aidait à vivre plus facilement l’éloignement de Maurice. Elle ne laissait aucune place au doute. Tout cela finirait bien par s'arranger tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. En attendant, à quoi bon se ronger les sangs ?
Le temps avait passé, et de plus en plus fréquemment les femmes jetaient un regard inquiet vers la pendule qui avait, depuis un certain temps déjà, égrainé les douze coups de minuit.
Marie-louise (la grand-mère se prénommait ainsi), avait fini de nettoyer et de ranger les placards et les tiroirs du vaisselier de la cuisine. Elle commençait à tourner en rond autour de la table. Des idées noires défilaient devant elle, et il lui semblait qu’un écureuil malicieux lui picotait l’intérieur du crâne. Elle rompit soudain la sérénité apparente du léger cliquetis des aiguilles, et des murmures railleurs de la lime à ongles.
– Mais qu'est ce qu'il fiche donc à une heure pareille ! Je vous le demande ; qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer à cette heure de la nuit ? Les aiguilles et la lime à ongle chuchotèrent un peu moins fort et grand-mère enchaîna :
– Ah mes filles, voyez où ça nous a conduit la
politique ! La politique ! Elle appuyait de la voix sur chaque syllabe et ses yeux, sombres de nature, s'obscurcissaient un peu plus, jusqu'à en devenir inquiétants. Certes on peut avoir ses idées, mais la politique ! Jamais, vous m'entendez toutes les deux, ne vous lancez jamais dans la politique !
Marcelle et Simone se levèrent en même temps.
Elles venaient d'entendre, malgré la tempête verbale soulevée par leur mère, comme un bruit de pierre sur les volets de la façade...
Le retour des boches
Des deux sœurs, Simone était la moins froussarde, aussi se risqua-t-elle à entrouvrir la porte pour interroger la nuit. Une autre pierre vint heurter la maison et elle eut juste le temps de la voir rouler au sol avant de refermer la porte qu'elle barricada à double tour.
– Vérifiez toutes les ouvertures, et assurez-vous que tout est bien cloué ! ordonna la mère à ses deux filles. Et ne faites pas d'imprudence. Ces gens-là c'est encore plus foutu que les fritz… Au moins avec les " boches " on sait à quoi s'en tenir. Ils ne se cachent pas pour vous faire
du tort !
Les trois femmes veillèrent encore un peu, attentives au moindre souffle, au moindre bruit. Le cœur de Marcelle bondissait dans sa poitrine et elle finissait par n'entendre que lui. Au sentiment d'anxiété s'était ajoutée la sensation de peur incontrôlée. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie lorsque les allemands avaient menacé d'exécuter toute la famille. C'était étrange…
Une esquisse de clarté se faufila modestement au travers des lames disjointes d'un volet. Jean Magnes n'était toujours pas de retour. Puis un grillon se mit à chantonner sur un ton monocorde, quelque part, dans le haut de la cheminée. Peu après, le coq des Jacomis s'éclaircit la voix. L'aurore était au rendez-vous, mais grand-père, lui, n'avait toujours pas regagné le logis.
– Bien, toutes les deux vous allez monter vous coucher maintenant. Le jour est là et dans peu de temps les premiers curieux viendront réclamer leur canon de blanc et s'enquérir de ce qui s'est passé ici. Inutile de leur offrir le spectacle de vos mines de papier mâché. Pour le reste advienne que pourra ; j'espère qu'il ne s'est rien passé de grave, et de toutes façons on le saura bien assez tôt. Allez ! je vous réveillerai pour le repas de midi ; ce sera bientôt l'heure.
Jeannot ignora longtemps un autre épisode de l'après-midi cauchemardesque vécue par la famille. Il lui fut révélé bien plus tard par Taticelle.
L'ordre leur avait été intimé, à elle et à sa mère, de conduire deux allemands vers le champ où était sensé se trouver grand-père. Parties, l'une par la route du cimetière et l'autre par le chemin du château, chacune flanquée d'un sbire portant fusil, elles avaient dirigé leurs pas vers le champ des pommiers. Elles n'en menaient pas large avec une baïonnette pointée dans les reins !
Le hasard voulu qu'elles se rencontrent, et tout en prenant le chemin qui conduit à la forêt, grand-mère obtint de ses gardiens qu'ils laissent partir sa fille. Le surveillant de Taticelle fit signe à cette dernière qu'elle pouvait filer, et rejoignit son compatriote.
Taticelle ne moisit pas sur place : elle prit ses jambes à son cou et, évitant le village, dévala la pente vers Auzolle où elle entra demander asile dans la première maison venue, la maison Ressouche, où on lui donna de quoi changer ses vêtements.
Elle resta là un bon moment à se ronger les sangs, puis, avant la nuit, n'y tenant plus, décida de s'aventurer jusqu'au village pour voir ce qu'il en était.
Elle avait troqué son chemisier à fleurs et sa jupe noire contre des habits de paysanne, plus discrets, afin qu'on ne la reconnaisse pas. Après les avoir cachés dans un fourré, munie d'une " cuivrine " de lait pour donner le change elle arriva à la maison...
Jean Magnes, installé devant son établi était en train de nettoyer et de graisser le revolver qu’il avait repêché dans la fosse, lorsque les allemands étaient revenus au village.
Il avait aussitôt planqué son arme, et, s’attendant à être de nouveau inquiété, s’était rendu dans la cuisine en compagnie de la famille réunie. Il ne fut donc pas surpris de voir apparaître l’officier qui l’avait interrogé quelque temps auparavant, mais par contre resta abasourdi par les propos du pasteur :
– Rassurez-vous. Ce n’est pas pour vous que nous revenons.
Et il ajouta :
– Je n’ai jamais tué quelqu’un et ne voudrais jamais avoir à le faire.
A peine les allemands eurent-ils disparu que Jean Magnes, à grandes enjambées et avec détermination, quittait le village.
L'intrusion des allemands avait mis les " arapirous " dans un état de choc profond.
Chacun avait pu voir monter les cinq jeunes dans un camion, mais on voulait croire qu'il s'agissait uniquement d'un contrôle de routine.
Chacun savait également que l'hôtel avait été investi, mais tous ignoraient encore ce qui s’y était passé exactement. Ils auraient bien voulu savoir mais personne n'avait osé interroger Jean qui passait devant les gens sans les voir, tant son esprit était préoccupé. Les paysans, par petits groupes, tentaient de se rassurer, et les commentaires allaient bon train.
Le jugement
Ah ! les oreilles ont dû lui siffler à Jean Magnes en cette fin d'après midi...
Rares étaient ceux qui lui voulaient du mal à lui particulièrement, loin de là. Les gens pensaient tout simplement qu'il était dommage qu'un brave homme comme lui fût communiste car pour une majorité, les "rouges" étaient cause de leurs malheurs... Ils leur reprochaient d'embrigader les jeunes et de provoquer la colère et les représailles des allemands. Certains pourtant murmurèrent haineusement du bout des lèvres que si la famille Magnes avait été ainsi épargnée c'était qu'elle avait "donné" les malheureux jeunes villageois aux allemands !
Jean Magnes, un dénonciateur couvert par monsieur le Curé ? La rumeur s'éteignit avant de se propager …
C'est justement à la dénonciation que pensait jean Magnes au pied de la cascade du " Prapessou ", en laissant derrière lui les dernières maisons du village. Il en avait gros sur le cœur d'avoir été lâchement dénoncé. Mais son trouble aurait été encore bien plus grand si le délateur avait été quelqu'un du village. Ce type était un réfugié, à peine arrivé de Marseille depuis quelques mois. Et de plus un client fidèle du bistrot !
– C'est quelqu'un quand même… ruminait-il en s'engageant sur le sentier qui menait à la Montagnoune. Il se mit à marmonner à voix basse : " Je ne le connaissais pour ainsi dire pas ce salaud ; Il venait au moins deux fois par jour boire un coup, mais de lui je ne sais rien. Quand même, c'est quelqu'un…J'aurais dû me méfier. "
Il avait tant de fois parcouru ce sentier qu'il aurait été capable de le suivre les yeux fermés. D'ordinaire, il lui fallait cinquante minutes pour gagner le buron de la petite Montagnoune, mais ce soir, sans qu'il s'en rendît compte, ses pas s'étaient allongés plus que d'ordinaire et quelle ne fut pas sa stupeur d'entendre, à moins de dix pas de lui, venue d'une rochasse dominant la vallée, une voix l'interpeller :
– Salut Jean, alors, pas de casse ?
Jean s'arrêta, cloué sur place, tout penaud de s'être fait surprendre comme un bleu par la sentinelle qui veillait sur la sécurité du groupe de maquisards. Il perça du regard les abords du rocher, mais en vain. Tout à coup, à moins de cinq pas de lui, le guetteur descendu de sa cachette, lui apparut, une mitraillette en bandoulière.
– Alors, les nouvelles ?
– Salut Marcel. Les nouvelles…les nouvelles…Il faut que je parle à Louis ; il faut que je vous parle.
– Bien ; les boches sont partis sans faire de casse ?
– Bonsoir ! mais vous êtes déjà au courant ? Ils ont amené cinq gars. Jean Rousset, Charles Lhéritier…et trois autres…
– Allez viens, je sens qu'on a des choses à se dire…
Ils se dirigèrent sans une autre parole vers une vieille bâtisse recouverte d'épaisses et larges lauzes, et après s'être manifestés au moyen du signal convenu, rejoignirent leurs camarades de combat. En tout ils étaient huit : pour la plupart des jeunes de moins de vingt cinq ans qui, pour la plupart " réfractaires ", avaient refusé le " travail obligatoire " et avaient rejoint le maquis. L'un d'eux paraissait un véritable gamin. Il avait dix sept, dix huit ans tout au plus.
Louis, le chef, était un petit homme trapu à l'œil vif et pétillant de curiosité. Il portait une courte barbe vaguement taillée en pointe sur laquelle il passait machinalement les doigts. Il entra d'emblée dans le vif du sujet :
– Nous savons qu’ils sont montés à Albepierre par deux fois. La première fois ils nous ont brûlé le petit car, et nous les avons légèrement accrochés avant de nous replier. Mais au village, que s’est-il passé ?
– Tenez, c'est pour vous donner du courage, dit Jean en sortant de sa musette deux bouteilles de vin bouché. Au moins ces deux-là ils ne les auront pas sirotées, les salauds...
– Alors raconte nous. Qu’ont-ils fait au juste ? demanda Louis. Ce qui me tracasse le plus c'est qu'ils soient revenus. Qu'est-ce qu'ils sont donc retournés foutre ?
Jean attendit un instant, rassembla ses idées, parla des cinq malheureux qu’ils avaient embarqués, et finit par sortir de la poche de sa veste le papier dénonciateur. Il le déplia, le défroissa et le posa sur la table face à Louis.
– Lisez ça, vous comprendrez tout de suite ce qu’ils sont venus faire la première fois. Ce sera mieux qu'un discours…
Louis prit bien le temps d'examiner le papier, puis d'une voix monocorde le lut à ses compagnons.
– Et il a pris la peine de signer ce fumier ! En plus d'être un salaud c'est un vrai con ! fit-il en frappant du poing sur la table.
Le billet passa dans toutes les mains, pendant que Jean Magnes répondait avec le plus de précision possible aux questions de ses camarades.
– Vous lui devez une fière chandelle au "cureton" osa le gars au béret de drap noir. Tu pourras t'en souvenir aux prochaines Pâques !
– L'heure n'est pas à la plaisanterie, coupa Louis. Il faut prendre une décision au sujet du fumier !
– C'est tout vu, s'exclama l'un deux. Il a signé son arrêt de mort !
– Il ne vaut même pas les balles pour le fusiller ajouta un autre, il faudrait le pendre !
– Il faudrait pouvoir le juger, risqua Jean Magnes, après avoir avalé sa salive dans un lent mouvement de glotte.
– Les juges c'est nous, fit remarquer Louis et nous n'allons pas perdre de temps ni nous appesantir plus longtemps sur le sort de ce saligaud. Qui est pour son exécution ? Toi Jean, tu ne votes pas. On ne peut être à la fois juge et partie.
Tous les bras se levèrent à l'unisson dans un silence ému.
– Très bien, Jean-René et Marcel, dès demain, vous vous chargerez du boulot ; vous avez carte blanche mais attention, pas d'esclandre ! Ce salaud a peut-être plus d'amis qu'on le pense dans le village ; c'est inutile d'aller mettre de l'huile sur le feu …
Les adultes avaient peur
On n'évoqua que rarement la venue des allemands dans la famille Magnes et jamais en public. Chaque fois que la conversation menaçait de rappeler cette funeste journée, grand-mère s'écriait :
– Arrêtez, j'en suis encore toute chamboulée…
On fit comme si rien ne s'était passé ; on pensa en silence aux malheureux que les allemands avaient embarqués vers une destination inconnue et on continua à vivre, heureux malgré tout d'avoir été épargnés et d'être encore vivants sur cette bonne terre.
Les maquisards descendaient de plus en plus souvent au village et s'attablaient dans la salle du restaurant. Ils disaient que la fin de la guerre approchait, que les " boches " étaient foutus mais que dans leur retraite ils se faisaient de plus en plus cruels. Ils déportaient, ils bombardaient, ils fusillaient, ils brûlaient…
Le surlendemain de l'arrivée des allemands à Albepierre, Robert et Jeanne avaient rejoint la famille et cela n'avait pas été facile pour eux. Les maquis faisaient sauter les ponts et les voies ferrées. Ils obstruaient les routes pour retarder l'avance des troupes ennemies qui se dirigeaient vers la Normandie… Après s'être rendu à Saint Jacques des blats, le couple avait alors continué leur périple à travers la montagne qu’ils avaient traversée à pieds deux valises à la main !
Ils se trouvaient en compagnie de Taticelle à la maison du bas, et un matin, quelle ne fut pas leur stupefaction : peut-être plus d’un millier d'allemands avaient installé leur campement dans les prés autour des maisons. La pièce Longue était noire de militaires qui s'affairaient autour des popotes.
Les informations sur les massacres d’Oradour sur Glanes et sur ceux de Tulle étaient parvenues jusque là…Et puis, moins d'un mois plus tôt, le 12 juin, à Murat, il y avait eu la fusillade qui avait coûté la vie au capitaine SS Geissler et, en guise de représaille, le départ en déportation de plus de 140 muratais ! On savait que les SS pendaient, brûlaient fusillaient ....
Les adultes avaient peur. Peur qu'un nouveau massacre soit perpétré dans le village…
De nombreuses armes étaient cachées dans l’hôtel Magnes, et des sommes importantes d'argent, destinées à venir en aide aux femmes de résistants y étaient également déposées. Cet argent transitait par l'hôtel avant que grand-père ne le confie à une femme qui, courageusement, les liasses cachées contre son sein, l'amenait à destination.
Ce matin là, les époux Magnes se levèrent à la pointe du jour. Grand-père, à la barbe des occupants, transporta les armes au fond d’une brouette recouverte de sacs de pommes de terre et de quelques outils vers le Jardin de La Croix afin de les enterrer. Pendant ce temps, grand-mère, elle, cachait l’argent dans le jardinet derrière la remise, au fond d’une lessiveuse remplie de linge…
Dans la journée, deux soldats armés se présentèrent à la maison.
Nouvelle frayeur !
Frayeur vite dissipée car, pour bien faire comprendre qu'ils ne voulaient aucun mal à la famille, après avoir demandé à manger, les militaires déposèrent leurs armes sur une table. Ils parlaient mal le français mais suffisamment bien pour se faire comprendre.
Ils expliquèrent à Robert qu’ils étaient des prisonniers russes, enrôlés de force dans l’armée allemande et qu’ils cherchaient à rejoindre le maquis pour combattre l’occupant…
Etaient-ils de bonne foi ou cherchaient-ils des renseignements pour leurs chefs ? Robert, bien que quasi persuadé qu’ils disaient la vérité, ne prit évidemment pas le risque de les renseigner ou de les accompagner dans la montagne… Quel sort les y aurait attendu ?
Le lendemain, les allemands montèrent vers le Plomb du Cantal à la recherche de maquisards, puis, ne les ayant pas rencontrés, quittèrent Albepierre, au grand soulagement des villageois.
Un gros oiseau tout noir
Un jour du mois d’août, vers le 15 peut-être, l'oreille de Jeannot fut soudainement attirée par un ronronnement lointain et insolite dans un lieu d'ordinaire si calme.
Il sortit en courant devant la porte de l'hôtel, et quel ne fut pas son étonnement, de voir planer au-dessus du village, un gros oiseau tout noir. Un oiseau qu'il ne connaissait pas. Un oiseau tellement énorme et tellement proche de lui, qu'il se rendit à l’écurie chercher un long aiguillon. Il avait dans l'idée de chatouiller cet étrange animal si d'aventure, il lui prenait fantaisie de venir une nouvelle fois obscurcir le ciel du village. Le passage du volatile fut suivi de sourdes détonations et ce n'est que plus tard que l'on apprit que les allemands étaient venus bombarder Laveissière et les environs, de l'autre côté de la montagne, en soutien à une division allemande, aux prises avec les maquisards, aux abords du tunnel du Lioran. Le petit Jeannot, qui avait pourtant entendu parler des bombardiers, ne pouvait imaginer que ces masses sombres et imposantes puissent semer la terreur et mettre le feu à des villages entiers.
Quelques jeunes maquisards en armes, qui débattaient dans la salle du restaurant, eurent tôt fait de sortir : l'avion survola une deuxième fois Albepierre à basse altitude, toujours aussi noir et toujours aussi gros. Le petit Jean tentait en vain de l'atteindre avec son long bâton brandi à bout de bras, lorsque trois résistants s'affairèrent dans la cour du père Soubrier, face à l'hôtel. Ils y installèrent un fusil mitrailleur, avec la volonté affichée de descendre l'avion, si, d'aventure, il se présentait une troisième fois. Ils avaient déjà dressé leur arme dans un coin sombre de la cour et attendaient, s'apprêtant à agir.
La grand-mère les ayant aperçus au travers des carreaux de la cuisine sortit comme une furie !
– Mais vous êtes devenus fous ma parole ! Qu'espérez-vous avec votre pétoire ? Bande de c… que vous me faites dire ! Vous ne comprenez pas qu'ils vont tout anéantir !
Tout en vitupérant contre les jeunes maquisards, la grand-mère donnait de grands coups de pieds dans le fusil mitrailleur et continuait son sermon :
– Allez faire vos exploits ailleurs ! Allez à la Tombe du Père si le cœur vous en dit ; l'avion sera plus à portée et vous ne mettrez pas tout le monde en danger ! Ce n'est pas possible d'avoir perdu la raison à ce point !
Les maquisards n'insistèrent pas, ils remisèrent leurs armes, reprirent leur matériel et décampèrent du café.
La fin de la guerre était proche et avec les enfants du village, contrairement aux adultes qui voulaient oublier ces jours de malheur, les enfants mettaient en scène l'épisode de l'arrivée des allemands à l'hôtel Magnes et les combats entre maquisards et " boches ". C'est probablement ce qui leur permettait de refouler leurs angoisses...
Combien de fois l'ont-ils interprété cet épisode de l'interrogatoire, sous le porche de l'église qui représentait la salle du restaurant Magnes ? Dix fois, vingt fois ? Probablement davantage !
Des sentinelles, armées de fusils et de pistolets en bois, faisaient le guet dans un va-et-vient incessant, en équilibre sur l'étroit muret incliné attenant au mur de l'église, tandis que les allemands interrogeaient la famille. Soudain, le curé faisait son apparition et venait délivrer les prisonniers. Ceux-ci, ayant été libérés, les allemands repartaient et, invariablement, les maquisards tendaient une embuscade à l'ennemi auquel s'était joint le traître délateur… Tous étaient alors exécutés jusqu'au dernier sans aucune pitié. A chaque répétition le jeu se déroulait de façon quasi identique. Seuls changeaient les rôles des différents protagonistes. Les jeunes se querellaient pour éviter d'interpréter le rôle du méchant " boche " ou du " délateur ", préférant nettement se mettre dans la peau d'un maquisard intrépide, du grand-père interrogé, ou dans celle de Monsieur le Curé, homme généreux, bienveillant, et d'une charité exemplaire.
Danger !
" A peu près à la même époque, les Allemands étant à Murat, grand-mère, sur le pas de la porte au moindre bruit de moteur, aperçoit une automobile se dirigeant vers Murat. Pensant qu'il s'agissait de résistants, sans en être toutefois pas sûre, elle l'arrête.
" N'allez pas plus loin messieurs, il y a du danger ! "
La voiture fait demi tour, s'arrête. " Nous vous remercions, madame, vous nous avez sauvé la vie." puis reprend la direction de Prat-de-Bouc.
On sut qu'il s'agissait du Colonel Gaspard (Coulandon) chef des F.F.I d'Auvergne."
Le chef maquisard revint plus tard à l'hôtel et dit à grand-mère :
- Madame, vous m'avez sauvé la vie ! Je vous en serai toujours reconnaissant.
"Cet épisode illustre les liaisons précaires dans la résistance, il met une fois de plus en lumière l'esprit de décision et le courage de la grand-mère.
Après les combats du Lioran, harcelés par les maquisards, les allemands quittent la région de Saint-Flour Massiac, Lempdes... dans la journée du 25 août 1944.
Le Cantal est enfin libre ! "
Le drapeau tricolore
Paris aussi venait d'être enfin libérée ! Toute la famille célébra cette annonce dans la joie ! Seule l'absence de Gustave, avec qui ils auraient eu un plaisir indicible à partager cet événement tant attendu, empêcha les effusions d'allégresse …
Jean Magnes avait reçu comme recommandation de ses chefs, de dresser un mât dans le village et de convier les habitants au lever des couleurs tricolores, en signe de victoire et de liberté retrouvée.
Sans perdre de temps il se mit au travail. Le tronc d'un sapin déjà sec fit l'affaire. Trouver une poulie et une corde pour hisser le drapeau ne fut pas très difficile.
Il décida d'inviter les villageois à se rendre devant la grange Jacomis, le lendemain matin à neuf heures, pour fêter la libération de la Capitale, prélude à une libération totale. Pour cela, comme on le lui avait été demandé, il se rendit dans les chaumières et expliqua aux gens l'importance de leur participation à cette cérémonie. Dans chaque foyer il fut bien reçu, et beaucoup promirent de se rendre au pied du mât à l'heure convenue sauf si un empêchement de dernière heure...
Dès six heures du matin, grand-père se mit au travail et, une heure plus tard le mât était en place, prêt à envoyer le drapeau tricolore.
Il avait encore présent en mémoire, que, pour la libération de la Corse, en septembre 1943, Robert, son gendre, à la nuit tombée, avait planté sur le monument aux morts du village un autre drapeau tricolore, fait à la hâte par Jeannette et Marcelle, et sur lequel elles avaient brodé : " Vive la Corse Libre ". Il se rappelait également que le drapeau n'était pas resté longtemps en place… Aussi, bien en vue sur le pas de la porte de l'hôtel, un pincement au coeur, surveillait-il attentivement son ouvrage.
A l'heure dite, il se rendit devant la grange Jacomis, sortit le drapeau de sa poche, le déroula solennellement, et le fixa à la corde. Il attendit ainsi cinq bonnes minutes et vit venir vers lui un ancien du village, Rochez, enseignant retraité qui se campa, figé, à quelques pas de lui.
Jean Magnes avait préparé un petit discours de circonstance, dans lequel il était question de la bravoure des maquisards et des parisiens qui avaient libéré la capitale, mais pas un son ne sortit de sa gorge nouée.
Son regard se croisa avec celui du vieil homme. Ce dernier lui fit un signe de la tête et Jean, après avoir ôté son chapeau, amena les couleurs vers le sommet du mât. Ils restèrent immobiles tous deux un bon moment, et le vieil homme prit la parole :
– Mais où sont-ils donc ? Où sont-ils donc ces femmes et ces hommes du village ? Ils n'ont pas tous été déportés, ils ne sont pas tous morts à la guerre ou au combat ! Pour ceux qui ont péri, pour ceux qui ont été embarqués, pour leur mémoire ils se devraient d'être tous ici à cette heure. C'est bien triste, tout ce sang versé pour rien ! On dirait qu'ils n'ont rien compris !
– Ils ont peur, mon brave homme. Ils ont peur, car ils pensent que le vent peut encore changer de côté. Ils sont derrière le pas de leur porte ou derrière leurs rideaux à nous épier et à se dire : " Quand même ces deux, ils ont peut-être raison, mais si les " boches " revenaient ? Il vaut mieux rester prudents... "
Les deux manifestants se serrèrent la main, et Jean Magnes entreprit sur le champ de tomber l'arbre mort et de replier le drapeau de la République française. La cérémonie n'avait pas duré dix minutes.
C'est en rageant intérieurement que le résistant traversa la rue pour se rendre à l'hôtel où sa Marie-Louise l'attendait, furibonde :
– Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça ! Tu penses peut-être que les gens ici sont tous des communistes ? Ah tu as l'air malin maintenant, tu peux être fier !
– Parfaitement, je le suis, fier, et je les regarderai tous les uns après les l'autres dans les yeux quand je les rencontrerai. On verra bien alors qui les baissera les premiers. Il avait prononcé ces paroles sans animosité, mais avec une détermination farouche, indiquant que, quoi qu'il advienne, il tiendrait sa promesse.
Pendant trois jours, pas un villageois ne mit les pieds au bistrot. La grand-mère pestait contre son mari qui faisait fuir la clientèle, mais chaque jour les nouvelles devenaient plus rassurantes, et les gens, avec l’espoir, reprirent leurs habitudes. Jamais personne ne parla à Jean Magnes de cette journée, mais nul, dans le village, ne lui fit jamais baisser les yeux.
*Récit romancé issu des souvenirs de Jean Navarre
FIN