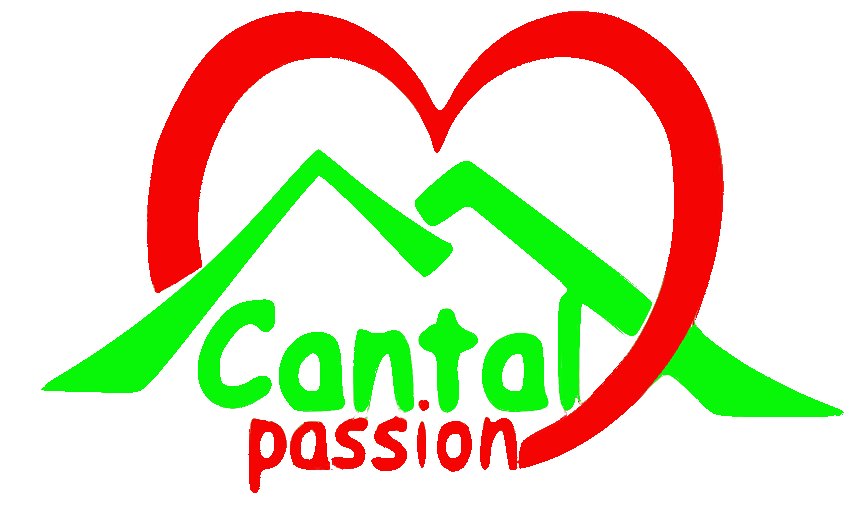Souvenirs d'Antoine Sauret, matricule n° 36.867, recueillis par Robert Navarre le 2 mai 1965, date du 20ème anniversaire de la libération des camps d’extermination hitlérien, publiés dans le Cantal Ouvrier et Paysan les 1er, 15 et 29 mai 1965.
Antoine SAURET est né le 25 août 1904 à Murat. Il fut responsable cantonal des FTPF à Murat. Il est l’un des 117 habitants de cette ville qui furent déportés par les Allemands en juin 1944 et dont 85 devaient trouver une mort affreuse dans les camps nazis.
A l’occasion du 20° anniversaire de la libération des camps d’extermination hitlériens, il a bien voulu évoquer devant nous, pour les lecteurs du « Cantal Ouvrier et Paysan» l’indicible horreur du calvaire des déportés.
De Murat à Neuengamme
Murat le 12 juin 1944.
Je revenais seul du maquis de Mandailles où en qualité de responsable cantonal des Francs Tireurs Partisans Français j’avais conduit deux jeunes patriotes de Clermont Ferrand. J’ignorais qu’un drame se préparait à Murat ce jour-là.
A la hauteur du cimetière vieux, les frères Brugiroux, menuisiers, me crièrent : « Ne descends pas en ville, les boches sont là ». Je les suis.
A peine avons-nous pris un chemin de traverse dans le creux duquel nous nous dissimulions qu’à cent mètres de nous une mitraillade éclate. Les Allemands, nous l’avons appris le lendemain, venaient de commettre à Murat leurs premiers crimes. Ils avaient tué Maire et un jeune berger qui allait chercher du pain.
Nous coupons alors en direction Virargues. On tire sur nous, nous nous dissimulons et sommes bientôt hors d’atteinte. A Virargues où nous restons toute la journée nous observons les avions allemands qui passent sur la région de Murat et les bruits d’une intense fusillade nous parviennent
Que se passait-il ?
Nous en eûmes le lendemain l’explication.
Les Allemands, accompagnés des traîtres de la Milice, étaient venus à Murat pour procéder à des arrestations de patriotes. (1)
Mais des maquisards les surprirent ; sur la place du Balat un terrible combat s’engagea. (2 ) Les Allemands et les miliciens relevèrent 21 morts dont le sinistre Kessler, chef de la gestapo pour la zone sud.
Murat 24 juin 1944
Du 12 au 24 juin je continuai mon activité de résistant ; j’assurai plusieurs liaisons avec le maquis et affichai un tract manuscrit appelant les patriotes à l’union contre l’occupant.
Le 24 juin, dès l’aube, Murat est encerclé ; les Allemands, craignant sans doute une nouvelle attaque ont pris cette fois leurs précautions. Non seulement ils occupent tous les points stratégiques autour de la ville mais des détachements parcourent les environs.
Dans la ville des patrouilles circulent
On arrête les hommes aux cris : « Papiers ! Mairie ! »
Vers 11 heures ils se présentent à ma porte. Je dois les suivre à la mairie.
Beaucoup, croyant à une simple vérification des papiers d’identité se sont présentés spontanément. Nous sommes maintenant entassés dans la salle de la mairie, collés contre les murs. Que veut-on faire de nous ? On relâche tous ceux qui ont plus de 50 ans et nous commençons à comprendre.
A cinq heures du soir, en rang par quatre nous prenons la route de Saint Flour. Nous sommes 117, parmi nous des jeunes de 18 à 20 ans : Fontaine, Servet, Chapuis, Portefaix… On nous aligne conte le mur de la ferme Modenelle ; deux mitrailleuses sont braquées contre nous. « Soyons stoïques » dit quelqu’un près de moi. Nous nous préparons à mourir après un dernier regard vers les toits gris de la vieille ville… Mais trois cars arrivent dans lesquels nous sommes entassés sans ménagement..
Arrêt à Saint Flour. Nous nous entre-regardons. Nous pensons tous à nos camarades fusillés à Soubizergues non loin de là le 13 juin. Va-t-on ici nous faire subir leur sort ? Mais non, nos bourreaux ont étanché leur soif et les cars repartent dans la direction Clermont-Ferrand où nous arrivons à la nuit. Sans aucune nourriture nous sommes entassés dans deux salles de la prison du 92° RI. Nous devrons attendre jusqu’au lendemain la distribution d’une soupe claire et infecte.
A Clermont, les interrogatoires de la Gestapo.
« Chassagny, Lanez, Saurret, Chauliguet, suivez-nous » hurlent dans notre prison les gardiens de la gestapo et, séparément, nous sommes « interrogés ».
« Déshabille-toi salaud ! Allonge-toi sur ce banc » Et les coups pleuvent, des coups de bâton assénés à toute volée, comme des coups de fléau.
- Tu es secrétaire du Parti Communiste ? »
- Je l’étais, mais je ne le suis plus.
- Tu as distribué des tracts ?
- Non
- Tu connais Delpirou ? Saunières ? (3).
- Non
Les coups redoublent.
- N’as-tu rien à ajouter ? Nous te donnons une dernière chance me dit l’un de mes tortionnaires en appuyant le canon de son pistolet sur mon oreille.
- Non
- C’est bon, habille-toi, tu ne seras pas fusillé, salaud, ce serait trop doux, tu seras pendu !
Après cet « interrogatoire » dont les traces demeurèrent longtemps sur mon corps je rejoignis mes camarades en prison. Plusieurs avaient subi le même traitement que moi. Quatre avaient été libérés.
Nous restâmes une semaine environ à Clermont avec pour toute nourriture, chaque jour, une eau saumâtre dans laquelle flottaient des fragments de feuille de chou. La menace de mon tortionnaire « tu seras pendu » me revenait souvent à l’esprit.
Au camp de Compiègne
Attachés deux par deux par des menottes aux premiers jours de juillet, nous quittons les prisons du 92 RI entassés dans des cars Michelin. Voyage terrible. Au moindre mouvement les menottes se resserrent ; nos poignets enflent ; impossible de bouger. La soif nous torture ; comment faire nos besoins ? Nos gardiens rient de nos souffrances.
Combien de temps dura le voyage, je ne m’en souviens plus.
Nous sommes arrivés au camp de Compiègne bondé déjà de prisonniers. Sommes-nous 1200 ? 1500 ? En troupeau, parqués les uns sur les autres, Français, Polonais, Russes, Lithuaniens… Nous attendons 15 jours, à peu près sans autre nourriture que quelques biscuits et morceaux de sucre de la Croix Rouge. Nous faisons déjà le terrible apprentissage de la faim.
120 par wagons à bestiaux
Nous savons que Compiègne est la dernière étape vers l’Allemagne. Un jour de juillet on nous entasse, on nous verrouille 120 dans un wagon à bestiaux avec, pour toute viatique 100 grammes de pain et un rond de boudin noir.
72 heures nous resterons là les uns sur les autres. L’odeur est intenable, la soif nous torture notre langue se colle au palais quand le convoi s’arrête dans les gares ou en pleine campagne. Un cheminot apitoyé par nos cris arrose le wagon avec la grue à eau. Je bois quelques gouttes dans un sabot. C’est un délice. Le lendemain nous boirons notre urine.
Déjà dans notre wagon, deux camarades dont un docteur ont perdu la raison. Plusieurs tentent de s’évader dont Durif de Murat. Que sont-ils devenus ? Nul ne le saura mais des sentinelles alertées tirent sur le wagon. Des hommes geignent. Comment les secourir ? Et la soif et la faim nous torturent. Où sommes nous ? Où allons nous ? Perdrons-nous tous la raison avant de mourir ?
L'enfer de Neuengamme
Nous croyions avoir touché le fond de la détresse, les souffrances que nous avions subies n’étaient hélas rien comparées à celles qui nous attendaient.
Quel jour de juillet étions-nous quand la dernière fois après cet infernal voyage le convoi s’arrêta ? Comment l’aurions-nous su ? Mais tout de suite nous comprîmes que nous étions arrivés.
Les SS et les chiens
Les portes s’ouvrent. Deux SS entrent en hurlant. A coups de schlague ils nous font lever et sortir. Aveuglément, ils frappent. Les morts ne sont pas épargnés. Bousculés, meurtris, aveuglés par la lumière du jour nous tombons hors du wagon, deux mitrailleuses sont pointées sur nous.
En colonne par cinq, au galop, des chiens, des chiens énormes à nos trousses qui déchirent les traînards dont les jambes flageolent, voilà comment nous sommes entrés au camp de Neuengamme.
Le camp est sinistre ; notre horizon c’est désormais ces rangées de baraquements gris entourés de barbelés.
A coups de schlague, nous sommes jetés, entassés dans une espèce de cave.
La chaleur est insupportable, la sueur dégouline sur nos visages, la soif nous torture, l’odeur est infecte et nous restons là des heures. Raffinement de cruauté on laisse couler une douche dans un coin. Je m’approche pour boire. Nouveaux coups, nouvelles insultes.
- « Déshabillez-vous ! » hurlent nos gardiens.
Sans ménagement nous sommes rasés de toutes part. Le même savon servira à tout le convoi.
Nous avons appris, déjà à surmonter tout dégout. Et on nous jette la chemise et le pantalon rayés. Les bagnards des temps les plus cruels avaient-ils un autre aspect ?
On nous compte 150 et, suivis des chiens et des SS, nous galopons vers le baraquement qui nous a été affecté.
12 par châlit
Comment pourrons nous dormir 150 dans cette baraque ? Mais il est hors question de dormir ; il faut s’entasser sous les coups, tant bien que mal. Nous sommes 12 par châlit ; il y a de la place pour quatre. Impossible de s’allonger. Nous sommes assis, recroquevillés, tête-bêche, les pieds d’un camarade sur notre visage, à même les lattes qui nous meurtrissent. Et nous apprendrons à sommeiller dans ces conditions, nous réchauffant à la chaleur des voisins, totalement immobiles, malgré l’inconfort de notre position, pour ne pas gêner les autres. Si encore nous avions pu rester ainsi de longues heures !
Appels, alertes, nouveaux supplices
Mais les appels semblaient être l’un des passe-temps favoris de nos gardiens, des appels qui nous tiraient brutalement d’un engourdissement doux à notre fatigue ; des appels qui duraient des heures. Maudits appels ! Quel déporté ne s’en souvient ? A toutes les heures, par tous les temps, il fallait rester debout, immobile, silencieux. Le froid, la pluie, sur nos pauvres corps presque nus.
Et les alertes de nuit ! « For Alarm ! » criaient nos bourreaux. Pourchassés par les coups de schlague qu’il était difficile d’éviter dans l’obscurité, nous nous entassions dans des abris plus exigus encore que nos baraques. L’alerte finie, nous regagnions nos châlits heureux malgré tout si, quelques heures plus tard, une nouvelle alerte ne nous chassait brutalement.
Un chien aurait-il résisté ?
Les kapos (4) nous réveillaient le matin de bonne heure. Le déjeuner : dans une assiette, pour deux, un bouillon clair que nous partagions jusqu’à la dernière goutte. Et en route pour le Kommando de travail, auquel nous étions affectés. Jusqu’à midi nous restions courbés sur le travail imposé, silencieux, pour éviter les coups qui pleuvaient au plus petit prétexte.
A midi, sur les lieux du travail, distribution de 125 grammes de pain, de cinq grammes de margarine et, parfois, s’il y en avait à proximité d’un peu d’eau. Travailler, manger si peu, être battu, dormir à peine, un chien y aurait-il résisté ?
La première fois que je suis sorti du camp, avec un groupe de sept ou huit camarades, ce fut pour décharger une péniche de mâchefer. Le travail n’avançait pas assez vite au gré de nos gardiens. La schlague fouettait souvent nos corps. Notre camarade Cassagne est jeté à l’eau par les SS. Nous le repêchons avec mille difficultés, car les forces nous manquaient sous les insultes et les coups. Le soir à notre retour, nous avions tous les mains en sang.
« Pourrons-nous tenir longtemps ainsi ? », nous demandions-nous le soir, à la nuit tombante quand, titubant nous regagnions nos châlits, après avoir, toute la journée arraché la tourbe des marais ou porté des fardeaux de planches ?
Dans un Kommando à Brême
Au début d’août 1944, un kommando de 1200 détenus environ est formé. J’en fais partie. Nous sommes entassés une nouvelle fois dans des wagons pour une destination inconnue sans pouvoir dire une parole d’adieu à nos compagnons de malheur. Où nous arrêterons-nous, quel sort nous attend ? Nous n’osons espérer rien de favorable, mais qui sait ?
Tout espoir n’est pas mort en nous …
Le convoi s’arrête près de Brèmes. Ici la vie hélas sera pour nous et la mort aussi pour beaucoup comme à Neuengamme.
A l’intérieur les Kapos font aussi la loi ; au travail les soldats en armes nous surveillent.
Je retrouve là quelques Muratais : Loussert, Georget, L’Héritier, Chassang, Chassagny, Collier, Niocel, Poudeyroux.
Jour après jour nous perdons nos forces ; les brumes d’automne, les premiers froids nous déciment. Pendant les appels, au travail, des camarades tombent.
Les coups n’y font rien, ils ne se relèveront pas. Les Kapos, furieux cravachent les mourants, les piétinent et c’est un cadavre que nous porterons au camp le soir. Lugubre convoi. Nous n’avons pas la force de pleurer mais Kapos et SS rient de nous voir ployer sous un fardeau si léger. Les kapos et les soldats rient et leur rire pue l’alcool. Le chef du camp surtout est un ivrogne. Un plaisir pour lui est de nous mettre en ligne et de compter en riant combien de coups de poings lui suffisent pour renverser toute la rangée de détenus.
Georges est battu à mort
A mesure que les mois passent nos gardes deviennent plus odieux. Un jour de janvier, Gabriel Georget est accusé par les Kapos (4) d’avoir volé un bout de pain. Ils le suspendent par les mains à des poutres ; les pieds ne touchant pas le sol et ils le rouent de coups. Il restera là, entièrement nu devant la porte du chef de camp toute la journée, par un froid terrible.
Le soir, nouvel interrogatoire, à coups de schagen, à coups de tabourets. Il paraît mort, on le met dans un cercueil. Il revient à lui, les kapos l’achèvent.
Combien sont morts ici ? La moitié de l’effectif sans doute. Chassagny, Collier, Poudeyroux ne reverront plus Murat.
3 mai 1945, la libération
Un kommando de Russes qui travaillait hors du camp ne rentra pas un soir. Ils avaient sans doute tenté de s’évader. Les appels et contre appels durèrent longtemps ce soir là.
Pendant des heures on nous fit sauter à croupetons, sous les coups autour de la cour à la file indienne. Malheur à celui qui n’avait plus la force d’exécuter cette gymnastique grotesque, nos bourreaux s’acharnaient sur lui.
Cette vie durera jusqu’à la fin mars, le début avril peut-être. A ce moment là, nous sommes expédiés de nouveau au camp de Neuengamme pour quelques jours seulement. Les habitudes n’y ont pas changé : les coups, la chambre à torture pour avoir cassé un manche de pioche, des cris de douleur. Le four crématoire fume sans arrêt dans une odeur de chair brûlée. Cette fumée, combien de fois l’avons-nous suivie des yeux dans le ciel lourd. Beaucoup de mes camarades sont morts depuis notre premier séjour ici. Un jour, sans que nous sachions pourquoi, on nous a changé de prison.
Les bagnes flottants
Nous sommes répartis sur quatre bateaux : le Deuchland, amarré à quai, l’Athéna et le Thilbeck amarrés à quelques centaines de mètres du rivage et le Cap-Arcona, plus loin de la terre.
Nous passerons là trois ou quatre semaines horribles, entassés à fond de cale, les uns sur les autres, sans nourriture, morts et vivants à même la tôle et les rivets, sur nos excréments, dans l’obscurité totale. Est-il midi ou minuit ? C’est toujours la nuit. La fantaisie de nos boourreaux nous fait changer de bateau. Dans quel but ? Le savaient-ils eux-mêmes ? Pour éprouver nos dernières forces ? Pour compter les morts ? J’ai vécu ainsi successivement sur les quatre bateaux.
Les bateaux sont armés de batteries antiaériennes pour protéger la ville.
Trois semaines sans manger
Les nuits de bombardement sont atroces. Les bombes explosent sur la ville, sur les quais. Les canons anti-aériens placés sur le pont ébranlent le bâtiment.
Notre destin est-il d’être exterminés par les bombes anglaises ? Les SS ainsi effaceraient leurs crimes.
Nous n’en pouvons plus. Nous subsistons seulement grâce à l’eau saumâtre qui suinte le long des tôles. Nous buvons notre rare urine. Nos dents sont clouées par la fièvre. Notre langue est collée au palais. Nous n’y voyons presque plus. Nous ne sommes que des ombres et n’avons pas même la force de penser.
Peut-on croire que des hommes puissent ainsi souffrir avant de mourir !
Le 3 mai 1945
Il était (je l’ai su depuis) trois heures de l’après-midi. J’étais effondré au fond de la cale de l’Athéna. Soudain je vis mes camarades, par grappes prendre l’échelle et, de leurs pauvres mains amaigries se hisser vers le pont. Des poignets trop faibles lâchent prise. Le bateau coule-t-il ?
Je les suis en titubant. La tête me tourne. J’arrive enfin sur le pont le dernier. Nos gardiens ont des mines étranges et leur silence me surprend.
Sur le quai des chars inconnus sont alignés. Nous voyons des uniformes nouveaux. Est-ce possible ? Sommes-nous libérés ?
Les plus vigoureux d’entre-nous s’accrochent à des câbles. Ils sont déjà sur le quai. Les soldats les embrassent. Des cris de joie ! C’est sûr, nous sommes libérés
Sur le quai je retrouve Chassang, Niocel, Quairel, L’Heritier, Ebel.
Nous nous embrassons. Mais notre joie n’est pas sans mélange : les trois bateaux sur lesquels nous étions il y a à peine quelques jours, le Cap-Arcona, le Deuschland, le Thilbeck, ne sont plus que des épaves calcinées. Ils ont été coulés les jours précédents et des milliers de camarades ont péri dans leurs flanc.
Les anglais s’empressent autour de nous : boire, à manger ! On me tend un seau de confitures. J’y plonge mes deux mains à la fois. Je emplis ma bouche, mais mes forces me trahissent et je m’effondre, sans connaissance.
De Neustadt à Murat
Je me retrouve à l’hôpital de Neustad. J’y reste quinze jours dans un état de faiblesse extrême. (Je pesais 38kg contre 98 au départ de Murat). J’écris à ma famille.
Après un mois de soins dans un hôpital de Bruxelles où je retrouve Paul Niocel je suis encore incapable de marcher.
Je suis dirigé sur Paris où je reste quelques jours à l’hôpital Bichat, puis sur Clermon- Ferrand où ma mère et ma femme me rejoignent.
Je rentrerai à Murat le 24 juin jour anniversaire de mon arrestation pour y apprendre le terrible bilan de la déportation : 85 Muratais sont morts dans les camps hithlériens.
En ce vingtième anniversaire de la libération des camps, nos pensées à nous, les survivants, vont vers vous, nos camarades disparus vers vos familles douloureuses.
Nous l’avons juré : nous ferons tout pour que jamais les hommes ne connaissent pareille souffrance.
* * *
1. Ils arrêtèrent ce jour là, Mme Saunières, Mme Espalieu, Cheyroux et Peschaud (Ces deux dernières devaient être fusillées à Soubizergues près de Saint-Flour).
2. On peut voir encore les points d’impact des balles sur la façade de la maison Rabbe notamment.
3. Delpirou et Saunières étaient des résistants
4. Les kapos étaient des détenus allemands, surtout des droits « communs », que signalait sur leur tenue un triangle vert.