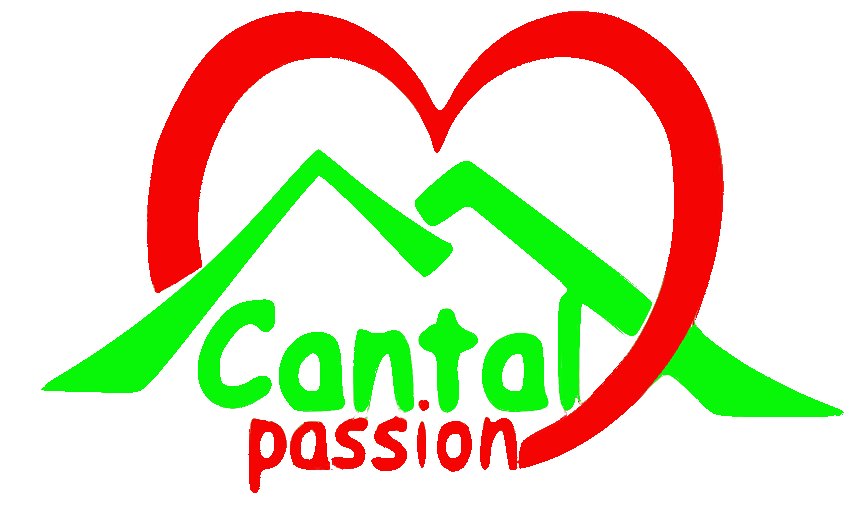III. PARACHUTAGES
Pendant six mois, jusqu'au débarquement, notre principale occupation sera le parachutage.
Un parachutage, cela commence par les messages personnels, ces mystérieux messages que des millions d'auditeurs écoutaient chaque soir sans en comprendre le sens, sans se douter qu'au moment où ils étaient assemblés autour du poste familial, dans quelque coin perdu de France, des garçons étaient eux aussi à l'écoute, pour qui les messages étaient bien plus importants que les informations, car ils apportaient l'espoir d'une nuit de bon travail... ou la déception.
Au début, l'écoute se faisait dans une ferme. Je revois ce paisible tableau de famille, dans la vaste salle cantalouse, où nous accueillait un bon feu de bois. Nous nous groupions autour de la grande cheminée, près de laquelle le grand-père fumait sa pipe pendant que la vieille filait la laine ; j'entends encore sa voix chantante nous dire, lorsque « notre » message n'était pas passé : « Vous ne les aurez pas les avions, pauvres ! »
Pour les non initiés, je lève le voile. Notre maquis était situé à la limite du Lot et du Cantal ; nous dépendions des M.U.R. d'Auvergne (Cantal) au point de vue maquis, subsistance, mais de la région de Toulouse, R 4, pour les parachutages. Toulouse était l'un des centres de la C.O.P.A. (Centre d'Opérations de Parachutages) qui deviendra plus tard le S.A.P. ((Service Atterrissages-Parachutages). Toulouse, en relation par radio avec Londres, recevait la liste des messages pour sa région ; en théorie, ils étaient changés tous les mois (en réalité, ils subsisteront plus longtemps). Une liaison les apportait à Bernard qui nous les transmettait.
Hommage soit rendu, en passant, aux liaisons, dont la vie s'écoulait dans les trains, et qui avaient à transporter en dehors du courrier, les valises contenant des émetteurs-récepteurs, et autres objets plus ou moins compromettants. Si l'on songe à la surveillance qui régnait dans les gares, on ne pourra qu'admirer le cran de ces hommes, qui n'ont joué qu'un rôle obscur, mais combien utile.
Il y a deux sortes de messages : « le régional », valable pour tous les terrains de la région, annoncé seulement lorsqu'étaient parachutés des hommes, de la forme : « De Pierre à Marguerite », et le message propre du terrain, simple phrase : « Les enfants de Denise sont sages » : Ainsi notre premier parachutage a été annoncé par le message : « De Pierre à Marguerite, les six enfants de Denise seront triplement sages ce soir », qui indiquait six parachutistes et trois avions.
Mais où s'effectuent les parachutages ? La C.O.P.A. employait des prospecteurs qui parcouraient des régions données - touristes de par les circonstances - où ils devaient repérer les terrains offrant des conditions de sécurité suffisante, c'est-à-dire situés à distance respectueuse de toute agglomération, et présentant une étendue plate et dénudée propre à recevoir les containers et les hommes lâchés avec une précision relative qui dépendait du vent et de l'efficacité de l'éclairage du terrain. Recherche difficile, car il est évident que les bois formaient un écran excellent contre toute curiosité intempestive.
Une fois le terrain trouvé, ses coordonnées prises sur la carte Michelin étaient envoyées à Londres par radio, ce qui constituait une première indication - parfois la seule - pour le pilote de l'avion visiteur. Chaque terrain recevait un nom sous lequel il figurait dans la liste de messages communiqués par Toulouse ; c'était un moyen simple de conserver le secret de son emplacement au cas où ces listes auraient été saisies par l'ennemi.
Notre terrain fut baptisé « Chénier ». Désormais, le nom de l'auteur délicat de « La Jeune Tarentine », n'évoquera plus pour nous que le souvenir nostalgique des nuits magnifiques passées en opération. « Chénier », donc, était un mamelon couvert de bruyères, un des points culminants du haut Lot - 778 mètres - situé à une quarantaine de kilomètres de l'OSO d'Aurillac. Région escarpée en diable, où collines et vallons se succèdent en tous sens ; les hauteurs presque toujours couvertes de bois serrent d'étroites prairies allongées le long des ruisseaux aux eaux vives.
Par bonheur, le Pech de la Poule, nom local et pittoresque de notre « Chénier » est nu, hormis quelques bouquets de conifères rabougris. Nous disposons donc de quatre hectares sans bois ; c'est tout juste suffisant. Seulement, les conditions d'horizontalité sont loin d'être remplies la butte est étroite, à peu près quatre cents mètres sur cent, avec des pentes pas tellement douces, ce qui nous donnera l'occasion d'admirer le travail des boeufs qui descendront, impassibles et lents, avec une charrette transportant au moins une tonne de matériel. Les vallons qui entourent le Pech sont heureusement secs ; un seul endroit est marécageux. Tant pis pour les parachutistes qui y amerriront!
En face de « Chénier », à huit cent mètres à peine à vol d'oiseau, une autre butte, où s'agrippe un village, la Bastide du Haut-Mont, excellent observatoire d'où, par les nuits de lune, on pouvait certainement assister à la descente des parachutes ! Malencontreuse proximité ? Jamais le secret de nos opérations n'a transpiré, preuve, s'il en était besoin, de l'état d'esprit des paysans de l'endroit. Grâce leur soit rendue ! D'ailleurs, ils connaissaient les messages aussi bien que nous...
« Chénier » terrain de récupération de la zone Sud, c'est-à-dire susceptible de recevoir, pendant toute la durée de la lune, des parachutages sans message, de pilotes n'ayant pas trouvé leur terrain, a été remarquablement équipé : un Eurêka et un S-Phone. L'Euréka est un appareil à ondes très courtes, qui détecte l'avion équipé du Rébecca dans un rayon de 150 km et qui fait entendre un grésillement de plus en plus net à mesure que le visiteur approche, chaque fois qu'il se branche. Guide précieux et précis, le Rébecca, son jumeau, conduit le pilote droit sur le terrain grâce à l'indice qui se déplace à l'intérieur d'un cercle dont le centre correspond aux ondes émises par l'Euréka. Ainsi, bien avant de voir nos feux, notre Hudson ou notre Lancaster se dirigeait vers nous sans dévier, comme, bien avant de l'entendre, nous étions prévenus de son arrivée. Le SPhone est un simple téléphone sans fil au moyen duquel il était possible de parler au « despatcher » en anglais, et nous savions ainsi ce qui allait nous être livré.
Lorsque l'avion était en vue, nous balisions le terrain : des lampes parachutées à faisceau concentré éclairant très loin, étaient disposées en droite ligne dans le sens du vent, trois rouges, une blanche. Ces appareils étant très délicats, une sape avait été creusée, sur le terrain : on y accédait par une sorte de trou étroit qui, le jour, était couvert par un lit de bruyère. Des sièges, si l'on peut dire, avaient été ménagés, simples avancées de terre, le mur étant légèrement en retrait ; lorsqu'il pleuvait, la terre jaunâtre était gluante et quelque peu salissante ! Nous y tenions une dizaine en nous serrant un peu, nous y avions relativement moins froid qu'à l'extérieur, étant abrités du vent, et une installation électrique achevait le confort. Il était possible d'y faire une belote en attendant le travail.
Mais tout cela, le côté théorique des opérations, s'il peut présenter quelque intérêt pour le profane, n'était rien pour nous ; une nuit de parachutage ne se limitait pas au fonctionnement des derniers modèles de la science ou au ramassage des containers. Une nuit de parachutage, c'est une suite exaltante d'émotions intenses, d'instants uniques, de tableaux magnifiques. Oh ! tristes foules qui alliez quémander à Fernandel ou à Marika Rôkk votre ration d'évasion, d'oubli...
Premier parachutage... Premier travail, premier acte de guerre. En cette fin janvier 1944, le temps était magnifique et exceptionnellement doux. Le jeudi, déjà, le message est passé. Le soir, pour la première fois, nous montons au terrain. Sept kilomètres à pied. A neuf heures, nous quittons notre home. Avec des ruses de Sioux - naïfs que nous étions ! - nous traversons Parlan déjà endormi. Et c'est la lente montée à travers bois, le long de ce chemin sinueux qui n'en finit pas. Arrivée sur la route de Latronquière et nouvelles précautions il est vrai que la lune détache nos silhouettes sur la blancheur du chemin ! Un sentier lui succède où les branches dénudées des arbustes nous giflent au passage nous montons toujours ; l'air est frais, les horizons s'allongent. Encore une dernière montée, à même les bruyères de la butte, et nous arrivons au sommet.
« Chénier » ! L'espace que nous dominons s'étend à l'infini. Des prés, des bois, des collines, noyés dans une même masse indistincte sous la clarté lunaire. Sur ce plateau, démesurément agrandi par la nuit, il nous semble être perdus au milieu de la planète. Nous n'avons plus d'attaches avec la terre, infiniment silencieuse ; parfois seulement la lueur clignotante d'une ferme au loin, l'aboiement d'un chien, nous rappellent à la réalité et d'ailleurs, que nous importe la terre !
C'est vers le ciel que nous tournons vos regards, vers le ciel déjà empli, là-bas, au-dessus des côtes de France, par le ronronnement ami. Mais la poésie de cette nuit, de toutes ces nuits d'opérations, si elle nous hante encore, n'est qu'un aspect du merveilleux qui doit se révéler à nos sens, vierges d'un tel spectacle. Revenons sur terre... et même sous terre, et pénétrons dans la sape. Des gens affairés ont déjà installé l'antenne et les appareils, et la familiarité avec laquelle ils les manipulent nous emplit d'admiration. Nous ne pouvions imaginer alors que pendant cinq mois c'est nous qui serions les maîtres de l'Eurêka ! Les heures passent... Les discussions s'engagent, vives, sur les chances qui restent pour cette nuit. A deux heures passées, les appareils sont débranchés, et nous partons. Déception, sans doute, mais ce premier contact nous a laissé une telle impression que nous ne nous plaignions pas trop. Le retour est long. Qu'importe ! Couchés à quatre heures, nous dormirons jusqu'à dix.
Le lendemain, le message repasse, complété : « De Pierre à Marguerite, les six enfants de Denise seront triplement sages ce soir ». Six hommes et trois avions ! Le premier grand parachutage de « Chénier ». Bernard exulte ! Même promenade digestive le soir ; en arrivant dans le sentier, un cri nous arrête et nous fait sursauter : « Qui va là ? » en même temps qu'une mitraillette nous menace. C'est un garçon d'un maquis voisin venu en renfort et qui garde le terrain : « Passez moi un chargeur, je n'ai pas de balles dans le mien » ; comme c'est bien français, cette manière toute symbolique d'exécuter les ordres, de faire tout avec rien.
L'équipe de Toulouse est sur le terrain, ce qui confère un certain caractère officiel, si l'on peut dire, à la chose. Curieuse impression, de trouver en pleine brousse, des citadins, avec cravate et chapeau nous avions déjà oublié ces accessoires de la vie civilisée. Beaucoup d'animation sur le plateau de bruyères. Les autos se sont succédées, qui ont été garées dans le petit chemin creux ; l'une d'elles n'est pas arrivée par la route ordinaire. Alerte ! Tout ce remue-ménage pourrait évidemment attirer des gêneurs... A 23 heures 30, le premier avion est « accroché » à l'Eurêka ! Les émotions commencent. ! L'indicatif du terrain, C 7, est répété en morse, afin de prévenir le visiteur qu'il arrive bien sur « Chénier ».
Dix minutes plus tard, l'oreille perçante de Jacques le décèle. Nous ne tenons plus en place. Il a suffi que le silence de la terre et du ciel soit peuplé d'un vrombissement lointain mais parfaitement net dans cette grande paix du sommeil de la nature pour qu'un énervement indicible s'empare de nous tous. Les minutes qui suivent sont angoissantes. Va-t-il nous voir ? Le bourdonnement approche, approche, nous distinguons maintenant notre grand oiseau noir. Il perd de l'altitude. Il vient vers nous. Les quatre feux de balisage sont tous dirigés vers lui, et quelle supplique dans le geste tendu à l'extrême de ces bras porteurs de lumière ! Comme si la réussite de l'opération tenait aux quelques centimètres que l'on essaie de gagner ! Très bas, il passe. juste au-dessus de nous, dans le vrombissement de ses quatre moteurs. Comme nous t'aimons, messager inconnu, qui est peut-être parti en maugréant après ce sale « job » d'une nuit pleine d'embûches.
Au-dessus de nous, il allume ses feux de position. Vus ! Nous sommes vus ! Il s'éloigne, amorce un virage, revient. René s'époumone au S-Phone : « Allo, Aircraft ! Allo Aircraft : how many containers ?... Drop ! Drop! ». Il repasse, gracieux et puissant. Vingt visages, tournés vers lui, qui retiennent leur souffle, qui ne vivent plus que pour cette ombre qui plane et qui rugit. Un nouveau virage. Encore plus bas, il revient « Drop ! », crie René. Une lumière sous la carlingue, la trappe qui s'ouvre, un froissement soyeux, vint-cinq parachutes se déploient, livrent paisiblement leur précieuse cargaison. René, les yeux rivés à l'avion, continue à parler. Un choc sourd, et un parachute se déploie à ses pieds ! D'autres chocs... Les parachutes multicolores gisent à terre, soulevés par le vent, animés de soubresauts, grands corps qui ne veulent pas mourir.
Nous nous précipitons, essayant gauchement de les détacher des containers, longs tubes cylindriques dans lesquels sont empaquetés avec un soin méticuleux, les mitraillettes, les grenades, les F.M., le matériel de sabotage. Mais l'un de nous a trouvé un parachutiste et le ramène. Il a dîné à Londres ! Il vient d'un pays libre ! Nous l'entourons. Les questions s'entrecroisent. Son flask de rhum circule de bouche en bouche. Il fait passer un paquet de cigarettes anglaises. Oh ! ma première « Churchman » ! ce goût retrouvé après quatre ans ! Nous sommes riches des biens que les plus riches ne peuvent posséder.
La trêve est de courte durée : un second vrombissement. La même opération se répète : l'avion passe, allume ses feux, vire, repasse et décharge ses containers. Trois parachutistes sont récupérés et la même scène se répète... rhum et cigarettes ! Il nous semble vivre un rêve et seul, je crois, pourrait nous ramener à la réalité le crépitement de mitrailleuses boches. Nous aurons heureusement la chance presque miraculeuse de n'en jamais faire connaissance dans ces conditions.
Les choses se compliquent maintenant : ce n'est plus un, mais deux avions qui survolent le terrain en même temps. Les cris s'entrecroisent : « Allumez les feux - non, éteignez, il y a un boche ! ». De plus, des ratés dans le moteur donnent à l'un des deux appareils un vrombissement étrange, peu familier, et Aurillac a certainement entendu le passage des zincs précédents. Affolement. Les lampes se dirigent tour à tour vers chacun des deux appareils. Le S-Phone ne donne rien. Incertitude. Mais bientôt, c'est un nouveau largage, une nouvelle récupération d'hommes et de matériel.
Le ciel a livré plus que nous attendions ; il est calmé. A présent, une tâche plus ingrate nous attend : il faut récupérer les containers, les rassembler, plier les parachutes. A Bénéviole, la ferme voisine toute proche dans la vallée, le fermier a été réveillé, et il arrive sur le terrain avec ses boeufs. Les charrettes, chargées de containers, vont descendre les pentes les plus rudes au rythme lent des bêtes impassibles. Sur le chemin, un camion, et la camionnette « récupérée » à la Milice d'Aurillac attendent d'être chargés. Ainsi, avant l'aube, le matériel va être évacué et rassemblé dans des granges en attendant la répartition effectuée d'après les ordres de Toulouse.
Cinq heures déjà. Cette nuit a été vraiment irréelle. La camionnette nous emmène tous à Parlan et, à six heures, l'aubergiste est réveillé ; la détente après les émotions et l'effort. Casse-croûte copieux, fromage et lard. Pierre, en garçon bien élevé, accroche sa mitraillette au porte-manteau. Révélation nouvelle : en 1944, un village de France peut être occupé à l'aube par des terroristes qui ne sont plus que de paisibles travailleurs venus se restaurer après un long effort. Le jour se lève. Nous repartons pour achever la récupération.
Décidément, les dieux sont avec nous ! Sur le terrain, nous assistons à un spectacle magnifique : la lumière rose du soleil levant colore les pentes des buttes, et là-bas, à l'horizon, les monts du Cantal découpent leur profil irrégulier, violacé sur le ciel pâle. Les boeufs infatigables continuent à descendre les containers encore récupérés. Ainsi par un contraste piquant, l'antique moyen de transport des paysans devenait le précieux auxiliaire du bombardier. Etrange charroi. Les longs tubes, rangés par cinq dans les chars, sont recouverts d'un amas difforme de parachutes qui traînent à terre ; toute cette soie entassée pêle-mêle entre les battants sales de la voiture, et les armes... de quoi vêtir luxueusement nos compagnes...
Juchés chacun sur une charrette, cahotés au gré incertain du passage des roues grinçantes, nous descendons ainsi, René, Pierre et moi, les paupières un peu lourdes, la tête un peu vide, réalisant encore mal la féerie de la nuit, lorsqu'apparaît un homme, chapeau à la main. Présence insolite. Bêtement, nous saisissons notre mitraillette, mais il s'avance et nous accoste : c'est un des trois parachutistes du dernier avion qui ont été lâchés à quelques kilomètres du terrain avec la charge habituelle de containers. La récupération n'est pas terminée. Pour bien nous prouver son origine, il sort un paquet de « Lucky ». Le goût de la fumée blonde achève de nous réveiller. Nous en tenons « un » pour nous seuls, et le pressons de questions sur la vie à Londres, sur l'échéance du jour « J ».
Ce débarquement d'ailleurs va devenir une obsession bien plus pour nous que pour les civils. Certes, nous autres, dès janvier 44, sommes déjà libérés. Nous n'avons plus aucune attache avec la trahison, avec la lâcheté. Nous ne subissons plus les lois de Vichy, nous ne sommes plus sous la contrainte allemande. Libres ! Comme cet air si frais, si léger, que nous respirons à pleins poumons, comme ces vastes horizons qui n'arrêtent pas notre vue, accroissant encore le sentiment de notre liberté. Et, suprême témoin de notre autonomie, cette arme que nous possédons, cette sale petite « Sten », mitraillette « uniprix », disent-ils à Londres, dont la précision du tir se limite à une trentaine de mètres, mais grâce à laquelle cependant nous pouvons nous défendre... ou attaquer.
Notre France libre, elle est partout, dans les villes, dans les forêts et les montagnes, partout où, entre les mailles de l'ennemi, agissent des patriotes. Pour nous, elle est réelle, dans ces prés et ces bois, dans ce fouillis de vallons et de collines, dans ces fermes où les paysans, nos complices, nous ravitaillent et nous épaulent. Quelle est la superficie de notre royaume, de notre îlot indépendant, qui a des ramifications chez les F.T.P. du Lot et en Corrèze, en Dordogne, et dans le Puy-de-Dôme ? Est-ce nous, les encerclés, ou les quelques boches rassemblés dans les villes de quelque importance ? Certes, nous ne possédons ni artillerie, ni aviation, mais toutes ces forces invisibles constituées partout, et soutenues le jour donné, par les immenses armées massées en Angleterre, donnent confiance.
L'Angleterre ! Ce pays sans Gestapo et sans traîtres... Nous sommes avides d'en avoir enfin des nouvelles, d'en connaître la vie et notre parachutiste ne cesse de louer l'accueil anglais, la gentillesse anglaise pour les Français exilés. Tous ont conservé un souvenir ému - de leur séjour outre-Manche, mais avec quelle ferveur ils se posent sur notre sol. J'ai, encore présent à la mémoire, le souvenir de ce radio qui, à peine arrivé, s'est agenouillé et a embrassé notre terre de bruyères : il n'était pas venu en France depuis 39.
Mais les recherches vont recommencer. Il s'agit de récupérer tous les containers tombés dans un bois, et nous y passons toute la matinée et une partie de l'après-midi. Ce n'est que vers cinq heures que les dernières charrettes emportent le reste du matériel. Travail pénible. Il faut rouler les « bidons » ou les porter - et chacun pèse près de deux cents kilos - de leur point de chute vers un chemin, contourner des taillis, traverser des ruisseaux, gravir des pentes.
Le chaud soleil de cette exceptionnelle fin janvier joue à travers les branches et nous déjeunons dans un pré, torse nu, épuisant le contenu de ces fameux « S2F », si précieux, que c'était toujours le premier élément des envois que nous cherchions à identifier : ils étaient en effet réservés au Comité de Réception, et contenaient deux cellules, sur les cinq constituant un container, remplies de vivres, corned-beef, lait, chocolat, margarine, thé, café, sucre, cigarettes, etc... Comme elles étaient réconfortantes ces boîtes de lait que nous vidions sur place, au petit matin, après la nuit d'effort !
Nous rentrons enfin, après ces quelques vingt heures de travail, ayant assisté à un record de largage (83 parachutes) qui ne sera sans doute dépassé que lors des envois massifs de juin juillet. Consécration de « Chénier » qui va devenir l'un des terrains les plus utilisés de la zone Sud. Du bon boulot en perspective !
Mais de telles nuits ne se sont pas renouvelées souvent. Nous avons eu une moyenne de deux parachutages par mois jusqu'en avril, puis trois en mai, quatre en juin, cinq en juillet. Le reste du temps, nous avons rempli une tâche obscure et souvent pénible. J'ai dit que « Chénier », terrain de récupération de la zone Sud exigeait notre présence chaque soir, pendant toute la durée de la lune. Pendant deux semaines de suite, souvent pour rien, nous montions au terrain, partagés en deux équipes de trois. Les veillées dans la sape étaient alors parfois lugubres : les uns dormaient, les autres lisaient. Il faisait froid.
Bernard eut l'idée géniale un soir, d'allumer un brasero dans la sape, mais bientôt asphyxiés, nous avons passé le reste du temps dehors, sous le vent glacial, sautant sur place ou boxant pour nous réchauffer. ! Heureusement, Fernand, qui avait complété notre équipe en février, un Limousin, grand gosse exubérant, était spécialisé dans les histoires drôles qu'il racontait à merveille et nous ne nous lassions pas d'entendre les mêmes plaisanteries. Les heures passaient ainsi, le ronronnement de l'Eurêka qui ne se décidait pas à grésiller tenait notre attention en éveil.
Sur le Pech de la Poule, à 780 mètres, soufflait toujours un vent qui, lorsqu'il venait des montagnes, était glacial. Certaines nuits, lorsque la pluie se mettait de la partie, il nous fallait passer plusieurs minutes, cinglés par les rafales de vent et d'eau, à déterrer l'antenne de la terre gelée. Nous revenions transis, et rallumions le feu pour nous sécher et boire un quart de thé brûlant.
Mais, plus encore que les coups durs, restent à notre mémoire toutes ces visions magiques, l'ombre de l'Halifax ou du Lancaster balayant le terrain, les virages à trois cents mètres de nous, tous feux allumés, ce vrombissement à la fois puissant et doux, le claquement des parachutes qui s'ouvrent, la joie intense que nous apportaient les premiers grésillements balbutiés par l'Eurêka, le son lointain de l'avion qui s'approche et qui déchire le silence d'une nuit dont il nous semblait être les maîtres, seuls humains aux aguets parmi l'humanité endormie. Et partout, là-bas, au loin, nos frères d'armes qui répétaient les mêmes gestes, qui éprouvaient les mêmes sensations intenses.
Bon souvenir encore, cette nuit, pendant la lune de mars, où, à trois, nous avons effectué une récupération. J'étais allé chercher l'Eurêka en réparation chez Bernard. Retour en vélo, après dîner, l'appareil sur le dos. Treize kilomètres dans la nuit ; une de ces promenades dont on se serait facilement passé ! J'arrive à la maison à onze heures passées. Montée au terrain, mise en place de l'appareil. J'aspire à fumer tranquillement une cigarette bien méritée ; pas le temps : aussitôt branché, l'Eurêka bourdonne.
Dix minutes après, le zinc est sur nous. Nous faisons à trois un balisage hâtif et rudimentaire. Un seul virage et les containers sont lâchés. Hurlements de joie ! « Notre » parachutage à nous seuls ! Les copains sont réveillés, le fermier monte avec sa charrette. A six heures, tout le matériel est camouflé. Une heure de sommeil et au travail ! Il faut faire l'inventaire, prévenir Bernard qui arrive et se montre fort satisfait.