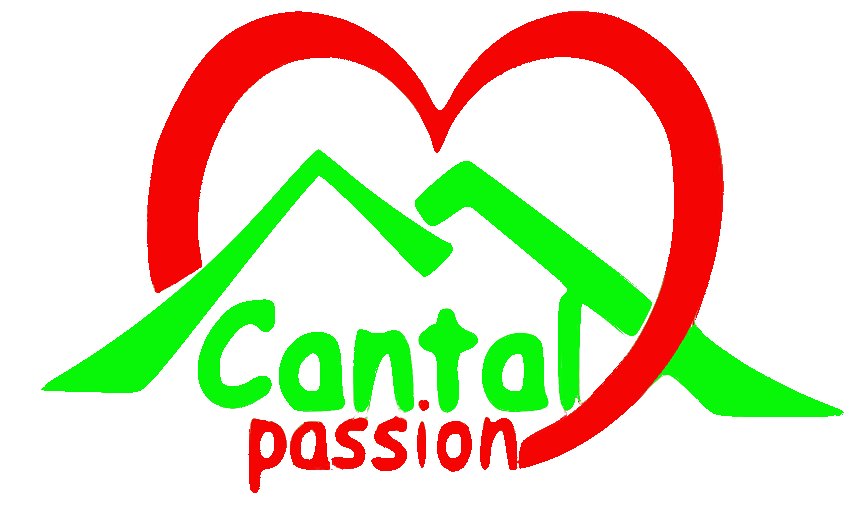Beau voyage de noce, rêve éternel des jeunes mariés, voyage de noce à retardement que nous attendions depuis 1910 et d'autant plus désiré que tu avais été plus souvent remis, tu allais enfin te réaliser !
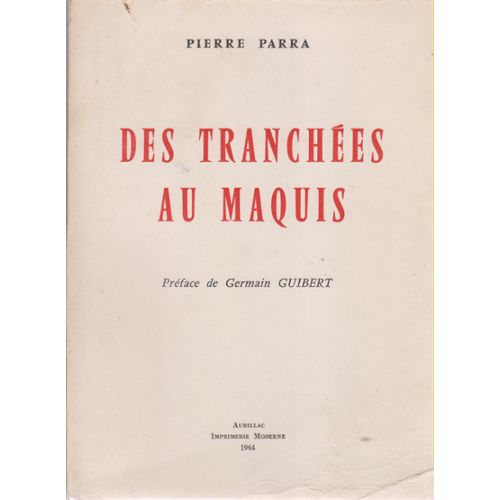
CHAPITRE I
VOYAGE DE NOCE ET MOBILISATION
DEPART AU FRONT
Tout était prêt ; la date fixée : premiers jours d'août 1914 ; l'itinéraire choisi : Lyon (Congrès consacré aux questions d'histoire et de géographie locales dans l'Enseignement), descente de la vallée du Rhône (en bateau si possible), visite de Marseille et de la Côte (promenades en mer), et retour par le train.
Les valises étaient faites. Nous étions heureux ... Hélas ! en ce début d'août 1914, et pour des millions d'hommes, un autre voyage, plein d'imprévu et de misères, allait commencer ...
2 AOUT 1914 : MOBILISATION GÉNÉRALE.
De tous nos clochers, le tocsin, égrenant ses notes lugubres sur les villes et les campagnes, annonçait le gigantesque incendie qui allait embraser le monde et appelait aux armes tous les hommes valides. Et je partis aussi pour cet autre voyage qui devait durer plus de quatre ans. J'en ai noté au jour le jour les péripéties nombreuses dans trois carnets de route qui fourniraient à eux seuls la matière d'un gros volume. Je me contenterai d'en donner ici quelques extraits, relatant les faits les plus caractéristiques. On voudra bien en excuser le style télégraphique et parfois un peu négligé. Le jour de la mobilisation ; nous étions chez le grand-père Bélaubre, au village de Roudette, commune de Siran. Avec sa jument, il vint nous conduire jusqu'à Laroquebrou. En passant à Siran, nous apprenons l'assassinat de Jaurès. A Laroquebrou, petite ville célèbre par ses cordonniers et ses « toupis », j'achète une paire de brodequins quatorze francs.« Vous ne les userez pas, me dit le vendeur, la guerre sera finie avant ». Hélas ! je devais en user bien d'autres ...
Les trains pour les civils marchent jusqu'à six heures du soir. Nous partons - de Laroquebrou à onze heures et montons jusqu'à Aurillac. La gare est occupée militairement. Nous prenons le train jusqu'à Loupiac-Saint-Christophe, allons à pied de la gare à Pléaux et à bicyclette de Pléaux à Vaissière.
Passons auprès de mon père la journée du 3 août : journée des adieux à toute la famille. Je dois rejoindre Aurillac le mardi 4 août avant huit heures du matin. Je laisse mon père très affecté par mon départ. Ma femme est plus courageuse. J'ai moi-même le coeur bien gros, mais je m'efforce de n'en rien laisser paraître. Le train, parti à dix heures et demie de Loupiac, n'arrive à Aurillac que vers quatorze heures. On ne voit que soldats dans les rues, circulant en tous sens, d'une allure fiévreuse. Avec les trois régiments qui s'y rassemblent : 139e, 3398 et 1008 Territorial, la chose n'a rien d'extraordinaire.
Affecté au 3398 Régiment d'Infanterie, 20e Cie, je suis habillé dans l'après-midi. Les réservistes continuent à arriver et on les habille au fur et à mesure.
L'animation est grande dans la cour de la caserne Delzons. Effet des plus pittoresques et d'un comique achevé que tous ces hommes à demi habillés, moitié civils et moitié militaires, en capote, pantalon rouge et casquette ou chapeau melon. Mais personne ne songe à rire ... Je suis désigné pour rester au Dépôt. Cela ne fait pas du tout mon affaire. Je veux partir avec les camarades. Nous sommes sept instituteurs à la 208 Cie : le sous-lieutenant Andrieu, de l'Aveyron, et les camarades de l'Ecole normale d'Aurillac : Chastang, Figeac, Mauranne, Ribes et Sarrauste. Ils sont tous plus ou moins gradés et moi soldat de 28 classe. Je fus, je l'ai déjà dit, un médiocre soldat pendant « l'active ». Le moment est venu de se racheter... Je me « débrouille » donc pour me faire armer et équiper en tenue de campagne, comme les « copains ». Je me mets sur les rangs avec les autres au moment du départ, et en route ! Mais mon père, furieux en apprenant ma décision, m'en garda longtemps rancune.
Le 1008 quitta Aurillac le 6 août en direction de Nice, le 1398 partit le 7 du côté de Belfort, et le 3398, considéré comme infanterie alpine, s'embarqua pour Gap dans la nuit du 7 au 8 août avec l'itinéraire suivant : Arvant, Clermont, Riom, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne, Saint-Etienne, Givors où nous traversons le Rhône, Vienne, Valence, Die et Gap. Arrivée, le dimanche 9 août, à quinze heures, après un voyage de quarante heures dans les wagons à bestiaux. Voyage pénible, mais l'enthousiasme qui est général nous fait oublier la fatigue. Tout le long de la route, dans les champs, de vieux paysans se découvrent au passage du train et gardent leurs chapeaux à la main ; des femmes et des jeunes filles agitent leurs mouchoirs. On entend les cris : « »A Massiac, la fanfare locale est à la gare et joue la « Marseillaise » en notre honneur. A Arvant où l'on nous offre du café, des jeunes filles portent aux officiers des gerbes de fleurs nouées de rubans tricolores. A Die, dans la Drôme, des infirmières de la Croix-Rouge nous distribuent gratuitement du vin, un morceau de pain et du chocolat. C'est touchant, et malgré moi les larmes me montent aux yeux.

* * *
Notre séjour à Gap, du 9 au 21 août, est marqué par des exercices d'entraînement et des manoeuvres très pénibles, en raison du terrain accidenté et de la chaleur accablante. Le 17 août, le capitaine Madet, venant du Maroc où il a passé huit ans, prend le commandement de la 200e Cie. Officier de carrière de grande valeur, c'est un chef en qui les hommes ne tardent pas à avoir toute confiance. La frontière des Alpes, après entente avec l'Italie, n'a plus besoin d'être gardée. Nous quittons Gap, dans la nuit du 21 au 22 août pour débarquer le 22 août au soir, en Lorraine, à Bayon, sur la Moselle, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lunéville.
CHAPITRE II
EN LORRAINE
Forêt de Champenoux et bataille du Grand-Couronne
(22 août - 25 septembre 1914)
Aussitôt débarqués, nous nous mettons en route pour Saffais, petite localité où nous devons cantonner, à 11 kilomètres au Nord de Bayon, à peu près à égale distance de Lunéville et de Nancy, sur la crête séparant les vallées de la Meurthe et de la Moselle. Nous arrivons en pleine retraite du XVe corps. Des soldats de toutes armes, pêle-mêle, sans équipements, le plus souvent sans fusils, encombrent la route, lamentable troupeau se dirigeant vers l'arrière. Spectacle peu encourageant. Quant à nous, nous allons vers l'avant avec l'ordre, paraît-il, de tenir coûte que coûte pendant quarante-huit heures. Cela commence à devenir sérieux. C'est bien la guerre ici : grondement très proche du canon, éclairs brusques des éclatements dans la nuit sombre. Des hauteurs de Saffais, nous voyons au loin les lueurs d'un immense incendie, un autre, plus près de nous, sur notre droite c'est, dit-on, la gare de Damelevières qui flambe.
La nuit n'est guère longue. Le dimanche 23 août, lever à trois heures du matin pour creuser des tranchées. Chaque section fait la sienne. A la 1" section, nous fignolons la nôtre, la recouvrant avec des branchages et du foin : deux chars au moins qui étaient en meules, dans le pré voisin. Nous nous croyons ainsi à l'abri. De même, le lendemain, recevant les premiers obus, des fusants, nous nous sentons en pleine sécurité, après avoir mis sous notre képi le couvercle de la gamelle. Pendant que nous occupons les tranchées creusées la veille quelques camarades partent en reconnaissance vers le village à moins de deux kilomètres en avant de nous (Vigneulles, je crois), espérant y trouver du vin. Leur expédition tourne court : ils reviennent au pas de course et les bidons vides. Le village est occupé par les Allemands avec lesquels ils ont failli se trouver nez à nez. Rencontre plutôt désagréable.
* * *
Le 25 août la bataille est nettement engagée. L'ennemi recule. Notre artillerie par un feu très nourri déblaie le terrain et la marche en avant commence. Chemin faisant, nous pouvons nous rendre compte des effets du, tir de nos canons. A un endroit trois servants d'une batterie ennemie sont tués, dont l'un coupé en deux. Plus loin, la batterie entière a été détruite et abandonnée : six pièces avec les caissons restent sur le terrain. A un moment, une fusillade nourrie éclate près de nous, les balles sifflent au-dessus de nos têtes : un seul blessé léger à une main. La nuit tombe. Des lueurs sinistres montent à l'horizon c'est Blainville-sur-l'Eau qui brûle, après Charmois. Nous traversons Blainville en flammes, nous dirigeant vers Mont-sur-Meurthe. Les habitants sont restés pendant deux jours cachés dans leurs caves. Ils ressortent maintenant que les Allemands sont partis. Un bon vieux, à qui nous demandons des nouvelles de ces derniers, nous répond : « Ils étaient encore là il y a une heure. Ils ne sont pas bien loin, allez ! Vous les trouverez bientôt ».
Et de fait, à peine à un kilomètre de Blainville, nous faisons halte dans un champ à droite de la route. Il est près de minuit. Nous n'avons rien mangé depuis vingt-quatre heures. Pas de ravitaillement. Tout juste le temps d'ouvrir une boîte de « singe » et de commencer à croquer un biscuit bien dur les balles sifflent, de nouveau. On ne se fait pas prier pour s'aplatir. Tant pis pour le « singe » renversé et saupoudré de terre. Personne n'est blessé à la compagnie. Heureusement nous avions quitté la route. Une mitrailleuse allemande installée, paraît-il, dans le clocher de Mont-sur-Meurthe, l'arrosait copieusement. La position devenant intenable, nous prenons le sage parti de reculer en attendant le jour. Nous partons à deux heures du matin. La nuit n'a pas été longue. Dans les deux dernières nuits, je n'ai pas dormi en tout pendant cinq heures. Aussi je dors debout sur les rangs et chancelle. Je ne suis pas le seul. Mais je n'ai jamais encore autant souffert du manque de sommeil. Nous avons gagné de douze à quinze kilomètres dans la journée.La marche en avant continue le 26 août. Nous fouillons un bois très touffu, baïonnette au canon. Les « oiseaux » sont envolés. Nous les poursuivons à découvert, au pas de charge. Les balles sifflent de nouveau. Il pleut. Il est très difficile de marcher au pas gymnastique dans la terre détrempée. Nous avançons par bonds. L'ennemi est en fuite.
La nuit vient enfin. La poursuite se termine. Nous bivouaquons dans un champ d'avoine. Mais défense de faire du feu, partant pas de soupe. Il va falloir coucher sur la terre mouillée, et il pleut toujours. On s'assied, chacun sur son sac, par groupes de trois ou quatre, adossés les uns aux autres, et l'on essaye de dormir. Si l'un des co-équipiers se déplace en dormant, tout le groupe se renverse comme un château de cartes. Une nouvelle averse. L'eau remplit le creux du képi et dégouline dans le cou. Quelle nuit ! Heureusement une bonne nouvelle nous fait tout oublier nous sommes relevés et allons prendre un peu de repos. En partant le lendemain nous traversons le champ de bataille de la veille. Dans un désordre indescriptible, parmi les caissons et les sacs abandonnés, traînent çà et là, des membres épars à côté de cadavres difformes, ventres ouverts et crânes défoncés. Vision d'épouvante !
Le 27, sommes cantonnés à Barbonville et passons une bonne nuit dans le foin.
Le 28 août, marche de 25 kilomètres jusqu'à Fléville, en direction de Nancy. J'ai sous la plante des pieds des ampoules larges comme des pièces de vingt sous. Un véritable supplice.
Le 29, étape de Fléville à Essey-les-Nancy où nous passons les journées du 29 et du 30 août
Dans les premiers jours de septembre, nous creusons des tranchées à l'Est de Nancy au château du Tremblois et en avant de Laneuvelotte et de Velaine-sous-Amance, face à la forêt de Champenoux. Nous les occupons, sous la pluie, du 5 au 11 septembre. Nous y subissons de nombreux bombardements. Les obus tombent à vingt mètres de notre tranchée. Les Allemands sont établis à moins de cinq cents mètres de nous, à la lisière de la forêt de Champenoux. Avec la jumelle du lieutenant, je les vois très bien aller et venir dans leur tranchée. Nous sommes enfin relevés après sept jours de tranchées dans l'eau et la boue. Repos le 12 septembre, à Cercueil, où j'assiste à une scène curieuse. Dans un pré, trois artilleurs lorgnent un cochon d'une cinquantaine de livres. Ils s'approchent de lui, le saisissent par les oreilles. Le terrasser, l'assommer d'un coup de barre sur la tête, le faire disparaître dans un sac est l'affaire d'un instant. Ils partent tranquillement emportant leur cochon sur le dos. C'est ce qu'on appelle la foire d'empoigne. Au cours de la période de tranchées, quatre tués dont le lieutenant Michel de la S.H.R. A la 20e Cie deux hommes ont été blessés légèrement par des éclats d'obus.
* * *
L'ennemi bat en retraite sur tout le front au moment de la victoire de la Marne. Dans notre secteur, il renonce à prendre Nancy et se retire, après des assauts infructueux et sept fois répétés contre le plateau d'Amante. Nous le suivons jusqu'à la frontière en avant de Sornéville. Avec un peu de retard, malheureusement. Il a laissé en partant des effets, des armes (plus de 150 fusils) et un beau choix de casques à pointes : de quoi satisfaire les plus difficiles. Dans un bois, à droite d'Erbeviller, des havresacs en quantité, des souliers et des bottes, ces dernières très recherchées. Détail macabre : un camarade voit une belle botte à demi enterrée. Il se précipite, tire pour l'arracher : une jambe suit. Il lâche tout et s'enfuit épouvanté. Autre détail non moins lugubre. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, nous nous arrêtons près de Réméréville pour dormir à la belle étoile, dans les fossés de la route. La belle étoile est absente. Il fait noir comme dans un four. Je m'allonge tant bien que mal. Tout en dormant, je me déplace et me trouve coincé entre le talus de la route et un camarade. Je donne un coup de coude à ce dernier en lui disant « Tu pourrais bien te pousser un peu, tout de même ! » Sans résultat. « Dort-il bien ! » pensais-je en me retournant. Au petit jour, en ouvrant les yeux, que vois-je ? Un cadavre de soldat allemand étendu à mes côtés.
D'autres morts, Français et Allemands, gisent là fraternellement mêlés. Dans une fosse commune, non encore comblée, nous comptons 26 Allemands, dans une autre 18. L'air est empesté par ces odeurs de cadavres en décomposition ...
Repos, entrecoupé de travaux divers à Velaine où, les habitants étant revenus, nous mangeons du pain blanc tout chaud, puis à Seichamps jusqu'au 25 septembre, date à laquelle nous partons en direction de Nancy que nous traversons. Accueil chaleureux de la population qui, sans doute pour nous témoigner sa reconnaissance, nous distribue au passage des cigares, du chocolat, du vin, de la bière, des prunes et jusqu'à des pots de confitures.Après Gondreville, où nous cantonnons dans la nuit du 25 au 26, nous laissons Toul à gauche et marchons, par Ménil-la-Tour et Hamonville, vers ce secteur Richecourt. Seicheprey-Rémières, dans lequel nous devions passer de si dures journées...
CHAPITRE III
SECTEUR DE RICHECOURT
SE ICHEPREY - REMIERES
(26 septembre 1914 - 10 mars 1915)
Après avoir dépassé Mandres-aux-4-Tours et franchi la crête de Beaumont, dans la nuit du 26 au 27 septembre, nous continuons la marche en avant vers les deux heures du matin, en direction de Richecourt. Elle est subitement interrompue par une vive fusillade. On se couche. Après un moment d'arrêt nous repartons. Nouvelle fusillade, plus nourrie que la première et dans laquelle on distingue le tic-tac des mitrailleuses.
Les Compagnies, déployées à la hâte en tirailleurs et un peu mélangées, se replient en désordre, mais pour s'arrêter presque aussitôt. Par groupes de deux, avec les outils portatifs dont ils disposent (pelles et pioches), les hommes creusent des trous sur place en attendant le jour. Avec l'ami Serre, de Maurs, nous travaillons d'arrache-pied. Nous rejetons au fur et à mesure la terre en avant de nos sacs individuels, dressés face à l'ennemi. Nous arrivons à faire un trou où nous pouvons à peine nous blottir tous les deux, en nous serrant l'un contre l'autre. Abri bien insuffisant. Comme il devait cependant nous servir !
Dimanche 27 septembre 1914 ! La terrible journée ! Dès que le jour paraît, la fusillade recommence. Une pluie de balles et d'obus s'abat sur nos éléments de tranchées où nous avons du mal à nous cacher. Nous devons tenir coûte que coûte. Malheur d'ailleurs à ceux qui tentent de se replier en terrain découvert, ils sont impitoyablement fauchés par les balles des mitrailleuses.A six heures et demie, Serre, qui a voulu regarder pardessus son sac est atteint à mes côtés d'une balle en pleine tête. Il meurt presque instantanément, sans faire un geste, sans dire une parole. Pauvre ami !Le sang jaillit de sa blessure et forme une petite mare dans notre trou ; des débris de cervelle pendent sanguinolents... J'enveloppe sa tête dans ma serviette, cependant que la mitraille pleut toujours.Il en sera ainsi toute la journée, la fusillade ne se ralentissant par instants que pour reprendre de plus belle. Impossible de se montrer, de faire un mouvement, sans risquer sa vie. Heures interminables et combien hallucinantes que celles passées ainsi côte à côte avec le cadavre inerte et froid de celui qui fut pour vous le meilleur des amis !Enfin la nuit tant attendue arrive qui chassera l'idée fixe et mettra fin à l'horrible cauchemar. On va pouvoir se lever, sortir du trou, faire quelques mouvements pour détendre ses membres engourdis à rester tout un jour dans la même position.Hélas ! tout n'est pas fini, le plus terrible reste à faire enterrer les morts. Travail bien pénible et que personne ne voudrait faire. Il faut se dévouer pourtant et aller jusqu'au bout du sacrifice. Aidé d'un camarade, je sors le malheureux Serre de la tranchée. Avec l'ami Figeac nous recueillons ses papiers et tous les objets lui appartenant pour les renvoyer à sa famille. Nous creusons la fosse et l'y descendons. Un prêtre, soldat à la Cie, est là qui récite la prière des morts. Immobiles, le képi à la main, nous pleurons comme des enfants. La fosse se referme : une modeste croix de bois, avec un morceau de papier plié en quatre portant le nom. Et c'est fini. Adieu, cher ami, adieu !Nous sommes relevés le 28 septembre vers une heure et demie du matin par le 275' d'Infanterie et allons au repos à Mandres. Le sinistre bilan de la journée du 27 septembre s'établit ainsi, si mes renseignements sont exacts : le 339' a eu, ce jour-là, 393 hors de combat (tués, blessés ou disparus), c'est-à-dire près du cinquième de son effectif. Parmi les morts, le lieutenant Portefaix, professeur à l'E.P.S. de Pléaux. L'inspecteur primaire de Mauriac, le sympathique M. Tarnier est blessé, ainsi que les collègues Auzolles, Chastang, Lapeyre, d'autres peut-être, dont le nom m'échappe ou que je ne connais pas.Tout cela est de nature à nous donner le «cafard ». D'autant plus que la correspondance n'arrive pas. Dix-sept jours sans nouvelles ! Enfin cinq lettres, le 5 octobre, et le 13, battant tous les records, treize lettres ou cartes.Pour la distribution, on fait le cercle autour du sergent de jour qui porte le paquet, un cercle parfois un peu resserré. Le sergent lit les noms, et sa lecture est interrompue par les cris : « Présent ! » ou par l'indication de la section de l'inté¬ressé. Les oreilles se tendent, les cous aussi, pour voir le paquet. Ceux qui n'ont encore rien le voient diminuer d'épais¬seur avec des regards inquiets.La distribution finie, mine déconfite de ceux qui repartent les mains vides. Les autres, les heureux, décachettent leurs lettres, les dévorent avidement et leurs figures s'illuminent ou s'assombrissent parfois, suivant qu'ils ont de bonnes ou de mauvaises nouvelles...Dans ce secteur de Richecourt-Seicheprey-Remières, que nous allons occuper pendant cinq mois et demi, le front se stabilise juste à l'endroit où nous avons rencontré l'ennemi et creusé nos tranchées dans la nuit du 26 au 27 septembre.Alors, vont se succéder pour nous les périodes de deux ou trois jours de tranchées et de deux ou trois jours de repos, dans des villages à moins de dix kilomètres de la première ligne, à Mandres-aux-4-Tours notamment.Ce village est bombardé à deux reprises, le 9 octobre, à 17 heures et à 22 heures. La première fois, nous mangions la soupe, lorsque tout à coup des obus éclatent sur nos têtes. Quelques-uns tombent sur le haut du village, d'autres à côté de l'église, d'autres enfin sur le parc à chevaux près de la route d'Hamonville.Les tuiles sautent avec fracas, des murs s'écroulent. Dans les rues, on se sauve au grand galop. Les brancardiers accourent, car il y a des blessés et même des morts : deux de la 22°, un à la S.H.R. ; une quinzaine de blessés dont plusieurs gravement : l'un d'eux a eu un bras coupé net. Dans une écurie, six chevaux sont tués ; au parc, quatre mulets sont étendus raides morts ; des marronniers sont écartelés.En moins de dix minutes tout était terminé, une quinzaine d'obus seulement ayant été tirés. Le calme renaît. Nous nous couchons dans les granges comme d'habitude. Nous dormions tranquillement lorsque nous sommes réveillés en sursaut par de nouveaux éclatements sur le village. Nous descendons précipitamment des tas de foin. Atteinte par un obus incendiaire, la grange contiguë à celle où nous couchions est toute en feu. Le 2° peloton de la 20° Cie y était cantonné. C'est un sauve-qui-peut général dans toutes les directions. A l'appel, lorsque la Cie est enfin rassemblée dans un champ, vers minuit, il y a quarante manquants.
Que sont-ils devenus ? La plupart nous rejoignent par la suite, à l'exception de huit ou neuf, qui, tués sur le coup ou seulement blessés, ont été brûlés dans la grange, près de la porte de sortie qu'ils n'ont pu ouvrir. Parmi eux, le caporal d'ordinaire de la 20° : Resche, originaire de Massiac. Peu encourageant pour revenir aux tranchées cette nuit même vers les trois heures du matin !* L'ami Figeac, sergent-fourrier, me demande de remplacer comme homme de corvée pour les distributions de vivres, un camarade tué lors du bombardement de Mandres. A cause de lui, j'accepte. Cela ne me dispense nullement de marcher avec les camarades pendant la journée, et comme les distributions se font seulement la nuit vers 21 ou 22 heures, il faudra se coucher tous les soirs de 23 heures à minuit, quelquefois plus tard. Comme seuls avantages, je trouverai peut-être à m'approvisionner plus facilement, et surtout, j'aurai ma correspondance quelques heures plus tôt, ce qui est très appréciable et achève de me décider.Le 17 octobre, vers les deux heures du soir, à Hamonville, j'assiste à l'enterrement du camarade Besse, boucher à Pléaux, mort des suites d'une blessure par éclat d'obus, reçue la veille aux tranchées. C'est jour de repos, et nous sommes nombreux de Pléaux ou des environs pour accompagner à sa dernière demeure « un enfant du pays ». Nous nous étions donné rendez-vous devant la maison où le corps avait été déposé.La section de la 18° Cie, à laquelle le sergent Besse appartenait, rend les honneurs sous le commandement d'un adjudant. Au milieu du silence les commandements de : « Baïonnette au canon ! Présentez : armes ! » se font entendre. Tout le monde se découvre. Le corps, enveloppé dans un drap, est porté à l'église, sur un brancard par les infirmiers.Ces prières des morts dites par un aumônier militaire, dans une église dévastée, aux vitraux déchiquetés, devant une assistance de soldats, tête nue, les larmes aux yeux pour la plupart, produisent un effet des plus saisissants. Mes yeux se mouillent malgré moi...Comme il est triste aussi, sous le ciel gris et bas d'octobre, ce défilé de l'église au cimetière ! La fosse a été creusée à côté d'autres, toutes semblables, surmontées d'une croix blanche portant les nom et prénom, grade, classe, numéros du Régiment et de la Cie de celui qui repose là. Ils sont bien de 25 à 30, dans ce modeste cimetière de village, tombés loin de ceux qu'ils aimaient, loin du coin de terre natal, privilégiés malgré tout, car des camarades, des amis, les ont accompagnés jusqu'au champ de repos. Combien d'autres n'auront pas eu ce suprême hommage, morts anonymes, dispersés par les obus, ou jetés pêle-mêle dans l'horrible fosse commune, et que leur famille ne pourra jamais retrouver !
* * *
Au cours des périodes de tranchées en novembre et au début de décembre nous avons chaque fois des blessés et des morts. Le beau-frère du cuisinier de mon escouade tombe frappé d'une balle en pleine tête. Il n'a pu que dire : « Oh ! ma pauvre femme ! » Il laisse deux enfants et un troisième à naître. J'ai eu le pénible devoir de prévenir sa famille. Le 11 décembre, le camarade Ribes, de St-Christophe, que j'avais remplacé comme instituteur à Préaux, est tué, au créneau, par une balle dans la poitrine. Nous l'avons enterré au cimetière de Seicheprey, contre le mur, à gauche de la porte d'entrée, au milieu de la rangée, en face la tombe du lieutenant Rodde, de la 240, tué la veille. Scène profondément triste que cet enterrement dans la nuit. On creuse la fosse à tâtons, on la referme de même. Un prêtre soldat récite les prières des morts. On plante sur la tombe une croix de bois blanc. C'est fini. On repart. Adieu, pauvre Ami ! Et la funèbre liste s'allonge toujours ...
CHAPITRE IV
L'ATTAQUE DU 13 DECEMBRE 1914 A REMIERES
Le 12 décembre, dans le secteur de Rémières, le 2860, soutenu par le 2520, attaque les tranchées allemandes. Nous sommes en réserve. L'attaque réussit. Mais quelques heures plus tard l'ennemi reprend les tranchées qu'il avait perdues et deux Compagnies du 2860 sont presque entièrement faites prisonnières. Il faut tout recommencer le lendemain 13 décembre. Ce sera notre tour.
Heure H : huit heures. Nous prenons position à sept heures seulement, en plein jour déjà, une heure trop tard. Nous avons été aperçus et l'artillerie ennemie prévient notre attaque. Avant que nos canons aient ouvert le feu sur les tranchées ennemies, nous recevons un déluge d'obus. Fusants et percutants, par rafales passent sur nos têtes, pour éclater à une cinquantaine de mètres en arrière avec un bruit d'enfer. Des sections entières du 1670, de Nancy, qui se cachent sur notre droite, dans un petit bois de sapins, sont anéanties. Notre Cie n'a pas encore trop souffert : quelques blessés seulement. Nous sautons à la hâte dans nos tranchées où nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambes, parfois jusqu'aux genoux. On n'y regarde pas de si près et on patauge résolument.
La 190 Cie doit se porter la première en avant et la 20' la renforcer dans les tranchées qu'elle aura occupées. Au commandement de : « En avant ! », des hommes de la 19e sortent et tombent après avoir fait quelques mètres seulement, car l'ennemi nous attend de pied ferme, les fusils braqués. Presque tous les coups portent. A notre droite, les « petits gars d'active » du 167e tombent sous les rafales de mitrailleuses comme les épis de blé sous la faux. Ceux qui ne sont pas atteints reviennent Fans nos tranchées. L'attaque est impossible dans ces conditions. Au cri de : « En avant ! » pour la 198, le lieutenant Croguennec commandant notre section, croyant qu'il s'agissait de la 20e, sort du boyau et enjambe le parapet en faisant un grand signe de croix. Après quelques mètres il tombe en disant«1ère section vous n'avez plus de lieutenant ! ». L'ami Rodde, de Pléaux, qui se trouvait derrière lui dans la tranchée se dresse par-dessus le parapet pour lui porter secours. Il tombe, tué raide d'une balle en plein front. Un autre soldat est frappé mortellement à ses côtés dans la tranchée.Il faut cependant aller chercher le lieutenant qui a besoin de soins et que d'autres balles peuvent atteindre et achever. Aidé de son ordonnance, je creuse, avec les mains d'abord, puis avec une pelle qu'on me passe enfin, une ouverture dans le parapet. Je m'y glisse, et en me traînant sur le ventre et sur les genoux, je parviens jusqu'au lieutenant. Le saisissant sous les bras, je l'entraîne à reculons. Mes camarades me tirent par les pieds dès que j'arrive à leur portée et nous font suivre tous les deux, l'un traînant l'autre, dans la tranchée.Nous emportons ensuite sur un brancard le Lieutenant au poste de secours : deux kilomètres en terrain à peu près découvert et à la vue de l'ennemi. Heureusement il ne tire pas sur nous et nous arrivons sans encombre. Une balle dansle côté droit, le poumon est atteint. Blessure guérissable, mais demandant des soins immédiats. Il devait en effet guérir par la suite. Je suis heureux à la pensée de lui avoir, peut-être, sauvé la vie.**Je le quitte pour retourner à la tranchée où nous restons encore à grelotter dans l'eau jusqu'à minuit, heure à laquelle nous sommes relevés.J'ignore le chiffre des pertes de ces deux journées, mais il a dû être élevé. En effet, au début de février 1915, la bande de terrain d'une cinquantaine de mètres environ qui sépare les lignes est jonchée des cadavres des nôtres, depuis les attaques les 12 et 13 décembre 1914. A certains endroits les morts sont si nombreux qu'on ne distingue plus que le bleu des capotes. Une centaine au moins sont couchés là, dans les positions les plus diverses. Vision d'horreur que le temps aura du mal à effacer ...
* * *
L'ami Figeac s'étant fait une entorse au début de janvier, je m'occupe des distributions avec le caporal d'ordinaire. Nous restons à Seicheprey. Une quinzaine d'obus tombent à moins de 20 mètres du château que nous occupons. Trois obus l'atteignent en plein dont l'un rentrant dans la cuisine que nous venons de quitter, renverse sur le feu des marmites des cuisiniers. En janvier 1915, le château de Seicheprey avait reçu son 328 ème obus. Le 4 janvier, étant de repos à Ménil-la-Tour, le caporal d'ordinaire Genton, de Massiac, me demande de l'accompagner à Toul où il a va faire des achats pour la Cie. Toul n'est qu'à 11 kilomètres de Ménil. De Toul, je n'ai rien vu ou pas grand'chose, si ce n'est beaucoup de soldats, des embusqués surtout, bien astiqués, qui nous regardent de travers avec nos habits crottés et manquant un peu de fraîcheur. Pour la première fois, depuis cinq mois exactement, je me déshabille et couche dans un lit. Je n'y dors pas mieux que sur la paille. Manque d'habitude.
Le lendemain 5 janvier, la journée se passe en achats de toutes sortes (deux mille francs à dépenser pour la Cie). J'ai à peine le temps de me faire raser, tailler les cheveux et de prendre un bain. C'est mon meilleur souvenir de Toul. Toute la matinée du 6 est prise par la distribution des bonnes choses apportées de Toul et qui serviront à fêter les « Rois », le soir. Le repas a lieu dans les granges où sont cantonnées les escouades. Chacune d'elles forme un groupe distinct. Des portes posées à plat sur des caisses vides : voilà des tables. Une baïonnette plantée au milieu de chaque table supporte une bougie. Aux murs, des équipements, des musettes, des fusils sont accrochés. Les convives sont assis sur des caisses ou couchés à la mode antique, à même le foin. Menu : soupe, viande de porc, dinde, oie ou poulet suivant les escouades, petits pois en conserves, fromage, petit-beurre, vin ordinaire, champagne, café. Un véritable festin de « Roi ». Au champagne, les chansons commencent, accompagnées par la voix grave du canon qui gronde dans le lointain. Minute de détente et d'oubli, après les dures journées écoulées et en attendant celles qui se préparent...
CHAPITRE V
PREMIER SEJOUR AU BOIS DE SAULCY
(10 mars - 27 mai 1915)
Nous quittons le secteur de Seicheprey le 10 mars 1915. Sans regret. Tout le monde est content de changer d'air. Adieu l'eau et la boue des tranchées de Rémières où nous avons pataugé durant tout ce pénible hiver de 1914-1915, avec comme seul abri, contre les obus, notre toile de tente. Le rassemblement pour la relève est bruyant. Chacun raconte ses exploits, réels ou imaginaires, aux camarades du 206' qui viennent nous remplacer.Nous allons cantonner à Broussey-en-Woëvre, avant de rejoindre, sur notre gauche, notre nouveau secteur du Bois de Saulcy, avec lequel nous prenons contact le 13 au soir.Nous sommes dans les bois, et pendant deux mois et demi, nous mènerons la vie de véritables « hommes des bois ».Cachés sous les arbres, des villages entiers composés de huttes primitives, mais assez bien aménagées et reliées entre elles par des rues, rechargées avec des fascines. Les carrefours sont nombreux et l'on risque fort de s'égarer. D'autant plus qu'on a oublié die poser des plaques indicatrices.Gare aux incendies, par exemple ! Le 20 mars, une des cabanes de la 22e Cie brûle avec tout son contenu : colis, effets, équipements, fusils, etc. « Les dégâts, purement matériels, ne sont pas couverts par une assurance. »
Les vivres pour la Cie sont toujours distribués de nuit, à plus de trois kilomètres des cuisines. On les transporte sur les wagonnets d'un decauville. Le voyage, aller et retour, dure trois heures. Je suis ainsi appelé à faire le dur appren¬tissage du métier de « cheminot ». Ce n'est pas une sinécure. Quand il pleut, on glisse sur les rails et les traverses, et les chutes sont nombreuses. On se dispute les wagonnets. Comme la voie est simple, il faut attendre le retour des wagonnets vides, ou bien les culbuter par côté, pour les remettre ensuite en place. C'est un travail de force, très pénible.
* * *
Aussi, lorsque Figeac est désigné, le 30 mars, pour aller suivre à Aulnois un cours de sous-officier comptable, je pro¬fite de son départ pour demander à reprendre ma place dans mon escouade. Je fais part de mon projet à Figeac qui se rend à mes raisons. C'est donc chose décidée, malgré l'amicale insistance du caporal d'ordinaire Establie pour me garder avec lui. Je vais trouver le capitaine Madet qui m'autorise à rejoindre mon escouade le lendemain 31 mars. Je suis très bien accueilli par mes camarades de la 4e escouade qui s'empressent pour me faire une place dans leur « cagna ». Il y fait bon, même chaud. Le lit est bien un peu dur, mais je m'endors quand même, heureux du changement intervenu, sur ma demande, ce que certains camarades n'arrivent pas à comprendre ...
Le 2 avril, au rapport, on nous parle de la famine en Allemagne, d'après des lettres trouvées sur des soldats allemands, faits prisonniers. Plusieurs femmes se seraient suicidées à cause de la misère qui règne là-bas. L'une d'elles s'est pendue au pied de son lit. Ces détails, qui n'ont rien de comique, sont accueillis par un éclat de rire. Les hommes sont sceptiques« On nous bourre le crâne ! » disent-ils.Le 20 avril, un caporal de la 2e Section est allé, de nuit, chercher un fanion planté entre les lignes. Au pied de ce dernier, se trouvait un paquet de journaux. J'ai eu l'un d'eux entre les mains. Ecrit entièrement en français, il a pour titre : « La Gazette des Ardennes ». Il est assez insignifiant rien que des articles anonymes et pas très forts. En deuxième page (et c'est là, sans doute, la raison d'être du journal), s'étale, en gros caractères, un appel à la population française. Il y est dit qu'on nous trompe. L'Allemagne n'a remporté que des succès. Nous sommes partout battus. Nous avons, en Allemagne, 250.000 prisonniers dont on donne une première liste sur ce numéro, etc., etc. L'effet attendu est raté. On cherche à nous « acheter ». Nous ne sommes pas à vendre.Le 15 avril, le capitaine Madet quitte la 20' Cie, permutant avec le capitaine de Solan, officier d'ordonnance du Colonel.Le 22 avril, je suis affecté à la ire escouade. Le 24, Figeac est nommé sergent-major à la Cie. Mauranne le remplace comme sergent-fourrier.Distribution à la Cie, le 25 avril, de la tenue bleu horizon. Avec ces nouvelles capotes, nous avons plutôt l'air endimanchés et « moches » par surcroît. Cela importe peu. Pendant notre séjour au bois de Saulcy, l'emploi du temps est à peu près le suivant : trois jours de repos occupés par des corvées diverses, aménagement des « cagnas », etc, et trois jours de service aux avant-postes. Ce service est particulièrement pénible pendant les jours de pluie, hélas ! trop fréquents. Qu'on en juge par les quelques détails suivants notés au cours d'une période en première ligne.Aux avant-postes, sur la route de Bouconville à Apremont, le petit poste (le P.P.) est au pont. Je prends la faction le premier, à 50 mètres en avant. Il fait noir comme dans un four. Un ciel d'encre. Au moment où je débute comme sentinelle, une averse, un vrai déluge, commence. La toile de tente n'arrive pas à me préserver et je suis vite mouillé jusqu'aux os. J'ouvre mes yeux tout grands dans la nuit où l'on n'apercevrait pas un homme à cinq mètres. C'est surtout sur les oreilles qu'on doit compter pour éviter les surprises possibles. Quittons le service de sentinelles à quatre heures du matin, au petit jour. Passons la journée dans les abris où il pleut comme dehors. Impossible de se tenir debout, ni de se coucher, tant le sol est humide. On reste toute la journée accroupis, assis sur les sacs posés à même la boue et les pieds dans l'eau.Si encore nous pouvions faire du feu pour nous sécher ! Impossible : la fumée se verrait et nous risquerions fort d'être « marmités ». Que faire ? J'arrive à me déchausser. Je réchauffe mes pieds engourdis à la flamme d'une lampe à alcool solidifié et je les enveloppe dans ma ceinture de flanelle, enlevée à cet effet. Je tente vainement de faire sécher mes bas à la dite lampe : j'en ai trois paires aussi mouillés les uns que les autres.Nous patientons ainsi jusqu'au soir, grelottants et le ventre vide. Comme on ne peut arriver que la nuit aux avant-postes, nous n'avons la soupe que deux fois en vingt-quatre heures le matin vers trois heures et le soir entre huit et neuf heures. Décidément, nous sommes des « oiseaux de nuit ». C'est la nuit que tout se fait et le jour on se repose ... quand on le peut.
* * *
La soupe arrive enfin, et avec elle - fâcheuse coïncidence - une averse d'une violence inouïe. On se touche sans se voir. Le plus amusant, c'est lorsque le caporal veut faire sa distribution, comme d'habitude. On tend les assiettes ou les gamelles vers lui. Il verse bravement, de confiance, la soupe... à côté, et l'on entend le pain trempé s'aplatir dans la boue. On prend le meilleur parti possible de la situation : celui d'en rire. Incident plus sérieux qui confine au désastre : dans l'obscurité, un « poilu » vient de renverser le seau de « pinard » dont le contenu presque en entier va rejoindre la soupe dans la boue. Décidément, nous jouons de malheur ...
* * *
Quelques jours plus tard, étant en sentinelle à la lisière du bois, de sept heures et demie à dix heures du soir, un orage très violent éclate vers huit heures, et je reste deux heures durant sous une pluie battante. Au plus fort de l'orage, une attaque se déclenche sur notre gauche. Spectacle passionnant et d'une beauté tragique. Eclairs et fusées déchirent l'ombre de lueurs sinistres. Tonnerre d'en haut et tonnerre d'en bas rivalisent de zèle. C'est un vacarme infernal, dans la nuit noire, sous une pluie torrentielle.
* * *
Le temps passe pourtant, et le printemps, indifférent à nos misères et à nos folies, est revenu comme jadis. Noté le 17 mars : vu le premier papillon. Les bourgeons gonflés de sève nouvelle sont prêts à éclater. Les talus sont étoilés (le perce-neige. Les oiseaux chantent comme des fous. Et le 15 avril : entendu le coucou. Le 22 mai enfin : il fait très doux ; une brise tiède et parfumée agite d'un léger frisson les feuilles d'un vert tendre et son souffle régulier arrive jusqu'à nous, doux comme une caresse.
CHAPITRE VI
FLIREY
(Mai -Octobre 1915)
PREMIERE PERMISSION : 9 AOUT 1915
Le 27 mai, nous sommes affectés au secteur de Flirey, à droite de celui de Seicheprey. Nous quittons également le secteur postal 120 pour prendre le S.P. 123. Pour les « poilus » qui aiment bien le « pinard », drôle de secteur que ce secteur 120. Finie pour quelque temps notre vie « d'hommes des bois ». Nous revenons à Hamonville. Cela nous paraît drôle de nous retrouver dans un village après deux mois et demi dans les bois. La moindre chose nous étonne : les maisons, les voitures qui passent... Nous sommes devenus comme de grands enfants.
Dans le nouveau secteur, le roulement est le suivant : trois jours de tranchées, trois jours de repos. En montant en ligne, les balles sifflent. Une de nos batteries tire tout près de nous et fait un vacarme infernal. On sursaute à tous les coups. Décidément, nos nerfs ont besoin de rééduquer. Encore quelques heures de cette musique et nous n'y ferons plus attention. Passons sous le viaduc du chemin de fer qu'on a fait sauter.
La gare de Flirey est là, à une centaine de mètres, presque entièrement démolie. Flirey, sur notre droite, n'est plus qu'un amas de ruines. Suivons un véritable dédale de boyaux pour parvenir jusqu'à nos emplacements dans la tranchée. La nuit, tout le monde veille, chacun à son créneau. Par l'ouverture du mien, sous la vague clarté de la lune, je distingue devant moi comme une sorte de cuvette très profonde. Est-ce un entonnoir creusé par l'éclatement d'une mine ? Impossible de m'en rendre compte exactement. A la pointe du jour, j'ai enfin la clef de l'énigme. Nous avons devant nous une des tranchées de la ligne de chemin de fer, profonde d'une quinzaine de mètres et fermée un peu plus bas par un mur de sacs à terre. La tranchée ennemie est en face sur l'autre talus, à une distance de quinze à vingt mètres. Obus crapouillots, bombes, rien ne manque ici. Les bombes font heureusement beaucoup plus de bruit que de mal. Pendant le jour, nous les voyons arriver, car elles vont très lentement. C'est le moment ou jamais de crier : « Gare à la bombe ! ou bien : « Bombe à droite ! Bombe à gauche ! » Et chacun s'abrite du mieux qu'il peut. Dans la nuit du 30 mai, elles n'en ont pas moins tué un camarade du 1578 à notre droite et blessé trois hommes de la 48 Section de notre Compagnie. La 24e Cie a eu deux morts les 14 et 15 juin, deux nouveaux arrivant du dépôt et allant aux tranchées pour la première fois, le second dans des circonstances peu banales. Ce dernier, devenu fou sans doute à la suite du bombardement, veut boire à tout prix de la limonade. Il enjambe le parapet de la tranchée et va se promener en bras de chemise entre les lignes, son bidon à la main. L'ennemi le laisse avancer, croyant avoir affaire à un déserteur. A mi-chemin, à peu près, le malheureux se ressaisit et fait mine (le vouloir revenir dans nos lignes. Eclair de lucidité qui devait lui être fatal. Car il est maintenant couché entre les lignes, tombé sous les balles ennemies.
* * *
Avec la fin juin, la fenaison bat son plein à Ansauville où nous sommes au repos. Les civils sont rentrés. Il manque, bien entendu, tous les hommes valides, comme partout. Heureusement les machines agricoles abondent ici et les soldats « donnent la main » aux habitants. Ils le font de bon coeur, bravement. Spectacle assez pittoresque que de voir des soldats en tenue (plus ou moins réglementaire, il est vrai) sur le siège des faucheuses, au milieu des prés. Cela nous fait oublier les misères présentes et nous donne l'illusion d'être là-bas, parmi les nôtres qui attendent.
Allons-nous bientôt les revoir ? Le 8 juillet, une grande nouvelle circule : nous irons sans tarder en permission de sept jours. Il partirait à chaque détachement six hommes par compagnie. On a dressé, dans chaque compagnie, une liste de 25 hommes, présents sur le front depuis le début sans avoir été évacués. Je figure sur la liste de la 20e Cie, et, sur ma demande avec le n° 19, c'est-à-dire en tête du quatrième convoi qui doit partir dans les premiers jours du mois d'août. Je serai ainsi à Pléaux au début des vacances et nous pourrons facilement nous réunir tous.
Les premiers départs ont lieu, pour le Régiment, les 13 et 14 et 15 juillet. Ces permissionnaires sont de retour le 26 juillet et nous font part de leurs impressions. A l'arrière, tout marche comme si l'on n'était pas en guerre, et personne n'a l'air de se faire beaucoup de « mauvais sang ».Mon caporal, Vizet Antony, du Falgoux, où j'ai eu le plaisir de le retrouver souvent par la suite, part en permission le 27 juillet et je le remplace comme fonctionnaire caporal à la tête de la Ire escouade.Puis mon tour de départ arrive enfin le 9 août. L'ami Figeac me prévient à 6 heures du soir pour partir à 7 heures. J'avais fait mes préparatifs pour monter aux tranchées le soir même. Changement de direction. Avec le sourire. Embarquement à Ménil-la-Tour le 10 août à minuit quinze. En attendant le train, on se couche sur le trottoir de la gare, à même le ciment, avec la musette comme oreiller.De cette première permission, tant attendue, je ne dirai rien, sinon qu'elle me parut bien courte. Pas plutôt arrivé, il fallait repartir. J'étais heureux certes de revoir tous les miens, mais, malgré moi, ma pensée s'envolait vers les camarades restés là-haut, dans cet enfer qu'il me faudrait rejoindre dans quelques jours.C'était comme une idée fixe dont je ne parvenais pas à me débarrasser et qui gâtait toute ma joie.Et pourtant, avais-je le droit de me plaindre à côté de ce camarade de la 1Pe section, parti en même temps que moi, et que j'ai rencontré dès mon retour le 24 août ? Il partait sachant sa femme malade. Il est arrivé à Paris à 2 heures du matin : sa femme est morte à 9 heures. Il a tout juste eu le temps de la voir, de lui parler et (le l'embrasser.« Je crois bien, me disait-il, qu'elle m'attendait pour mourir. »Il l'a enterrée et est venu reprendre sa place parmi nous, laissant chez ses beaux-parents son petit garçon âgé de trois ans.
CHAPITRE VII
CAPORAL EN CHAMPAGNE
(ter octobre 1915)
A mon retour de permission, le 339e occupe toujours le même secteur et la même vie recommence.
Le 31 août 1915, je suis nommé caporal à la 3e escouade de la 19e Cie. Sur ces entrefaites, Figeac est évacué, à Vaucouleurs, pour une pneumonie double. Cela a rendu un peu moins pénible mon départ de la 208. Me voici tout à fait installé dans mes nouvelles et hautes fonctions. Cela marche très bien. J'ai, paraît-il, une escouade de choix. Mes « poilus » sont de braves gens, bien pacifiques, presque tous cultivateurs, ce dont je suis enchanté, appar. tenant pour la plupart aux classes 1896, 1897 et 1898. L'un d'eux, nommé Salvan, est père de cinq enfants dont l'aînée, une fille, a dix-neuf ans. Il me dit souvent : « Si c'était un garçon, il serait mobilisé comme moi, et nous pourrions être ensemble. » Les autres ont tous deux ou trois enfants. On peut donc dire que c'est l'escouade de gens raisonnables. Par la suite, j'ai reçu un renfort de jeunes gars de vingt ans. Ils avaient envie de rire et de « chahuter », au grand désespoir des vieux « pépères » qui les traitaient de « gosses ». N'auraient-ils pas pu être leurs pères ? L'amalgame présentait quelques difficultés. Une bonne volonté réciproque nous permit d'en venir à bout.
La vie aux tranchées n'est maintenant pas trop dure pour moi. Depuis quelque temps, mon escouade ne prend pas le service de sentinelles pendant la nuit. Elle ne fait que travailler en première ligne durant toute la journée : construction d'abris-caves à deux ou trois mètres sous terre, aménagement des tranchées, creusement des boyaux de communication. Mon rôle consiste à indiquer les travaux à faire, la façon de s'y prendre, et à en surveiller l'exécution. Je suis, en quelque sorte, chef de chantier, avec une dizaine d'ouvriers sous mes ordres. En avons-nous remué de la terre pendant cette période ! C'était malgré tout le bon temps. Il ne devait pas durer.
Le 1er octobre 1915, nous quittions le secteur de Flirey pour aller en Champagne par le train. Du 3 au 6 octobre, nous bivouaquons au camp de Châlons. Je mange là, pour la première fois, du cheval. Un malheureux « canasson » des artilleurs vient d'être tué par un obus. Comme un vol de corbeaux, une nuée de « trouffions » s'abattent sur lui, le dépècent à qui mieux mieux. Jamais distribution ne fut si rapidement faite. Du 6 au 14 octobre inclus, sommes en réserve dans les tranchées du Moulin de Souain. Le 9 octobre au matin, nous faisons connaissance avec les gaz lacrymogènes et suffocants (voir communiqué officiel du 9 octobre, 15 heures). Sans grands résultats d'ailleurs. Mais nous n'avions pas besoin d'oignons pour pleurer. Durant cette offensive de Champagne, nous étions, paraît-il, troupes de poursuite, avec Vouziers comme objectif. Nous devions nous arrêter bien avant. La percée escomptée ne s'est pas faite. Les premières lignes ont été enlevées sans trop de mal. Mais par la suite, du côté de Somme-Py, les vagues d'assaut ont dû s'arrêter devant des réseaux de « barbelés » intacts et ont été décimées par les mitrailleuses ennemies. L'offensive avait échoué. Pourtant, quelle accumulation de matériel ! Par endroits, les canons se touchent, et il faut entendre ce vacarme ! Du 15 au 20 octobre inclus, nous tenons les tranchées de première ligne à la ferme Navarin. Pendant les nuits, nous avançons même notre ligne en creusant de nouvelles tranchées sous la protection de sentinelles. Des morts et des blessés, mais relativement peu nombreux. En plein jour, sur la crête nord, devant nous, un camarade d'en face a l'air de nous surveiller. Je tire dans la direction et il disparaît. C'est un des rares coups de fusil que j'ai eu l'occasion de tirer au cours de quatre ans de guerre. Après quinze jours consécutifs de tranchées (première et deuxième lignes), nous sommes relevés le 21 octobre et prenons quelques jours de repos à Suippes. Nous sommes blancs comme des meuniers. Mais tout de même cela vaut mieux que la boue de la Woëvre. Il est vrai de dire que nous n'avons pas eu une goutte de pluie depuis le 4 octobre, c'est-à-dire depuis près de trois semaines. Par exemple, cette poussière de craie fatigue, à la longue, les bronches et les poumons et gêne fort la respiration. Suippes est une coquette petite ville, à demi cachée dans la verdure. Elle a malheureusement souffert du bombardement. Les civils ont été évacués au moment de l'attaque et ne sont pas encore revenus. Il y a ici de l'eau en abondance et nous sommes bien heureux de pouvoir nous nettoyer à notre aise et laver notre linge.C'est avant de quitter Suippes, le 27 octobre, que j'apprends ma nomination comme caporal-fourrier à la 230 Cie : capitaine Aigueparse, de Saint-Cernin ; sergent-major Vialard, d'Aurillac.Nous revenons en Lorraine pour une période de grand repos : deux mois environ, dont un à Toul, caserne Ney, l'autre à Laneuveville-Derrière-Foug, petit village à dix kilomètres de tout. C'est un repos bien gagné après quinze mois de tranchées.
CHAPITRE VIII
GRAND REPOS A TOUL
Depuis notre entrée en caserne, et du fait de mes nouvelles fonctions, je suis devenu un bureaucrate dans toute l'acception du terme : un parfait « rond-de-cuir ». C'est un véritable déluge de petits papiers à faire, d'états à fournir, de contrôles, aussi variés qu'inattendus.
Dans chaque compagnie, les sous-officiers ont formé une « popote ». Mon grade de caporal-fourrier, assimilé à celui de «sous-off », me vaut l'honneur d'y être admis. C'est même moi qui, pour le moment, tiens la « queue de la poêle ». Heureusement pour les camarades, je n'ai pas l'intention de la faire danser.
Par la suite, les sous-officiers du Régiment de Territoriaux, dont un bataillon est avec nous à la caserne Ney, ont bien voulu nous accepter à leur table. Nous y sommes très bien. C'est bien tenu, très propre. La cuisine, sans être raffinée, est bonne. Et puis, nous avons de véritables assiettes, des verres au lieu de quarts, des bouteilles à la place du bidon, une salière sur la table, un pot de moutarde : c'est plus qu'il n'en faut pour être heureux ... Nous versons aux territoriaux tous les vivres que nous recevons de l'ordinaire. Comme nous ne touchons qu'un quart de vin par repas, c'est-à-dire demi-litre par jour, nous payons l'autre demi-litre au « mess », qui nous le fournit moyennant une dépense journalière de six sous. Pour remercier les camarades territoriaux d'avoir bien voulu nous donner l'hospitalité, nous leur avons offert le vin vieux, le jour de notre arrivée. L'un de nous a pris la parole pour leur dire en deux mots notre gratitude. Un vieux territorial, à barbe blanche et à lunettes, a répondu par quelques mots bien sentis. Après nous avoir dit tout le plaisir qu'il éprouvait à se trouver au milieu de camarades plus jeunes venant du front, et nous avoir souhaité la bienvenue parmi eux, il leva son verre à notre santé à tous, à celle de nos familles dont « quelques-unes ont, peut-être, été déjà cruellement frappées », dit-il, à la victoire finale enfin qui nous permettra de reprendre nos places dans nos foyers. Il était très ému ; sa voix tremblait comme s'il allait pleurer. Cela nous avait tous profondément remués. Nous fûmes leurs hôtes jusqu'au 6 décembre 1915, date à laquelle nous partîmes pour Laneuveville, village de deux cents habitants. Les gens sont très gentils pour nous. Ayant été chargé de « faire le cantonnement », j'ai été heureux de trouver un lit, non seulement pour les officiers, mais pour chacun des sous-officiers de la Compagnie.
Nous avons ici presque l'illusion de la vie de famille dont nous sommes privés depuis si longtemps déjà. Nous passons de bons moments à nous chauffer au coin du feu, chez les paysans. On est heureux de causer avec des « civils » durant les longues veillées. On oublie ainsi, pendant un moment, les fatigues et les ennuis. Quelquefois, la conversation s'arrête soudain : la pensée vole ailleurs, là-bas, bien loin, vers la famille absente. Les « civils » comprennent, se taisent eux aussi, respectant notre silence. Parfois enfin, on se laisse aller aux confidences réciproques. C'est si bon de parler des absents! Il nous semble que nous sommes plus près d'eux, avec eux...
CHAPITRE IX
RETOUR AU BOIS DE SAULCY
(10 janvier- 15 mai 1916)
Si nous emportions un bon souvenir des longues veillées d'hiver à Laneuveville, il n'en était pas de même des manoeuvres et exercices exécutés pendant des journées entières, sous une pluie torrentielle, imperméables roulés sur le sac, dans des terres labourées, parfois même ensemencées, au grand détriment des récoltes.
Aussi avons-nous rejoint sans trop de peine, le 10 janvier 1916, notre ancien secteur du Bois de Saulcy, après un très court séjour dans le Bois de la Reine.
Nous sommes d'abord en réserve dans un des nombreux villages abandonnés à l'arrière du front. Dans quel état lamentable se trouvent ces malheureux villages qui ont dû être évacués par leurs habitants ! Non pas qu'ils aient beaucoup soufferts du bombardement. Quelques obus de temps en temps : des toits éventrés, quelques pignons démolis ou percés à l'emporte-pièce. En somme, peu de mal, vus du dehors. Mais si l'on pénètre à l'intérieur des maisons, le spectacle est navrant. Les armoires sont ouvertes et vides ; les vêtements, le linge traînent sur le plancher où ils voisinent avec la paille de couchage. De la paille également dans les lits, parmi les matelas et les édredons éventrés. Sur les murs nus restent accrochés, témoins muets du désastre : ici, une image¬ souvenir de première communion ; là, un certificat d'études encadré. C'est profondément triste. En ligne, le régime est le suivant : quatre jours de tranchées, quatre jours de repos. Le secteur est des plus calmes. Le plus souvent, rien à signaler. Un jour, cependant, un incident tout à fait regrettable a attristé la Compagnie. Le 27 janvier 1916, un misérable, venu du 252e, après avoir été condamné à cinq ans de travaux publics, est passé à l'ennemi. Le commandant Nerlinger a flétri cet acte inqualifiable dans les termes suivants « Un homme du Bataillon a déserté ce matin : c'était une fripouille, c'est un criminel maintenant. Il sera fusillé à son retour en France, après la Victoire. Le commandant tient à adresser toutes ses félicitations à l'homme en sentinelle qui, s'apercevant de la faute qui allait rejaillir sur le Bataillon, a tiré de suite sur le déserteur et a crié aux voisins de tirer également. Un homme qui abandonne son Pays actuellement est, je le répète, un criminel. » Le commandant du 6e Bataillon. Signé : NERLINGER.
Le 31 janvier, à Broussey, vaccination anti-typhoïdique qui me fait beaucoup souffrir. Le 10 février, je remplace le sergent-major Vialard parti en permission. Je touche le prêt pour le distribuer aux camarades de la Compagnie que je vais rejoindre aux tranchées. Il ferait bon venir m'arrêter en route car je pars seul, porteur d'un millier de francs environ. Je n'ai jamais été aussi riche. Il est vrai que cela ne m'avance pas à grand'chose, car de tout cet argent, il ne me restera que sept francs vingt centimes, mon prêt de caporal-fourrier. Le prêt ayant été augmenté courant octobre 1915, les petits « soldats d'un sou » sont devenus les « poilus de cinq sous ».
Je pars pour ma deuxième permission le mardi 22 février 1916, et m'embarque à Sorcy (Meuse), le 23 février à minuit 46. Il était temps car, le 25 février, les permissions sont suspendues à la suite de l'attaque allemande sur Verdun. De cette deuxième permission, je revois surtout le moment du départ pour retourner au front. Je revis ces minutes pénibles qui durent des heures. J'entends encore les cris de gaieté factice et forcée des camarades cherchant à s'étourdir, gaieté à l'origine de laquelle le roi Pinard n'était pas étranger, et qui me faisait mal. Il neigeait, il faisait froid et je repartais ... Mon coeur grelottait à l'unisson...Rentré de permission le 5 mars, je monte aux tranchées le 6. Pas de changements : hommes et choses sont toujours à la même place, dans ce même bois de Saulcy où nous sommes venus, pour la première fois, il y aura un an le 10 mars. Comme l'an dernier, nous y verrons pousser les feuilles et nous y cueillerons le muguet aux blanches clochettes. En attendant, nous sommes en première ligne à la lisière d'un petit bois de sapins bordant la route de Bouconville à Apremont. Notre habitation est souterraine. Elle se trouve juste sous la route. C'est un couloir d'une dizaine de mètres de long : dix marches y donnent accès. De chaque côté, des lits superposés comme dans les navires : c'est là que nous couchons. L'humidité nous pénètre et l'ensemble manque un peu de confort.
Dans le bois, par contre, il fait un temps superbe. C'est le plein jour, le soleil brille ; ici, la nuit sans fin qu'éclaire seule une vieille lampe fumeuse ou une bougie de guerre ayant toujours besoin de moucher. Au dehors, règne une douce chaleur ; ici, un courant d'air continuel et fort désagréable. En haut, les oiseaux chantent le printemps revenu ; en bas, quelque rat grignote, dans son coin, un morceau de pain sec qu'il nous a dérobé. Ce réduit sert également d'abri pour le téléphone. Et nous nous endormons, bercés par les appels sans cesse répétés « Allô P 1 ! Allô P 2 ! » On s'y fait. Le 16 avril, un obus tombe en plein sur la « cagna » où se trouvent cinq hommes ; un blessé, un tué. Ce dernier avait eu déjà ses trois frères tués depuis le début de la guerre, et de cette famille il ne reste plus personne. Jusqu'ici, on remplaçait les hommes par du matériel. Ce sont des animaux qu'on charge maintenant de ce soin. Nous avions les chiens-ratiers, les chiens destinés à la recherche des blessés, ceux chargés d'assurer la liaison : nous avons désormais les chiens-sentinelles. Celui de la Compagnie s'appelle « Labro », du nom de son propriétaire. Il a été prêté pour la durée de la guerre. Il n'aboie pas sans raison, et son livret matricule est vierge de punitions. Nous avons également à la Compagnie un poste de P.V. (pigeons-voyageurs) au nombre de quatre. Ils sont relevés comme nous tous les quatre jours, c'est-à-dire lâchés et remplacés par d'autres. Il faut deux hommes pour soigner les quatre pigeons et un seulement pour le chien. Ces emplois sont des « filons ».
* * *
J'emploie mes rares moments de loisirs, quand nous sommes au repos, à donner des leçons aux illettrés de la Compagnie. J'ai une dizaine d'élèves. Aucun n'est complètement illettré, mais ils sont tous incapables de faire une lettre. L'un d'eux, le caporal Ladroit, qui sera blessé et décoré de la croix de guerre, le 13 juin à Avocourt, sait tout juste signer, sans même connaître les lettres qui forment son nom. J'avais demandé quelques syllabaires à la revue Les Annales politiques et littéraires. Une dizaine aurait largement suffi. Au lieu de me les faire adresser par une librairie quelconque, la direction a inséré dans le journal une note à ce sujet en donnant mes nom et adresse. Résultat : j'ai reçu des alphabets de tous les coins de la France, avec des lettres d'envoi vraiment touchantes. Je ne puis résister au plaisir d'en citer une parmi tant d'autres. J'en respecte le style et l'orthographe.
Tours le 13 mai 1916.
"Monsieur,
Maman étant une lectrice des Annales a su que vous désiriez apprendre à lire à de pauvres Poilus. Aussi moi qui suis une petite fille de sept ans et qui sait lire je vous fais don des deux livres dans lesquels j'ai appris à épeler. Je vous souhaite bon courage et complète réussite dans votre entreprise. " Thérèse BALDIN,
N'est-ce pas charmant ? J'ai reçu une vingtaine de colis de livres, dix fois comme il m'en fallait. J'en ai été d'autant plus embarrassé qu'ils me sont parvenus pour la plupart alors que nous changions de secteur, vers le 15 mai, faisant à pied, au cours de notre déménagement, plus de 125 kilomètres, par étapes journalières allant parfois jusqu'à 30 kilomètres. Evidemment, nies correspondants et correspondantes ne pouvaient prévoir cela, et je ne les ai pas moins remerciés bien sincèrement de leurs envois, dès que j'ai eu la possibilité de le faire.
CHAPITRE X
AVOCOURT - Mai 1916 A LA 37° DIVISION MAROCAINE (9-21 juin 1916)
Du 15 au 25 mai 1916, nous sommes, en effet, allés du Bois de Saulcy, dans la région de Commercy, jusqu'à Blainville, près de Lunéville, avec les étapes suivantes : Boucq, Pagny-sur-Meuse, Saint-Germain-sur-Meuse, Mont-le-Vignoble (trois jours de repos), Parey, Saint-Césaire, Roville, Blainville-sur-l'Eau. De Roville à Blainville, nous passons par Bayon où nous avons débarqué, le 22 août 1914, en arrivant au front. Huit jours de repos à Blainville, et, le 2 juin, nous nous embarquons à Einvaux pour débarquer, dans l'après-midi du 3 juin, à Villers-Daucourt, en Argonne.
L'Argonne est un pays accidenté aux mamelons boisés, pays pauvre : maisons en planches et en terre. Du moins dans la partie où nous nous trouvons. L'église de Le Chemin, où nous restons quarante-huit heures, est presque entièrement cons¬truite en planches, ainsi que le clocher et la maison d'école. Et notre promenade continue, mais plus courte cette fois. Le 5 juin, étape Le Chemin-Froidos ; le 6, Froidos-Brabant¬en-Argonne.
Brabant est occupé par la 37° Division marocaine dont nous allons faire partie avec le 2° Zouaves et le 3° Tirailleurs. Nous y remplaçons le 3° Zouaves, parti au front de Vaux. Très honorés, mais pas très rassurés. Pauvre 339° ! Séjour à Brabant du 6 au 10 juin. Le 9 juin, réunion dans l'église des officiers et sous-officiers du 339°. Le général Niessel commandant la 37e Division marocaine nous souhaite la bienvenue, et, craie en main, devant un tableau noir installé au milieu du choeur, nous présente le secteur que nous allons occuper. Et il a l'air de le connaître. Ce n'est pas étonnant. Nous aurons souvent, par la suite, l'occasion de le rencontrer, à toute heure de la nuit, dans les boyaux et tranchées de première ligne, les poches bourrées de paquets de cigarettes qu'il distribue aux poilus. Il se présente ensuite « aux hommes » sur lesquels il fait très forte impression. « Regardez-moi, c'est moi, Niessel ! » leur dit-il. Allures de dompteur, gros ascendant sur les troupes auxquelles il inspire confiance : c'est un chef. Nous abordons le secteur d'Avocourt par le ravin des Eventaux, formant une sorte de tranchée naturelle, boisée et non encore repérée, où nous sommes en réserve les 11 et 12 juin. Du 13 au 19 juin, en première ligne à Avocourt, tranchée des Rieux. Les boyaux sont pleins d'eau et l'on patauge dans la boue jusqu'à mi-jambes. Les tranchées s'éboulent par monceaux. Nous sommes entièrement recouverts de boue gluante. Cela nous rappelle les beaux jours de l'hiver 1914-1915. Et il pleut, il pleut sans discontinuer ! A part ça, le moral est bon : « Les troupes sont fraîches. ». Et je suis, une fois de plus, convaincu que l'homme est le plus résistant des animaux. Le 19 juin, onze heures durant, de sept heures à dix-huit heures sans interruption, tir de destruction sur nos tranchées, continu, méthodique, très précis, avec des obus de gros calibres. Tranchées et boyaux sont comblés sur de grandes étendues : par endroits, on les chercherait vainement. Heureusement les abris ont tenu bon. Bilan pour la Compagnie de nos onze jours à Avocourt trois tués et neuf blessés.
CHAPITRE XI - CHATTANCOURT - LE MORT-HOMME (Juillet 1916)
Quittons la Division marocaine le 21 juin. Après des séjours de durées diverses à Récicourt, Triaucourt et Julvécourt, le 6 juillet, nous occupons les tranchées Chattancourt-Le Mort-Homme. Pendant notre séjour de six mois et demi dans le secteur de Verdun rive gauche (Mort-Homme, Cumières, Chattancourt, Côte 304), le roulement sera le suivant : six jours de tranchées, six jours de repos, à Sivry-laPerche, à Blercourt et surtout au camp des Clairs-Chênes, situé le long de la route nationale et de la voie ferrée Sainte-Menehould-Verdun. Le camp est formé par de nombreuses baraques en planches, dans lesquelles nous sommes logés à raison d'une centaine d'hommes par baraque. A noter, au cours de ces diverses périodes de repos, la fête du 14 Juillet 1916, à Sivry-la-Perche. Menu : Jambon aux petits pois, un litre de pinard, gâteaux, une bouteille de champagne à quatre, un cigare de deux sous chacun. Au dessert, chansons variées. Le 3390 reste encore, à cette époque, un régiment d'Auvergnats, ces derniers formant au moins les trois-quarts de son effectif. Aussi les chansons patoises dominent-elles : Lo Marseillaiso dis Courdounie de Loroquo, Lo Cobretto, Los papas, Regrets, etc. Des airs de cabrette alternent avec les chants. On danse la bourrée. J'y vais de la mienne ... Aux Clairs-Chênes, on s'ingénie aussi à nous distraire. Retraite en musique par la clique du 48'. Concert par la musique militaire du 480, puis par celle du 339' (36 exécutants). Au programme, pour cette dernière : La Brabançonne, l'Hymne russe, l'Hymne anglais, sans oublier notre vieille Marseillaise que tout le monde écoute tête nue. Cependant les poilus en ont « marre » et commencent à manifester leur mécontentement. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1916, au 339', cris de : « A bas la guerre ! » et chant de l'Internationale. Manifestation sans gravité. Sanctions anodines : quinze jours d'arrêts au sergent de garde, de la 22e, ainsi qu'à trois adjudants de la 13' et de la 140 ; le sergent-major de la 130 est rétrogradé et nommé sergent à la 19'. C'est tout. Et le repos fini, nous remontons en première ligne, Gros-Jean comme devant. Dame, il faut bien ! Des tranchées du Mort-Homme, nous apercevons une partie de la rive droite : côte du Poivre, FroideTerre, fort de Souville, et, en arrière, à l'horizon, le fort de Douaumont et le fort de Vaux. Dans la vallée, la Meuse et le canal, la ligne de chemin de fer ; à nos pieds, sur la rive gauche, Cumières et Chattancourt : deux monceaux de ruines. Sur la rive droite, toute la journée les crêtes fument comme si elles étaient en feu. On dirait des volcans en éruption. La nuit, elles s'illuminent au départ des coups et lors de l'éclatement des obus. Des fusées montent sans interruption, blanches, rouges, vertes. Le 10 juillet, sommes violemment bombardés avec des « gros ». Le sol en est ébranlé, les abris, mal faits, à peine étayés, avec une seule ouverture, sont de véritables souricières et se changent vite en fosses communes. Le 11 juillet, vers huit heures, un avion français survole les lignes ennemies. Il est fortement canonné. Le danger est d'autant plus grand pour lui qu'il vole très bas. Il n'a pas l'air de s'en émouvoir outre mesure. Sous un coup mieux ajusté, un morceau de l'appareil se détache. L'oiseau blessé bat de l'aile et se retourne complètement. Des papiers s'envolent. Il descend en tournoyant sur lui-même et vient s'abattre sur le sol, dans nos lignes, autant que nous pouvons en juger. Spectacle tragique. Le 21 juillet, étant en réserve à Froméréville, avons la visite du propriétaire de l'immeuble où nous sommes cantonnés. Il n'ose pas rentrer chez lui, et c'est nous qui avons dû lui faire les honneurs de sa maison qu'un obus a en partie démolie. Comme nous lui disons « Vous ne la trouvez guère en bon état ? » il nous répond « Mais c'est l'une des moins « amochées » du village, et puis, qu'est-ce que vous voulez ? c'est la guerre ! » Il est mobilisé dans un régiment d'artillerie des environs, au fort de Choiseul. Il part en permission à Barsur-Aube où sa famille s'est réfugiée, et a tenu à revoir sa maison avant son départ.
CHAPITRE XII - CUMIERES (5 août 1916)
EN PATROUILLE 5 août 1916 : Mauvaise journée pour la 238 Cie du 3398. Sommes dans le secteur de Cumières, tranchée des Seigles et voie ferrée. Cette dernière est en remblai d'un mètre environ au-dessus de la plaine. Le long de son talus se trouvent des trous recouverts de branchages et de quelques centimètres de terre. C'est là que nous restons couchés, sans faire un mouve¬ment, pendant dix-huit heures consécutives, de trois heures à vingt et une heures. Il est absolument interdit de se montrer pendant le jour pour laisser croire à l'ennemi que la voie ferrée n'est pas occupée. Il faut prendre ses précautions avant de rentrer dans nos tanières et se munir d'ustensiles ad hoc. Dans l'après-midi du 5 août, la tranchée des Seigles (emplacement de la 38 et de la 48 Section) est violemment bombardée. La 48 Section seule a souffert. Les obus tombent en plein dans la tranchée. Fouillac a un bras complètement déchiqueté. Le caporal Escarrié, la figure brûlée, aveuglé par un obus qui éclate juste devant lui, saute par-dessus la tranchée, comme un fou. Delcher, grièvement blessé à la tête et à une jambe, est tué par un deuxième obus, d'un éclat à la tête, dans les bras du sergent Galaud qui le soigne et n'a aucun mal. Dumas, très gravement atteint, affolé, supplie le lieutenant Serre de lui faire une place dans son abri. Comme il n'y a de place que pour un, le lieutenant lui cède la sienne et reste à découvert dans la tranchée. Le pauvre Rongier tient dans ses mains son ventre ouvert. Paulhac dit : « Vous voyez bien que je suis coupé en deux et que je vais mourir ! » Spectacle horrible ! Dévouements sublimes ! A la 30 Section, le petit poste du ruisseau de Cumières tombe dans une embuscade en allant occuper son emplacement de nuit. Il est accueilli par une fusillade : trois blessés dont le sergent Devez, deux disparus, Bruyère et Barbet, probablement prisonniers. Un seul des hommes du P.P., Pigeyre, doit à une chute dans le ruisseau de revenir sain et sauf. A la 1" Section, ce jour-là, à l'aube, nous faisons deux prisonniers, un sous-officier et un soldat, tous deux décorés de la croix de Fer. Ils venaient en patrouille et, s'étant trop avancés, sont tombés sur la Section. Mis en joue par Loubaresse qui, seul, les avait vus, ils crient : « Camarades ! » et se constituent prisonniers. Ils passent toute la journée, chacun dans un trou, sous bonne garde, et ce n'est qu'à la nuit qu'on peut les interroger et les emmener. Scène comique avec Fageolles qui empêche un des prisonniers de sortir pendant le jour et l'oblige à « faire pipi » dans une de ses bottes. Bilan de cette triste journée pour la 230 Cie : sept morts, sept blessés, deux disparus supposés prisonniers. Il faut venger l'échec subi par notre petit poste du ruisseau en enlevant le petit poste ennemi qui lui fait face. La 230 Cie est chargée de l'opération, avec une forte patrouille sous les ordres du lieutenant Tarascon : seize hommes à raison d'un par escouade. Le système consistant à désigner un homme par escouade présente des inconvénients. On décide de faire appel aux volontaires. Dix se présentent, dont trois agents de liaison. L'un d'eux, Vizet, est père de quatre enfants et a déjà eu deux frères tués à l'ennemi. Ce n'est pas sa place. Je le dis au capitaine Puvis, en le priant de me permettre de remplacer Vizet. J'insiste et obtiens satisfaction. Le soir même, je prends place dans l'équipe de patrouilleurs et, pendant toute la période de repos, nous nous entraînons à ramper dans l'herbe, sur le ventre et sur les genoux. *
Dès le retour en ligne, la tentative d'enlèvement du P.P. doit être précédée de patrouilles permettant de se rendre compte de son emplacement exact, de son effectif probable, des habitudes -de ses occupants. Les deux premières ont lieu le 10 août. J'en suis. Nous partons à 21 heures, en passant par notre petit poste. La marche en rampant sur le ventre et les genoux, en s'aidant des mains, commence dans l'herbe mouillée et dans l'eau. Nous sommes à la file indienne, les mains du dernier touchant les pieds de celui qui le précède. Baïonnette au canon, fusil approvisionné et armé, une cartouche dans le canon, huit dans le magasin, des grenades dans la poche de la veste. On rampe pendant deux ou trois mètres, puis l'on s'arrête pour écouter. Bruits de voix, de pelles. On avance encore. Trou d'obus dans lequel on se groupe. Nous approchons du but : le grand peuplier, emplacement supposé du P. P. ennemi. Du bruit sur notre droite. On s'arrête. Serait-ce une patrouille sur notre flanc qui menacerait notre retraite ? Nous faisons face à droite et attendons. Le bruit s'éloigne et nous reprenons la marche en avant. Nous arrivons dans un grand trou d'obus à quelques mètres du peuplier. Le bruit cesse de ce côté. On nous a sans doute entendus. Attente. En avant de nous, deux silhouettes sombres émergent par moments au-dessus de l'herbe, puis disparaissent. C'est la sentinelle double ennemie. Nous avançons jusqu'au pied du peuplier que nous dépassons. Les silhouettes devant nous apparaissent et disparaissent à une cadence plus rapide, comme inquiètes. Elles sont sur leurs gardes. Je les mets en joue au clair de lune. La tentation est bien forte, mais à quoi bon leur donner la certitude que nous sommes là ? Notre but est atteint en ce qui concerne l'emplacement du petit poste. Mais la patrouille qui est sur notre droite ne garde pas la même réserve. Elle tire sans discontinuer dans la direction du peuplier. Les balles sifflent à nos oreilles. Nous nous couchons dans le trou d'obus. Du bruit dans le buisson, au pied du peuplier, à moins de deux mètres de nous. Quelque rat sans doute. Nous écoutons encore un moment. Plus rien. Le ruisseau nous empêche de contourner le buisson pour l'explorer. Nous nous replions, selon la consigne reçue. En rejoignant notre patrouille de droite, nous apprenons qu'elle a vu les Allemands dans un trou d'obus, au pied du peuplier, du côté du buisson opposé à celui où nous nous trouvions. C'est alors que nous avons entendu le sifflement des balles sur nos têtes. Nous ne pensions tout de même pas les avoir si près. Nous rentrons vers une heure du matin, après un séjour de quatre heures entre les lignes. L'éveil ayant été donné et l'ennemi étant désormais sur ses gardes, la tentative de coup de main n'avait plus beaucoup de chances de réussir et fut abandonnée.
CHAPITRE XIII - COTE 304 (28 octobre 1916 -18 janvier 1917)
Occupons encore le même secteur en septembre et au début d'octobre. Courant septembre, je suis malade. Le capitaine m'oblige à aller à la visite. J'ai une forte fièvre. Le major veut m'évacuer pour courbature fébrile. La fiche d'évacuation est faite. C'est l'arrière, le repos ... Je refuse et demande seulement à être exempté de la prochaine période de tranchées. Je pourrai ainsi me reposer un peu et être en état de partir en permission. Car mon tour approche et je ne voudrais pas le laisser passer. Comme soins, la diète. Pendant plusieurs jours, je ne mange que des gâteaux secs arrosés de mousseux. Le régime a du bon, puisque, le 11 octobre, je peux me mettre en route pour ma troisième permission pendant laquelle j'achève de me remettre. Je garde un souvenir très doux de ces sept jours passés auprès des miens. Les moindres détails de ces quelques heures de détente me reviennent à la mémoire avec une précision, une netteté remarquables, inconnues pour moi jusqu'alors. Dès mon retour au front, je revis par la pensée ces bons moments et ce m'est une façon d'en goûter à nouveau tout le charme. trou d'obus à quelques mètres du peuplier. Le bruit cesse de ce côté. On nous a sans doute entendus. Attente. En avant de nous, deux silhouettes sombres émergent par moments au-dessus de l'herbe, puis disparaissent. C'est la sentinelle double ennemie. Nous avançons jusqu'au pied du peuplier que nous dépassons. Les silhouettes devant nous apparaissent et disparaissent à une cadence plus rapide, comme inquiètes. Elles sont sur leurs gardes. Je les mets en joue au clair de lune. La tentation est bien forte, mais à quoi bon leur donner la certitude que nous sommes là ? Notre but est atteint en ce qui concerne l'emplacement du petit poste. Mais la patrouille qui est sur notre droite ne garde pas la même réserve. Elle tire sans discontinuer dans la direction du peuplier. Les balles sifflent à nos oreilles. Nous nous couchons dans le trou d'obus. Du bruit dans le buisson, au pied du peuplier, à moins de deux mètres de nous. Quelque rat sans doute. Nous écoutons encore un moment. Plus rien. Le ruisseau nous empêche de contourner le buisson pour l'explorer. Nous nous replions, selon la consigne reçue. En rejoignant notre patrouille de droite, nous apprenons qu'elle a vu les Allemands dans un trou d'obus, au pied du peuplier, du côté du buisson opposé à celui où nous nous trouvions. C'est alors que nous avons entendu le sifflement des balles sur nos têtes. Nous ne pensions tout de même pas les avoir si près. Nous rentrons vers une heure du matin, après un séjour de quatre heures entre les lignes. L'éveil ayant été donné et l'ennemi étant désormais sur ses gardes, la tentative de coup de main n'avait plus beaucoup de chances de réussir et fut abandonnée. Je rejoins le 6° Bataillon du 3390 à Chaumont-sur-Aire, le 24 octobre 1916. Le régiment est resté au repos pendant toute ma permission. Du changement à la 23° Cie où le capitaine Puvis, bon comme un père pour ses hommes qui l'adorent, est remplacé à la tête de la Compagnie par le lieutenant Andrieu, un collègue de l'Aveyron, énergique et courageux, parti avec nous d'Aurillac comme sous-lieutenant à la 20°, à la mobilisation. C'est sous ses ordres que nous montons en ligne, à la Côte 304, le 28 octobre 1916. Quelle relève sous une pluie battante, par une nuit très noire, que rend encore plus noire une marche sous bois de plusieurs kilomètres ! On pourrait presque nager au lieu de marcher, tant il y a d'eau et de boue. Une moyenne de cinq centimètres, plus de vingt par endroits. Dans les ornières de la route, on y va jusqu'à la cheville et dans les trous d'obus jusqu'aux genoux, parfois davantage. Et il fallait voir ou plutôt entendre ces culbutes et ces plongeons ! Les tranchées sont dans un état épouvantable, auquel il est impossible de remédier. La terre trop mouillée ne tient plus les parois des tranchées s'éboulent, mettant à découvert, ici un bras, là une jambe. Impossible de creuser sans déterrer un cadavre. Ce coin de terre maudite en est truffé. D'autres sèchent, accrochés aux « barbelés », à quelques mètres en avant de nous. De ce charnier boueux, monte une odeur nauséabonde. C'est beau la guerre ! Par endroits, les lignes ne sont pas à plus de 25 mètres, quelques petits postes avancés à moins de 10 mètres. A cause de la boue des boyaux et des risques d'enlisement, les relèves se font en terrain découvert. Heureusement, on ne tire pas, par suite d'un accord tacite. La trêve de la misère... Nous vivons même en très bons termes avec nos voisins d'en face, pauvres diables comme nous, aussi malheureux que nous. Nous nous voyons d'une tranchée à l'autre. On se dit « Bonjour », sans la moindre rancune et des conversations s'engagent. En français, bien sûr, car nous ne connaissons pas l'allemand. Plusieurs d'entre « eux », par contre, parlent très bien le français. L'un, en particulier, qui était garçon de café à Paris avant la guerre, nous réveille tous les matins en chantant : Sous les ponts de Paris. Par exemple, lorsqu'un officier allemand survient, il nous fait signe de nous cacher. Mais pas le moindre coup de fusil. C'est l'union devant le malheur. Nous souffrons tous assez des éléments hostiles, sans ajouter nous-mêmes à nos misères par des fusillades à bout portant ou des jets de grenades qui rendraient les tranchées intenables. Les relèves, avec de longs trajets dans la boue, sont si pénibles que nous faisons de longs séjours en première ligne huit, dix et même quinze jours consécutifs. Nous restons pendant tout ce temps-là les pieds dans l'eau, véritables paquets de boue ambulante, le ventre vide bien souvent, n'ayant à manger que des aliments froids qu'il faut saisir avec des mains pleines de boue, avalant ainsi autant de terre souillée que de pain. Se laver avec la boue n'est pas chose facile... Nous sommes exténués, nous avons froid. En deux jours, à la 23° Cie, treize hommes sont évacués pour pieds gelés. Durant une période de tranchées, en décembre 1916, plus de deux cent cinquante hommes ont été évacués dans le Régiment, ce qui représente presque l'effectif actuel de deux de nos compagnies. Je tiens bon. N'ai-je pas annoncé que je voulais me racheter d'avoir été un mauvais soldat pendant « mon active » ? Le 19 novembre, le lieutenant Delzons, d'Aurillac, un parent du général de l'Empire Delzons, dont la statue se trouve au bas du Gravier, prend le commandement de la 23 Dans l'après-midi du 17 novembre 1916, quelques obus tombent en avant et en arrière de notre tranchée. Le tir devient de plus en plus précis. Un obus de gros calibre tombe en plein sur l'entrée de l'abri du lieutenant et la bouche complètement. Vite aux pelles et aux pioches ! Le bombardement continue très violent pendant le travail de déblaiement. Un obus tombe à côté de nous, dans le parapet de la tranchée, mais, heureusement, n'éclate pas. Nous faisons semblant de ne pas l'avoir entendu et piochons de plus belle. On nous apporte enfin une barre à mine. Je l'enfonce à l'endroit supposé de l'entrée de l'abri. Après une certaine résistance, je sens enfin le vide. Un coup de levier : le trou s'agrandit par lequel l'air pur pénètre. Personne ne répond à nos appels. Dans l'angoisse, les coups de pioche redoublent. Un trou est fait, assez grand pour livrer passage à l'infirmier. Il n'est que temps. Des trois occupants de l'abri (le lieutenant Delzons, son ordonnance et un téléphoniste), l'ordonnance a déjà perdu connaissance. Après quelques minutes de soins, il revient à lui et en sera quitte avec la peur. Un deuxième obus de gros calibre tombe à trois mètres (le nous pendant la fin du travail, mais il n'éclate pas non plus. Nous avons vraiment de la chance, car nous aurions pu être tous « nettoyés ». Au cours de la période suivante de tranchées (28 novembre¬8 décembre), le 6 décembre 1916, je suis légèrement blessé à la main gauche par un éclat d'obus. Ce qui me vaut la citation suivante à l'ordre du Régiment: Extrait de l'ordre du Régiment n° 171 Le Colonel cite à l'ordre du Régiment PARRA Pierre, classe 1904, N° Mle 017544, caporal-fourrier de la 23' Cie. « Le 6 décembre 1916, pendant un violent bombardement, « a tenu à rester à son poste d'observation bien qu'ayant été « atteint à la main par un éclat d'obus. « Le 13 décembre 1914, est allé entre les lignes et malgré « une vive fusillade, chercher un officier grièvement blessé, « alors qu'un de ses camarades venait d'être tué dans la même tentative. » S.P. 120, le 13 décembre 1916. Le lieutenant-colonel FOURLINNIE, commandant le 339e Régiment d'Infanterie. Signé : FOURLINNIE. La citation est datée du 13 décembre 1916, deux ans exactement après l'affaire du 13 décembre 1914. Ma proposition de citation comprenait un troisième paragraphe concernant le sauvetage du lieutenant Delzons. Ce paragraphe a été supprimé. C'était, paraît-il, trop long. Et, de fait, c'est bien suffisant ainsi. Cette période de tranchées prit fin le 8 décembre. Au moment de la relève, belle course à travers le terrain défoncé et percé de trous d'obus comme une écumoire, pour franchir la zone dangereuse, battue par les tirs de barrage, le fameux « ravin de la Mort » dont s'honorent de nombreux secteurs. J'ai vécu là quelques minutes inoubliables, et qui m'ont paru d'autant plus longues que, peu de temps avant notre passage, un camarade venait d'y être décapité par un obus. Pour comble de malheur, en courant, je m'accroche dans le réseau de fil de fer barbelé et je n'arrive pas à me dégager. Naturellement, c'est juste à l'endroit le plus dangereux. Je me démène comme un beau diable. Mon pantalon en sait quelque chose. Une jambe presque entière y est restée. Avec quelques accrocs dans la « doublure », par-dessus le marché. Mais ce n'est pas tout. Mon ami Merle, sergent-fourrier à la Compagnie, a préféré suivre le boyau au lieu de passer en terrain découvert. Nous devons nous retrouver à la sortie du boyau. Je l'attends un long moment. Personne. Je retourne en arrière en longeant le boyau à découvert. Et je trouve mon Merle, enlisé dans la boue jusqu'au derrière, et ne pouvant plus ni avancer, ni reculer. Je lui tends la crosse de mon fusil. Il s'y cramponne des deux mains, comme le naufragé à sa planche -de salut. Je tire de toutes mes forces sur la bretelle et le canon, et réussis à le tirer de sa périlleuse situation. Depuis ce jour-là, il a une aversion particulière pour les boyaux pleins de boue. Nous avons passé aux tranchées le jour de Noël, ainsi que celui du 1"" janvier. Le colis de Noël, apporté par un permissionnaire, le brave Antoine Hourtoule, de Pléaux, me rappelle la maison et tous les miens auprès desquels je suis, par la pensée, en ce jour de fête familiale. Drôle de Réveillon ! Dans la nuit du 31 décembre 1916 au 1er janvier 1917, je me revois, avec quelques camarades, dans l'abri du lieutenant Delzons, assis sur les marches boueuses de l'escalier où dégouline en cascade, entre nos jambes, un ruisselet d'eau jaunâtre que reçoit un puisard, trop vite rempli, et qu'il faut ensuite vider avec des boîtes de conserves. Sur le coup de minuit, le lieutenant Delzons se lève et d'un ton solennel « Messieurs, je vous souhaite unes bonne année ! » Nous nous sommes serrés fraternellement la main. Je m'en souviendrai de cette scène-là, ainsi que de notre séjour de trois mois à la Côte 304. Le 18 janvier 1917, nous quittons définitivement ce secteur qui nous a valu tant de souffrances. Quand nous en avons appris la nouvelle officielle, quelle explosion de joie, quel cri de délivrance ! Il me semble que nous ne serons pas plus heureux quand on nous dira « La guerre est finie ! Allez-vous-en !"
CHAPITRE XIV - VAUQUOIS ET AVOCOURT (Janvier - Août 1917)
Après huit jours de repos bien gagné, le 25 janvier 1917 nous nous mettons en route pour le secteur de Vauquois. Secteur tranquille maintenant après être resté longtemps agité. Secteur organisé où nous disposons de bons abris et de l'avantage inappréciable d'avoir les cuisines à proximité, ce qui nous permet de manger chaud. Nous en sommes doublement heureux : d'abord parce que nous en avons été privés pendant les trois mois de séjour à la Côte 304, ensuite à cause du froid glacial qui règne au cours de cet hiver 1916. 1917. Pour la première fois, j'ai vu distribuer avec une pelle le vin transformé en glaçons. Une épaisse couche de neige durcie couvre le sol. Heureusement nous sommes au milieu des bois, le combustible ne manque pas et nous faisons de bons feux. Au cours d'une relève, notre tranchée se trouve, paraît-il, rue de l'Eglise. De cette dernière, on chercherait vainement l'emplacement. Il ne reste pas une pierre sur l'autre. A peine quelques tas de menus cailloux, tout juste bons pour empierrer les routes. C'est que la guerre de mines a sévi ici avec la plus grande intensité. Elle explique tous ces bouleversements qui auraient eu, paraît-il, pour résultat une diminution de quatre à cinq mètres de l'altitude du mamelon de Vauquois. Je suis descendu dans une galerie de mine avec les sapeurs. C'est à celui des deux adversaires qui sera le plus tôt prêt et fera sauter l'autre. Minutes angoissantes passées à écouter, oreille contre terre, les coups de pioche du « copain », pour savoir le degré d'avancement de son travail. Moins impressionnantes cependant que le silence complet, inquiétant, prouvant que la tâche est terminée en face, la mine prête, et qu'on peut s'attendre à sauter d'un moment à l'autre ... Le 30 janvier 1917, départ pour ma quatrième permission neuf jours au lieu de sept, à cause de ma Croix de Guerre. J'en passe les veillées au coin du feu, dans le vieux « canton » de Vaissière. Parfois, accroupi devant le feu, je surveille la cuisson des pommes dans la cendre. Elles se rident ou éclatent, laissant s'écouler leur jus sucré. Comme ferait un enfant, je me brûle pour les retourner et toute la famille rit (le me voir faire. Heures calmes et douces, trop vite passées. Suis de retour au front le 14 février. Pendant ma permission un tué à la 23° ; à la 22', sept prisonniers dont deux blessés, à la suite d'un coup de main. Le 17 février, le lieutenant Andrieu, promu Capitaine, reprend le commandement de la 23°. Pendant son séjour à l'école des commandants de Cie, il avait été remplacé par le lieutenant Marraud. En première ligne du 18 février au 6 mars, alertes fréquentes surtout pour les gaz. Heureusement ce ne sont jusqu'ici que de fausses alertes. Mais il est prudent de se méfier et de prendre ses précautions. Le bruit est tel, pour nous prévenir, que les sourds peuvent entendre. Un tintamarre de tous les diables. Cloches, sirènes, clairons, douilles de 75, plaques de tôle sur lesquelles on frappe à coups redoublés avec un bâton ou une barre de fer. On se croirait à « ténèbres », le jour du Jeudi-Saint, ou mieux à un charivari monstre pour mariage de veufs. Les signaux se répètent à droite, à gauche, en arrière, et le vacarme gagne de proche en proche. On sait ce que cela veut dire. Rapidement les masques, dont le port est obligatoire, sont ajustés. Figures de Carnaval. Et l'on voit aller et venir tous ces « travestis », munis de leurs groins. Plus moyen de se reconnaître, et il se produit parfois des méprises amusantes. Mais dans l'alerte aux gaz, malgré la note comique, le tragique ne perd pas ses droits. Chacun saute sur son fusil. Une fois prêt, on attend qu'ils viennent ; les gaz d'abord, les « camarades d'en face » ensuite, et tout le monde est bien décidé à leur faire une réception soignée. Le 15 mars, remontons aux tranchées pour une période de seize jours, sommes relevés le 30 mars. A la 23°, le sergent-major Vialard est remplacé par l'ami Genton, une vieille connaissance. Malade, je ne monte pas en ligne le 7 avril, et, par la suite, je remplis les fonctions de sergent-major, au départ de Genton en permission. Le 25 avril, le commandant Nerlinger, nommé Lieutenant¬Colonel au 59e, nous quitte. Il est unanimement regretté. Le 30 avril, j'apprends avec peine la mort du camarade Pouget, instituteur à Pléaux. L'école de Pléaux a déjà payé un tribut bien lourd : deux tués, Pouget et Portefaix, un blessé grave, Delbos. A l'école primaire de garçons, en particulier, sur les trois maîtres mobilisés : Pouget, Delbos et moi, je reste seul à peu près indemne. Et je ne perdrai rien pour attendre. .. De telles nouvelles ne sont pas faites pour redonner du courage. Le 5 mai, par télégramme, m'en arrive une autre qui achève de me terrasser : celle de la mort du bon « papa Capmau », mon beau-père. Comme je voudrais être au milieu de tous les miens en cette pénible circonstance pour partager leurs peines et tenter de les consoler ! Hélas ! impossible d'obtenir une permission exceptionnelle. Je cherche à faire avancer le tour de ma permission régulière. J'y parviens dans une certaine mesure puisque le départ pour ma cinquième permission a lieu le 10 mai 1917. Elle fut bien triste cette permission, et dominée par le souvenir de notre cher disparu. Comme elle s'impose à notre mémoire et à notre affectueuse admiration cette noble et belle figure que nous ne reverrons plus. Quoi d'étonnant, ma chère Louise, si nous avons l'air soucieux sur la photographie prise à Laroquebrou, quelques minutes avant mon départ, ma permission finie ? Le 25 mai, je suis de retour aux tranchées mais cette fois dans le secteur d'Avocourt, en avant de la Buanthe et de la route d'Avocourt à Varennes-en-Argonne, à une dizaine de kilomètres à peine sur la droite de Vauquois. Notre nouveau secteur est très calme. Aussi les périodes en première ligne sont-elles longues : vingt-trois jours, du 14 juin au 7 juillet, puis dix jours de repos dans un bois. Nous n'avons eu pendant cette période qu'une dizaine de tués au régiment et vingt-cinq blessés. La 23e s'en tire assez bien avec seulement deux blessés. Notre principale occupation est la lutte contre les rats. C'est une véritable invasion. Il en sort de partout, et des gros à faire peur. La nuit, une fois couché, lorsque la lumière est éteinte, leur sarabande commence. Ils ne respectent rien et se promènent à qui mieux mieux sur nos pieds et nos jambes, voire sur nos figures. Pas moyen de dormir. Je me lève pour leur donner la chasse avec un bâton, et je laisse, en me recouchant, la bougie allumée, dans l'espoir de les tenir à distance. Peine perdue. Ils font main basse sur les provisions et, avec eux les colis passent de mauvais quarts d'heure. Nous les suspendons au plafond de notre abri. Pas besoin de se hausser sur la pointe des pieds pour y atteindre. Précaution nécessaire, mais pas toujours suffisante. Les rats constituent avec les poux un de nos grands tourments. J'ai rapporté des « totos » à chacune de mes permissions. Dans certains secteurs, ils nous dévorent. Nous nous grattons, même en dormant. Ce geste inconscient est devenu un véritable réflexe. Impossible de se débarrasser complètement de ces hôtes indésirables. En arrivant au repos, on change tout son linge que l'on fait bouillir. On prend une bonne douche. C'est parfait. Mais il faudrait en même temps passer tous les effets à l'étuve pour les désinfecter. Cela même ne servirait pas à grand chose, la paille des cantonnements qu'on change trop rarement en étant infestée. A peine s'y couche-t-on que le supplice recommence ... 14 juillet 1917. Nous sommes au repos. Le matin, revue et défilé. Au déjeuner, bombance habituelle. Dans l'après-midi, fête champêtre organisée par le 6e bataillon, sous la présidence du Commandant Gardet. Courses à pied, en sacs, sauts, jets de grenades, jeu de la poêle, concours de quilles, concours de bourrée, grande course finale ouverte à tout le bataillon : distance, 300 mètres ; cinq prix : cinq, trois, deux francs et un franc, versés aux concurrents rapportant une des cinq quilles placées à l'extrémité du terrain ; chaque quille porte un numéro indiquant la valeur du prix gagné. Un mât de cocagne est dressé en permanence, ascension libre. Si le concours de bourrée, qui donnait à la fête son caractère auvergnat, mérite une mention toute spéciale, l'article sensationnel, le clou du programme, bien que n'y figurant pas, fut sans contredit une course de mulets, improvisée à la demande du Commandant Laverrière faisant fonction de Colonel, et grand amateur des courses de chevaux. Les mulets sont têtus et parfois capricieux. Il n'était pas facile aux concurrents de la course de les conduire au but. Certains même prenaient une direction diamétralement opposée, malgré les efforts risibles de ceux qui les montaient. Ces derniers n'avaient pas de selles et il fallait les voir faire la culbute, tout le long du parcours. Comme la course avait lieu dans un pré, ils ne risquaient guère de se faire du mal. Nous avons bien ri. Ces heures de détente ne sont pas inutiles.
Août, mois des anniversaires : 2 août 1914, déclaration de guerre ; 17 août 1910, anniversaire de notre mariage. Sept ans déjà qui auraient pu être sept années de bonheur. La guerre nous en a pris trois pour les transformer en trois années de dures souffrances. Le « cafard » nous assaille parfois. Les caractères s'aigrissent. On commence à trouver le temps long. En verra-t-on la fin de cette maudite guerre ?
CHAPITRE XV - AU CENTRE D'INSTRUCTION DES ELEVES CHEFS DE SECTION (Septembre -Décembre 1917)
Ma désignation le 30 août 1917, pour aller suivre au camp de Châlons, un cours d'élèves chefs de section, arrivait bien à point. Pour la première fois, depuis plus de trois ans, j'allais être, non pas au repos, mais un peu à l'arrière, avec la possibilité de manger chaud, à des heures régulières, de me déshabiller chaque soir pour me coucher dans un lit, de me tenir propre et de pouvoir enfin me débarrasser des poux. Ce bien-être élémentaire paraît si naturel qu'on arrive à la longue à ne plus l'apprécier. Il faut en avoir été privé pendant longtemps pour en jouir pleinement. J'en avais bien besoin. Je n'ai cependant pas demandé à suivre ce cours qui aura pour première conséquence un retard de plus de deux mois de ma prochaine permission. J'ai été proposé par le Capitaine Andrieu avec le numéro un pour la 23' et désigné également avec le numéro un pour le 6e bataillon. Nous sommes trois du 339°, un par bataillon : Jouhannet, Hognon et moi. Arrivons au camp de Châlons le 31 août. Paysage triste et désolé, sans arbres, que ce coin de Champagne pouilleuse où quelques pins rabougris émergent seuls de ces vastes étendues désespérément plates. Le centre d'instruction des élèves chefs de section, installé dans des baraques en planches assez bien aménagées, avec doubles parois, comprend plus de cinq cents élèves répartis en quatre compagnies. La troisième à laquelle j'appartiens en compte cent trente-quatre. Parmi les élèves, beaucoup de sous-officiers, mais aussi quelques caporaux et soldats de 2e classe. C'est amusant de voir tout ce monde, adjudants, sergents-majors, etc, faire les corvées chacun à son tour et aller chercher la soupe sans distinction de grade. Chacun s'y prête d'ailleurs de très bonne grâce et la plus franche camaraderie règne parmi nous.
Les « popotes » sont organisées par Corps d'armée. Nous sommes dix-huit à la nôtre. Nous avons établi un système d'amendes pour ceux qui parlent de service à table : deux sous par infraction. Cela rapporte. Comme trésorier, j'ai recueilli jusqu'à deux francs quarante dans une seule journée. Lorsque le montant de la « cagnotte » sera assez élevé, je le verserai au « chef de popote », pour organiser une petite fête de famille. Le moral est excellent au centre d'instruction des élèves chefs de section, en abrégé le C.I. des E.C.S. Une preuve les vers suivants faits par l'un des élèves du Centre « Au C.I. des E.C.S., On ne connaît pas la tristesse ! On ne s'en fait pas, c'est certain. Ca va bien, va bien, va très bien ! » Pourtant la discipline est très sévère et l'emploi du temps des plus chargés. C'est la vie de caserne. Cela me rappelle un peu le fameux « peloton des dispensés » de mon « active ». Mais cette fois, c'est plus sérieux. Réveil à cinq heures trente. Appel du soir à vingt heures trente en présence d'un officier. Il faut être couché ou debout au pied de la paillasse qui nous sert provisoirement de lit, et répondre : « Présent ! » à l'appel de son nom. Extinction des feux à 21 heures. Dans la journée, exercice de 6 heures 30 à 9 heures 30 ; étude de 9 h. 30 à 10 h. 45. Lecture du rapport journalier à 10 h. 45 ; soupe à 11 heures. De 13 h. 30 à 14 h. 30 étude et interrogations ; de 14 h. 30 à 17 h. 30 exercice comprenant trois parties, tout au moins au début : Ecole d'intonation, alphabet morse, gymnastique Hébert. Cette dernière partie est sans contredit la plus intéressante. La méthode Hébert, dite « méthode naturelle », est très dure, et j'ai vu des « pépères » de quarante ans, suivant le cours avec nous, ne pouvoir y résister. Elle rend l'effort obligatoire, tandis qu'avec la « suédoise » il reste facultatif. Nous avons fait une démonstration devant le Lieutenant Hébert lui-même. Une autre devant les Américains, le torse nu, dans la neige et par une température glaciale. Et nous étions loin d'avoir froid ! Les démonstrations ne manquent pas. Elles ont lieu le plus souvent devant des spectateurs de choix. Le 27 septembre six généraux ; le 2°, le Général Fayolle commandant le Groupe des Armées du Centre, et son Etat-Major ; le 19 octobre, l'Ecole des commandants de Compagnies d'infanterie ; le 20, le Général Gouraud commandant la 4' Armée et l'Amiral Lacaze, etc. Le Général Gouraud nous félicite pour notre belle tenue. Quant à l'Amiral, comme il pleut à torrents, nous l'accusons d'être venu avec « sa flotte »...
La pluie, très fréquente, ne change rien à notre emploi du temps, les exercices prévus ont lieu quand même. Durant toute la première quinzaine d'octobre, c'est le régime de la douche quotidienne, en plein air. Nous partons avec la toile de tente en bandoulière : elle est encore à la même place à notre retour ; nous n'y avons pas touché. Elle a tout juste pour nous la valeur d'un symbole. Le 12 octobre, nous avions au programme travaux de campagne. Il fallait voir le défilé, sous la pluie battante, avec le fusil à l'épaule droite et une pelle ou une pioche sous le bras gauche. Spectacle très pittoresque, mais fort peu intéressant, d'autant plus que la pluie étant glacée, nous grelottions. Mais le plus beau fut une conférence en plein air sur les travaux que nous allions faire. Il pleuvait toujours, et le vent qui soufflait avec une violence rare nous lançait la pluie à la figure, et nous empêchait d'entendre une seule des paroles du conférencier qui continuait, imperturbable. Cela a duré un bon quart d'heure. Nous sommes enfin rentrés, « trempés comme des soupes ». Le ° novembre, nous sommes restés plus de demi-heure couchées dans l'herbe mouillée, au cours d'une démonstration. Excellent pour les coliques et les rhumatismes ! *** Heureusement, nous avons les dimanches pour nous reposer. J'en passe plusieurs à visiter les cimetières de Champagne, pour essayer de retrouver la tombe du cousin Paul, de Bouval, tué au 3e zouaves, en septembre 1915. Si mes recherches n'ont pas été couronnées de succès, mes démarches ne furent cependant pas inutiles. La famille apprit, en effet, par la suite, l'emplacement exact de la fosse commune où Paul Faucher était inhumé avec deux cents de ses camarades. Repos aussi les heures d'études pendant lesquelles nous étudions nos leçons et faisons nos devoirs. Certes, le travail ne manque pas, mais nous sommes au sec. Un sujet de devoir à titre d'exemple. « Qu'est-ce que la Victoire ? Quels sont les facteurs moraux de la Victoire ? Quels sont les moyens de les développer chez les troupes ? » J'eus la note 16 pour ce devoir. J'obtins assez souvent cette note par la suite et allai même jusqu'à « décrocher » un 1°. Puis vient l'examen ou plutôt les examens, car on nous interroge sur toutes sortes de matières, le programme étant des plus vastes. Je m'en sors assez honorablement, sauf pour les mitrailleuses où je tombe sur une mauvaise question. Pendant une quinzaine, les interrogations succèdent aux interrogations. J'en ai la tête bourrée. Il me tarde d'en avoir fini. Et le cours qui devait se terminer avec le mois de novembre est prolongé jusqu'au 15 décembre. Ma permission s'en trouve retardée d'autant. Informés de cette décision seulement au dernier moment, nous avons vécu une quinzaine de jours dans l'incertitude et l'énervement. Je pars enfin pour ma sixième permission (dix jours cette fois) le 17 décembre 1917. Sept mois se sont écoulés depuis mon retour de la cinquième. C'est un peu long. Pendant le cours, j'ai bien eu, à l'occasion de la Toussaint, une permission de quarante-huit heures pour Paris. J'ai pu voir pendant quelques minutes, ma belle-soeur Anna, au Bureau de Poste de la Garenne où elle était de service. Par la même occasion, en compagnie de camarades, j'ai visité le château de Versailles. Mais ceci ne saurait remplacer la vraie permission. Rien de particulier à signaler pendant cette dernière. Comme toutes les autres, elle s'écoule trop vite. Une fois terminée, retour par Paris et la Garenne, où je passe une bonne journée, en famille, auprès de « maman Capmau », Louise, Anna et Sophie. *** Départ à la gare de l'Est, le 31 décembre 1917, pour aller chercher mon matériel au camp de Châlons. De là, je rejoins Langres où se forme le train spécial groupant tous les isolés à destination de l'Italie. Non seulement le 339e, mais toute la 64 e Division est, en effet, partie pour l'Italie, durant mon séjour au Cours des Elèves Chefs de section, vers la mi-octobre, après un repos d'un mois environ au camp de Mailly. Perchée sur une colline, Langres est une ville très pittoresque, avec ses maisons tassées, ses rues étroites et tortueuses, dans lesquelles les Américains font la police à cheval. C'est miracle qu'on ait pu faire tenir une ville dans si peu de place, entre ces hautes murailles. Nous passons par Culoz, Aix-les-Bains et le beau lac du Bourget, Chambéry. Puis nous remontons la vallée de l'Arc. Voici, dans la Haute-Maurienne, St-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel. Cette dernière station nous rappelle le terrible accident de chemin de fer, au cours duquel des centaines de permissionnaires français périrent carbonisés. C'est enfin Modane, gare frontière, et le tunnel du Mont-Cenis, long d'une douzaine de kilomètres. Arrivés à Bardonnèche, première gare italienne, on s'aperçoit qu'il manque la moitié du train. Elle est restée à cinq kilomètres de là, en plein tunnel, par suite d'une rupture d'attelage. Vite, machine en arrière pour aller chercher les traînards. On les ramène et le voyage continue. Nous sommes en Italie.
CHAPITRE XVI - EN ITALIE (Décembre 1917 - 2 mars 1918)
Après Turin, voici la belle plaine du Pô, immense damier où les cultures, disposées très régulièrement, sont séparées par les canaux d'irrigation. L'eau joue un grand rôle ici. On la conduit partout. Sous son effet bienfaisant, l'herbe ne meurt pas, même en plein hiver, et de grands carrés d'un vert tendre tranchent heureusement sur le reste de la campagne. Peu d'arbres : quelques osiers décapités dressent seuls leurs moignons difformes au bord des rigoles pleines d'eau. Çà et là, rompant la monotonie de ce paysage trop plat, un village surgit : maisons blanches, toits rouges ; un clocher s'élance, svelte, très haut, vers le ciel. Puis ce sont les grandes agglomérations. Après Turin, Novare, Milan, Brescia, Vérone, Vicence, etc., campaniles légers et gracieux, maisons à trois ou quatre étages, aux nombreux balcons où du linge blanc sèche, ajoutant encore à la blancheur des murs, sous la lumière éclatante de cette radieuse journée de soleil, en plein mois de janvier. Nous sommes le 4. * Je rejoins le régiment le 5 janvier. A la 23e, j'ai l'agréable surprise de trouver le lieutenant Talandier, affecté à la Compagnie pendant mon absence. J'en suis enchanté. Avec l'ami Dulac, actuellement avocat à Aurillac, ils viennent d'être nommés sous-lieutenants, après avoir suivi, il y a quelque temps déjà, le cours d'élèves chefs de section. Des hommes de la trempe d'un Dulac et d'un Talandier (ce dernier brillant magistrat avant 1914), sont malheureusement trop rares. Aussi bien, de nos relations sereines et confiantes, dont j'appréciais tout le charme, ai-je gardé le meilleur souvenir. Je me remets sans trop de peine à ma nouvelle vie. L'accueil si cordial des camarades du Régiment m'y aide considérablement. Je me trouve entouré d'une atmosphère de chaude sympathie qui me fait le plus grand bien. Elle n'est pas tout à fait inutile. J'arrive à un mauvais moment. Après trois mois de repos, pendant toute la durée de mon cours, soit au camp de Mailly, soit sur les bords enchanteurs du lac de Garde ou dans l'Italie septentrionale, le Régiment monte en ligne le 6 janvier, lendemain de mon arrivée. Le 6° Bataillon est en réserve pendant quelques jours. Le 13 janvier, je suis nommé sergent, en exécution de la note du général en chef n° 27.476 du 27 juillet 1917, prescrivant de nommer au grade supérieur et en surnombre les militaires qui ont subi avec succès le cours d'élèves chefs de section. Je reste à la 23 e . A la question du lieutenant Ardisson, commandant la Compagnie pendant la permission du capitaine Andrieu « Quelle est la section que vous préférez ? » je ne peux que répondre : « Je n'en préfère aucune. » Impossible de faire un choix : les lieutenants Ardisson et Talandier sont extrêmement gentils pour moi, l'aspirant Laville, un parfait camarade. Le lieutenant Ardisson me garde avec lui. Mais le capitaine Andrieu, à son retour, m'affecte à la 2 ° Section, celle de l'aspirant Laville, que je remplace comme chef de section pendant sa permission. ** Nous sommes tout à fait en première ligne cette fois, secteur du Mont Tomba, le « Verdun italien ». C'est la guerre de montagne ici. Le canon fait un bruit d'enfer : les coups se répercutent d'un versant à l'autre, en roulements formidables. La montée en ligne est très pénible. Une couche de cinq à six centimètres de neige couvre le sol gelé. Il faut faire des prodiges d'équilibre pour arriver à se maintenir debout. Les « billets de parterre » sont nombreux. Si encore on restait sur place, il n'y aurait que demi-mal, mais sur la pente raide, on descend d'une dizaine de mètres sans avoir le temps de s'en apercevoir. Il faut ensuite remonter. On parle de nous « cramponner » comme les chevaux ou plutôt les mulets qui apportent le ravitaillement. Ces derniers dégringolent quand même, parfois avec toute leur charge, jusqu'au fond des ravins. On entend dans la nuit un bruit de marmites sur les rochers. La soupe, passe encore ! Mais quand le pinard dégringole, cela va mal...
Le 27 janvier, la 23° fait deux prisonniers autrichiens : des volontaires. Nous avons des petits postes de l'effectif d'une demi-section, à cinq cents mètres environ les uns des autres. Le mien est sur les pentes d'un ravin que nous avons pour mission de garder. La position est assez facile à défendre. A défaut de grenades et de cartouches, il suffirait de faire rouler de grosses pierres, qui ne manquent pas ici, pour arrêter l'assaillant. Jusqu'à maintenant, il n'a pas l'air de vouloir entrer en conversation. Puisqu'il ne veut pas venir à nous, nous irons vers lui. Le Colonel veut nous faire faire un coup de main contre une maison que l'on suppose occupée par un petit poste ennemi. Il faut en avoir le coeur net. Avec deux volontaires, choisis parmi une dizaine qui se présentent, je pars, en plein jour, faire une petite promenade de plus d'un kilomètre en avant de nos lignes. Comme seules armes, nos pistolets automatiques, chargeurs pleins, et quelques grenades en poche. Nous fouillons en détail une dizaine de maisons ou cabanes en cours de route. Elles sont toutes disposées de la même façon : à flanc de coteau, on y accède de plain-pied, par la façade, au rez-de-chaussée qui est en contre-bas, et au premier étage, du côté opposé. Dans l'une d'elles, quelques minutes d'émotion. Pendant que nous visitons le rez-de-chaussée, avec un camarade, nous entendons du bruit au-dessus de nous « Ça y est : la maison est occupée ! » Au pas de gymnastique, nous la contournons, un de chaque côté, pour aborder ensemble, pistolet au poing, la porte du premier étage, en criant « Haut les mains ! » Nous ne sommes pas peu étonnés d'y trouver le troisième copain. Lui, qui n'avait pas craint de s'aventurer là tout seul « n'en menait pas large » lorsqu'il vit, braqués sous son nez, nos pistolets automatiques. Heureux d'en être quittes à si bon compte, nous partons tous les trois d'un vaste éclat de rire. La fin de l'expédition fut aussi heureuse. La maison suspecte n'était pas occupée. Nous la fouillâmes de fond en comble. Aucune trace d'occupation récente. Je fis un rapport au Colonel et le projet de coup de main fut abandonné.

Objets provenant de la succession de Pierre Parra
CHAPITRE XVII : JUGE AU CONSEIL DE GUERRE
Nous sommes relevés le 12 février, et, par étapes, nous allons au repos à Malo, coquette petite ville de la province de Venise, au nord-ouest de Vicence. Durant ce repos, je vais passer une semaine au C.I.D. (dépôt divisionnaire) pour y suivre un cours de fusil automatique que je connais déjà. Ce séjour au dépôt ne me dit rien qui vaille, et c'est avec plaisir que je retourne au nid, c'est-à-dire à la 23° Cie du 339e. A noter une rude journée pour moi pendant notre séjour à Malo : celle du 3 mars 1918, où je siège comme juge au Conseil de guerre. Le Conseil était composé de la façon suivante : président, le colonel Le Merdy, commandant le 261 ° R.I. Juges : le commandant Flottes du 261 ° , le capitaine Roux du 202 ° d'artillerie, le lieutenant Lagoutte du 339 ° et moi-même, comme sous-officier. Quatre affaires dont deux assez graves.
- Outrages et menaces envers un supérieur : un soldat du 340e avait traité son caporal de « goujat » et l'avait menacé de le faire passer par la fenêtre. Coût : trois mois de prison.
- Voies de fait envers des supérieurs : deux soldats du 340 ° étant pris de boisson avaient donné des coups de poing et des coups de pied à un sergent et à un caporal qui voulaient les faire coucher. Le commissaire du gouvernement, ancien procureur de la République à Saint-Flour, demande pour l'un d'eux la peine de mort. Le Conseil juge que c'est excessif et, après une habile défense de l'avocat, condamne le principal accusé à cinq ans de travaux publics et son camarade, moins coupable, à cinq ans de prison.
- Désertion en présence de l'ennemi : un soldat du 340° déserte le jour où le régiment monte en ligne, est pris par les gendarmes dix-huit jours après. C'est un récidiviste déjà condamné à deux ans de travaux publics pour le même motif. Impossible -de le faire bénéficier des circonstances atténuantes: sept ans de travaux publics.
- Lacération de livret matricule. J'ai gardé cette affaire pour la fin, bien qu'elle soit passée la deuxième. C'était la moins grave. J'ai eu le plaisir de faire acquitter l'accusé. Le fait est assez rare, je crois, devant un Conseil de guerre, pour pouvoir être souligné. Il s'agissait d'un brigadier d'artillerie accusé de lacération de livret. Le brigadier en question avait été maréchal des logis fourrier et rétrogradé pour ivresse. Afin de se racheter, il demande à aller dans l'artillerie de tranchées, aux Crapouillots. Le feuillet de punitions de son livret matricule étant assez chargé, il le déchire, le brûle et le remplace par un feuillet vierge, pris dans le livret d'un camarade. Ceci dans l'intention louable de produire une bonne impression dès son arrivée à sa nouvelle Compagnie. Devant le Conseil, le pauvre diable fait peine à voir. Il sanglote comme un gosse et ne peut répondre à l'interrogatoire du président. Les juges ont à répondre à la question suivante « L'accusé « Un Tel » est-il coupable d'avoir déchiré le feuillet de punitions de son livret matricule ? » Répondre : Oui, ce qui est la vérité, c'est le condamner à deux ans de prison. Questionné le premier, comme étant le plus bas en grade, je réponds « J'estime que la punition prévue est trop lourde pour la faute commise. Je vote non coupable. » L'accusé a été déclaré non coupable à l'unanimité et acquitté. Je dois ajouter qu'au cours de toute cette séance, le Colonel. Président s'est conduit comme un véritable père de famille. Heureusement, car lourde est la responsabilité de juger des pauvres diables, après quatre ans de guerre. D'autant plus lourde pour moi que j'avais, ainsi que je l'ai dit, à donner, de vive voix, mon avis le premier. J'ai eu la satisfaction de voir mon opinion adoptée dans tous les cas, soit à l'unanimité pour les affaires portant les numéros 1, 2 et 4, soit à la majorité des trois voix contre deux pour la troisième. J'ai jugé en toute conscience et n'ai rien à me reprocher. Mais cette journée du 3 mars 1918 n'en reste pas moins la plus pénible de toute ma « campagne d'Italie ».
CHAPITRE XVIII - BLESSE DANS LA SOMME le 28 avril 1918
Sept mois d'hôpital (2 avril – 2 novembre 1918). Je devais partir pour ma septième permission le 28 mars 1918 : les permissions sont suspendues à partir du 25 mars. Il me fallut attendre pour en bénéficier jusqu'au 2 novembre 1918. Mais comme compensation, dans l'intervalle, cette permission temporaire était devenue définitive. Le 28 mars, je m'embarquai cependant à la gare de Tavernelle, mais avec tout le Régiment, pour retourner en France, où l'on avait besoin de nous. Voyage pénible dans des wagons à bestiaux où nous étions tellement serrés, qu'assis sur le plancher, nous n'avions même pas la place d'allonger nos jambes. Nous arrivons au petit jour à la frontière française. Nice, Cannes : on nous offre des brassées de fleurs. Nous remercions en baragouinant les quelques mots d'italien que nous avons appris "Mais vous êtes en France ! Nous sommes Françaises ! » nous disent les charmantes porteuses de fleurs. "Vive la France !" répondons-nous en choeur. Au cours d'une des nombreuses haltes du train, je m'échappe du wagon à bestiaux et m'installe dans une guérite de serre-freins. J'y reste tout le long de la Côte d'Azur. La guérite n'est pas fermée. Je suis noir comme un charbonnier, après le passage dans les tunnels. Mais en échange, de mon observatoire, quel magnifique point de vue ! Mes yeux n'étaient pas assez grands pour ne rien laisser perdre de ce spectacle unique. D'un côté, la mer bleue, le ciel bleu, si semblables qu'on distingue difficilement leur ligne de séparation. De l'autre, des villas, des palais éclatants de blancheur, accrochés sur les pentes, et des fleurs, des champs de fleurs partout. Oh ! le merveilleux pays !
Nous remontons la vallée du Rhône jusqu'à Lyon, traversons toute la France, pour débarquer à Beauvais le 3 avril, après un long voyage de cinq jours et de cinq nuits qui manquait vraiment de confort. Des chevaux sont crevés en cours de route. Nous avons mieux résisté. A la descente du train, pour nous remettre de nos émotions, une infirmière anglaise, avec son plus gracieux sourire, nous donne une cigarette à chacun, et en route pour une étape de quinze kilomètres. Puis, dans les jours qui suivent, à pied ou en camions, nous arrivons au sud-est d'Amiens, entre Hailles et Castel, près de Moreuil, en pleine offensive allemande d'avril 1918, tendant à séparer l'armée française de l'armée anglaise. C'est bien la guerre de nouveau ici, et nous la trouvons d'autant plus pénible que nous en avions un peu perdu l'habitude en Italie. Les 12 et 13 avril, le canon tonne sans arrêt véritable enfer ce bombardement ininterrompu qui vous laisse un bourdonnement continuel dans les oreilles. Le 1° avril, le 5° Bataillon attaque et progresse de 1.100 mètres en profondeur. Il fait 244 prisonniers dont 10 officiers et ramène 26 mitrailleuses (voir communiqué officiel du 1° avril, 23 heures). La photographie du butin fait par le 339' a paru dans l'Illustration. Au cours de l'attaque, le 5° Bataillon a eu moins de pertes que nous pendant la semaine de première ligne qui l'a précédée. Le lieutenant Delcros, instituteur à Massiac, a été tué, ainsi que le sous-lieutenant Bastien, commandant la première section de la 23°, le capitaine Fontaine, et bien d'autres, hélas ! Depuis que nous sommes en première ligne, je commande la 2° Section de la 23°, en remplacement de Laville, envoyé au dépôt divisionnaire comme réserve de cadres. Je fais inutilement remarquer au capitaine Andrieu, lorsqu'il me désigne pour ce poste, que je suis le plus jeune sergent de la section. Il ne veut rien entendre. C'est un honneur certes, mais un ordre aussi, auquel il faut obéir. Redoutable honneur, lourde responsabilité que de disposer de la vie d'une cinquantaine d'hommes. Le bombardement continue aussi violent, le plus souvent par obus à gaz, et les évacués sont nombreux. Le 24 avril fut une journée particulièrement dure pour ma section. Dans la nuit du 23 au 24, nous avions creusé des tranchées à la lisière du parc du château de Hailles, en prévision d'une attaque. Le 24 avril, à 4 heures du matin, le bombardement commence : il durera pendant quatorze heures, presque sans interruption. Le capitaine Andrieu me donne l'ordre d'aller occuper avec ma section les tranchées creusées dans la nuit. Il faut pour cela traverser le parc où se fait le tir de barrage. Les arbres écartelés s'abattent de tous côtés et jonchent le sol de leurs rameaux enchevêtrés. Deux cents mètres d'obstacles à franchir, sous les rafales d'obus. Nous nous élançons au pas de course et rejoignons la tranchée, haletants. Miracle : tout le monde est là, pas même un blessé ! Mais ce n'est pas fini. La tranchée est repérée. Sur une cinquantaine de mètres, les obus y tombent presque en plein. Je prends sous ma responsabilité de faire appuyer vers la droite ma première demi-section qui est la plus en danger. Lorsque le tir se déplace enfin, elle réoccupe son emplacement. La tranchée est bouleversée, mais tous mes hommes sont indemnes et prêts à recevoir l'ennemi. Ce dernier attaque le bois sur notre droite et ne semble pas se soucier de nous. Avec quelques camarades volontaires, à la demande du capitaine, nous allons voir ce qui se passe de ce côté, avec mission de l'inquiéter sur ses flancs et de lui faire, si possible, un brin de conduite ... Vers 1 heure, la tempête se calme. C'est notre treizième jour de première ligne. Nous tenons encore bon, malgré les obus, les gaz, le manque complet de sommeil, et le mauvais temps par-dessus le marché. Mais nous sommes presque à bout. Les évacuations des gazés continuent sur le taux d'une dizaine par jour. Encore quelque temps de ce régime, et de la Compagnie, il ne restera pas grand'chose. Enfin, après quinze jours de cet enfer, nous allons en réserve à un kilomètre et demi en arrière.
C'est là que, le 2 avril, vers 20 heures, avec le capitaine Andrieu qui me donnait des ordres pour une corvée de matériel à apporter en première ligne, nous sommes tombés, lui d'un côté, moi de l'autre, sans pouvoir nous relever, comme si l'on nous eût donné un grand coup de bâton dans les jambes. J'étais blessé à la cuisse gauche par un éclat d'obus. Mon capitaine était atteint aux deux jambes : l'une devait être amputée par la suite. Trois hommes de ma section, et le caporal Condamy, de St-Martin-Cantalès, avaient été touchés par les éclats du même obus. L'un d'eux, frappé en plein front, est mort sur le coup ; un autre, avec un éclat dans le ventre, le lendemain matin. Du beau travail. Relevé le dernier, je reçois les premiers soins au poste de secours : un flacon de teinture d'iode vidé à même la plaie. Je fais la grimace. Ce n'est pas tout. Mon beau pantalon neuf, taillé en fantaisie, bien ajusté, est fendu du haut en bas, à grands coups de ciseaux. Pour me consoler sans doute de ce désastre, l'infirmier me dit "T'en fais pas, va ! Tu n'y reviendras pas... "
C'est pourtant vrai : je vais partir à l'arrière pour de bon, cette fois. Adieu, cher 339e que je n'avais pas quitté depuis le 4 août 1914. Adieu, bons camarades des mauvais jours, devenus pour moi, à la dure école de la souffrance et du danger non seulement des amis, mais de véritables frères. Oui, mes frères d'armes, qui comptiez sur moi comme je savais pouvoir compter sur vous, je vous quitte avec regret. Combien parmi vous, présents au front comme moi, depuis le début, devaient tomber par la suite ! A tous les Morts du 339°, à ceux qui les pleurent, mon respectueux hommage ; aux survivants, mon souvenir le plus affectueux. A la suite de ma blessure et des événements du 24 avril j'avais été, à la date du 30 avril, l'objet d'une citation à l'ordre de la division, qui fut transformée par la suite en Médaille militaire, dans les termes suivants :
"La Médaille militaire a été conférée au Sergent (Réserve) PARRA Pierre Antoine Emile, Matricule 017544 de la 23° Cie du 339° Régiment d'Infanterie, sous-officier énergique et courageux, volontaire pour toute mission périlleuse. Le 24 avril 1918, au cours d'une attaque ennemie, a pris le commandement d'une patrouille offensive qui a rejeté l'ennemi d'un bois où il avait pu prendre pied. A été blessé très grièvement, le 2° avril 1918, à son poste de combat. Une blessure antérieure. La présente nomination comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme." Le Maréchal de France Commandant en chef des Armées Françaises de l'Est.
CHAPITRE XIX : SEPT MOIS D'HOPITAL
Evacué à l'ambulance chirurgicale de Cempuis (Oise), je suis opéré le lendemain. L'éclat d'obus avait traversé la cuisse de part en part, à quelques millimètres du fémur et de l'artère fémorale, mais sans les toucher, entraînant avec lui, dans la plaie, des débris de capote et de pantalon. De ma blessure en forme de tunnel, le chirurgien fait une carrière à ciel ouvert. Je me réveille dans mon lit, longtemps après l'opération. Le chloroforme m'a beaucoup fatigué. Dans la nuit qui a suivi, je me sens tout d'un coup partir, je commence à battre de l'aile. L'infirmier de garde s'en aperçoit, rejette au fond du lit draps et couvertures. Mon pansement est tout rouge de sang. Une forte hémorragie. Il garrotte ma cuisse. On m'injecte un demi-litre de sérum artificiel. Il était temps. Je partais, heureux, sans souffrance. .. Lors de mon premier pansement, le major arrache, d'un geste brusque, tout ce qui recouvre ma plaie. Je pousse un hurlement. La douleur un peu calmée, je regarde ma cuisse et ne la reconnais pas. « On t'a enlevé un fameux bifteck ! », me dit le « toubib », en guise de consolation. Plutôt : une plaie de dix-huit centimètres sur vingt-deux. Malgré tout, cela va aussi bien que possible. Le 4 mai, je quitte l'ambulance pour l'hôpital auxiliaire n° 6, à Melun. Ce dernier est installé dans l'école St-Aspais. Nous sommes une cinquantaine de grands blessés dans la salle 7 qui est très vaste. Nous sommes très bien soignés et bien nourris. Soeur Jeanne qui fait les pansements et Mademoiselle Jumeau, infirmière bénévole sont d'un dévouement sans limite. Je fais expédier un télégramme à ma femme qui accourt. Elle reste auprès de moi quelques jours, hélas ! trop vite passés. Heureusement, ma belle-soeur Anna vient souvent me voir, de la Garenne, et me gâte tant qu'elle peut. Elle sacrifie tout son après-midi pour me garder. Nous causons, et la nuit vient sans qu'on s'en aperçoive. Tant pis si le thermomètre monte un peu trop, ce soir-là ! Il dépasse parfois 39° ; un jour même il arrive à 39° 7. Je ne suis pas encore bien brillant. Les lèvres restent aussi blanches que le drap. Il faut me soulever la tête et la tenir pour me faire boire. J'ai six drains qui irriguent ma plaie (méthode Carrel, je crois). On me les enlève enfin. Grâce aux bons soins dont je suis l'objet mon état s'améliore par la suite. Trop vite même, car je deviens « évacuable ». Le 7 juin, je quitte à regret Melun pour Pamiers (Ariège), hôpital complémentaire 67. Un voyage de quarante heures sur un brancard, sans autre alimentation qu'un peu de bouillon. Je souffre horriblement d'une rétention d'urine : avec les secousses du train, c'est un supplice intolérable. Nous débarquons à Pamiers vers 23 heures. Pas d'ambulance pour nous prendre, pas même de brancard. On nous fait monter dans l'omnibus de ville avec des roues en fer. A chaque secousse sur les pavés inégaux, nous ne pouvons retenir des cris de douleur. On me décharge enfin sur mon lit, comme un paquet de linge sale. J'y serais resté toute la nuit, si deux camarades, moins blessés que moi, ne m'avaient déshabillé. Le service est fait par des Annamites. Fort mal. La nourriture, mal préparée, n'est pas appétissante. Heureusement, nous avons notre armoire à provisions, dans notre petite chambre pour quatre sous-officiers. Ma femme qui est venue me voir, ainsi que « les cousins de Toulouse », Madame et Monsieur Georges Mialet, si bons pour moi, assurent le ravitaillement. Les beaux paniers de fruits venant de leur jardin de Lardenne et les bonnes bouteilles de Pomard que nous leur devons ! Qu'ils en soient de nouveau remerciés ! C'est aussi grâce au « cousin de Toulouse » que j'obtiens le 10 juillet, mon transfert de Pamiers à Toulouse, hôpital 2° bis, maison Pauillac, boulevard de Strasbourg. Après le purgatoire de Pamiers (l'enfer étant là-haut, en première ligne), je me trouve en paradis. Soins et nourriture, tout est parfait. On va au-devant de nos désirs. Nous sommes vraiment trop gâtés. Madame Marsan et sa soeur, en maîtresses de maison accomplies, n'hésitent pas à mettre la main à la pâte, pour la distribution de la soupe, comme pour les pansements. Monsieur Marsan me prête des livres. J'ai comme infirmière Madame Aversenq, qui est très dévouée et d'une grande douceur. A ces différentes personnes, ainsi qu'à tout le personnel de l'hôpital 2° bis, va mon souvenir le plus reconnaissant. D'autant plus reconnaissant que, vers la fin juillet, j'eus la grippe espagnole et, sans les bons soins dont j'y fus l'objet, on pouvait tout craindre dans l'état de faiblesse où je me trouvais. Après être resté trois mois au lit, couché sur le dos sans pouvoir bouger (quel supplice surtout durant les grandes chaleurs pendant lesquelles je m'étais entamé), je me lève enfin au début août et marche avec deux béquilles. Je ne suis pas encore très fort. Dans les premiers jours du mois d'août, ma femme qui est en vacances, se rend auprès de moi à Toulouse avec notre fille aînée, Marguerite, notre « joujou », que « tante So » vient rechercher à la fin du mois. Les bonnes heures passées ensemble dans le jardin de l'hôpital sur ma chaise longue, ou à courir avec mes béquilles dans les rues ! Mais tout a une fin. Ma blessure est cicatrisée et je dois quitter, bien à regret, l'hôpital 2° bis pour le Centre de Mécanothérapie, hôpital 29 à la caserne Pérignon. Je dois dire tout de suite que toutes ces machines aux formes bizarres n'ont pas apporté à mon état une grande amélioration. La marche, le jardinage et surtout la bicyclette, quand j'ai pu et dû en faire plus tard, m'ont donné de bien meilleurs résultats. Quoi qu'il en soit, bien qu'ayant mon lit à la caserne Pérignon, je n'y ai pas couché souvent. Avec ma femme, nous nous étions mis en pension, rue de l'Aqueduc, chez Madame et Monsieur Clément, typographe à "La Dépêche". Lorsqu'il y avait une visite de contrôle ou une inspection, on me prévenait. Une fois même, j'ai dû me coucher tout habillé en arrivant à la caserne. Le Médecin Inspecteur était là, qui voulait voir tout le monde au lit. Pendant qu'il visitait une autre chambrée, je me suis déshabillé sous les couvertures. Ma femme est repartie vers le 20 septembre. Je reste en pension chez Monsieur Clément qui m'initie à la culture des chrysanthèmes. Je profite de ma solitude pour visiter Toulouse en détail. J'admire à loisir le Capitole et ses salles magnifiques, le musée et le cloître des Augustins, la cathédrale St-Etienne et l'église St-Sernin. Je musarde aux devantures, dans les rues de Metz et d'Alsace-Lorraine. Fidèle habitué du Jardin des Plantes et du Grand-Rond, je me promène encore le long de la Garonne, ou m'assieds, pour rêver, dans le square Lafayette, face au « bon Goudouli » au sourire si accueillant. Avec mes béquilles, en ai-je fait des kilomètres dans la « ville rose » ! Les tramways m'ont également bien servi. Leur personnel est charmant pour les blessés. Les voitures stoppent pour nous prendre, même en dehors des arrêts prévus. A propos de « trams », j'ai été témoin, à Toulouse, d'une grève originale les « trams » marchaient comme d'habitude, mais les receveuses ne faisaient plus payer le prix des places. La population toulousaine est de plus sympathique, très serviable. Les gens ne craignent pas de se déranger pour vous montrer le chemin ; ils vous accompagnent au besoin, et vous racontent, chemin faisant, leurs petites affaires personnelles. J'ai vu cette foule exubérante, le 11 novembre 1918, fêter, dans un accès de joie délirante, la fin de l'affreux cauchemar. Et je l'ai vue aussi, silencieuse et recueillie, défiler, dans un ordre parfait, en l'honneur des Morts de la guerre, le 17 novembre, au cours d'une manifestation monstre, se déroulant du Capitole jusqu'au cimetière de Terre-Cabade. J'emporte de Toulouse et de ses habitants un excellent souvenir. Je m'en voudrais d'oublier ici les longues visites et les cordiales réceptions chez les « cousins de Toulouse », qui ont toujours été si gentils pour moi. Vers eux va ma plus affectueuse reconnaissance. Le 1° novembre, j'abandonne l'hôpital 29 pour le Centre de Réforme. Je passe devant la Commission de Réforme le 2° novembre 1918, et le 1 er janvier 1919, je suis heureux de reprendre, appuyé sur deux cannes, le chemin de ma classe, à l'école primaire de garçons de Pléaux (Cantal).