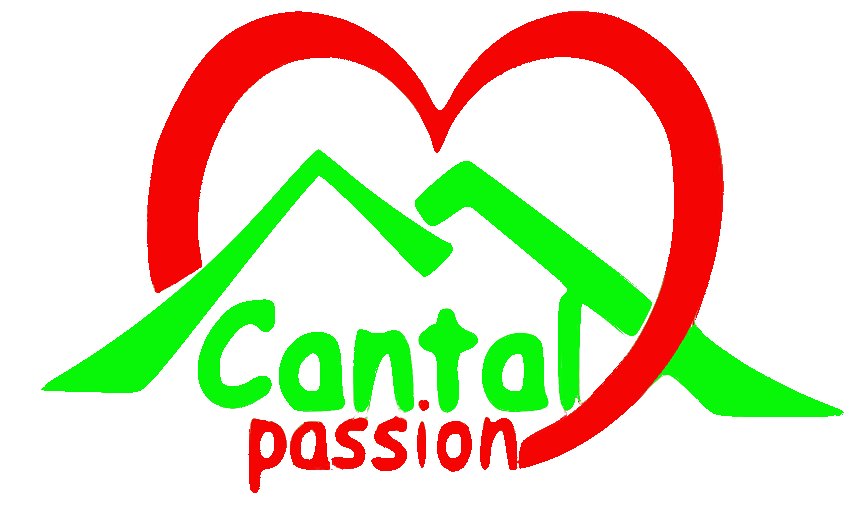FETES
Allanche voyait de temps immémorial célébrer une de ces fêtes mi-partie religieuses, mi-partie chevaleresques, dont on trouve quelques exemples dans certaines cités du nord de la France, entre autres celle des Granils-Goyous à Douai.
Quelle fut l'origine de cette fête? Nul ne le sait. Fut-elle instituée par les Romains qui aimaient tant les jeux ? On l'ignore. Mais comment croire qu'ils eussent choisi une aussi mince bourgade, si éloignée des grands centres de population, préférablement à Augusto-Némétum, ou à toute autre ville importante du pays.
Enfin dut-elle son établissement à l'esprit chevaleresque et religieux que la croisade prêchée à Clermont développa chez nos bons aïeux, et qui renouvela la face du pays? La tradition se tait. .
Nous avancerons seulement qu'il parait rationnel de penser que cette fête n'eut lieu qu'après le retour des premiers croisés, lorsque nos pieux guerriers revenaient chargés de blessures, pauvres d'argent, mais riches de reliques vénérées. Alors les pèlerinages vers ces reliques vinrent remplacer les voyages d'outre-mer, pour les habitants restés dans le pays, et que des circonstances inconnues empêchaient de se rendre vers les lieux saints. Alors dût commencer la fête d'Allanche.
La tradition constante du pays est qu'un os de la hanche de saint Jean-Baptiste avait été rapporté dans cette ville, et déposé dans un tombeau de pierre fermé par deux portes et une grille de fer. Le nom du généreux pèlerin ou chevalier qui le porta est resté inconnu. Mais la dévotion à ces précieux restes a survécu à la destruction des âges. Aujourd'hui comme jadis, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, cette fête des beaux jours de l'année, saluée par des feux de joie dans toutes les localités de nos montagnes, est celle d'Allanche. Elle s'est maintenue, quoique amoindrie et décolorée, jusques à nos temps d'indifférence et d'abâtardissement, où tout ce qui n'est pas argent est méprisé.
Le nom vulgaire de Piara-Prat tend encore à confirmer ce que nous avançons, que sa création doit remonter à la période de temps où la langue romane avait fini par prédominer; ce nom, en effet, appartient évidemment à cette langue. Il trouve son étymologie dans l'action qu'il exprime : Piara-Prat veut dire Pré-Pélé. On sait positivement encore aujourd'hui, qu'autrefois, avant la fête et la cavalcade du troisième jour, il était défendu de toucher à l'herbe d'un certain pré. Ce troisième jour arrivé, le peuple de la ville et de la campagne s'y portait en foule, en arrachait l'herbe avec les mains, parce qu'il lui était interdit de se servir d'instruments, et chacun l'emportait chez soi, dans la confiance un peu superstitieuse, qu'elle était un préservatif assuré contre les maladies des bestiaux.
Le titre qui fonda cette servitude est malheureusement perdu. Il eut été à désirer qu'il fut au nombre de ceux que la ville a conservés. Aujourd'hui le pré, entre dans le domaine de la commune, est affermé par elle. Quelques restes de la croyance à sa vertu surnaturelle subsistent parmi le peuple; un certain nombre de cultivateurs arrachent encore quelques poignées de cette herbe vénérée; ils la mettent à leur chapeau, et la suspendent ensuite dans leur demeure, comme une amulette et un gage de protection divine.
Deux mois avant l'époque si désirée de la Saint-Jean, les habitants songeaient déjà aux préparatifs de la solennité. Un impôt était perçu sur chaque charge de bois qui entrait dans la ville, et la bûche de la St-Jean était exigée rigoureusement par les enfants comme un droit acquis à la cité. Cette rétribution était religieusement conservée et uniquement consacrée aux feux de joie qui, dans chaque quartier, servaient de prélude à la fête.
Cette fête avait de plus un caractère hospitalier, expression sincère des mœurs patriarcales de nos aïeux, et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Au-devant de la porte des principaux habitants, des tables étaient dressées; la servante de la maison offrait gracieusement un verre de vin aux passants : mais, indépendamment de ces largesses publiques, chaque habitant engageait ses parents et ses amis à venir partager les réjouissances générales. Aussi peut-on dire qu'à plusieurs lieues à la ronde les habitations devenaient désertes.
Un des usages les plus particuliers de cette fête était celui de recevoir Garçon, les jeunes gens qui avaient atteint un certain age. Ils distribuaient des rubans à leurs devanciers, et dès ce moment ils prenaient rang parmi eux. Cet usage rappelle certainement les mœurs de la chevalerie. Au temps où la guerre était un état presque permanent, où toute la vie de l'homme se passait sous les armes, où toute l'éducation préparait aux terribles joutes de la lice, c'était le plus grand jour pour un adolescent, que celui où il était admis à rompre une lance, où il était associé aux défenseurs de la patrie. Alors, sans doute, un ruban servait de banderole à la lance du néophyte pour le distinguer. Comment et à quelle époque ce ruban seul a-t-il survécu? La tradition n'en dit rien.
Trois personnages principaux figuraient dans les cérémonies : le roi et ses deux officiers supérieurs le porte-épée et le porte-enseigne. La charge de ces trois dignitaires avait été concédée l'année précédente, et leur nomination était la clôture de la fête antérieure. La royauté de la St-Jean-Baptiste était octroyée sur la place publique: dans la partie où est située la maison Sainthéran; une table était dressée, des bancs circulaires disposés : les consuls, le curé, les fabriciens se rangeaient autour de la table, et le choix du roi"était proclamé par eux. Son nom et celui de ses principaux officiers étaient accueillis par les acclamations unanimes de vive le roi. Les tambours et la musique les saluaient do leurs roulements et joyeuses fanfares.
Quoique la royauté imposât de grandes charges, le monarque devant régaler l'élite et le populaire de ses états, cependant elle était fort recherchée. Il est vrai que si les largesses du souverain étaient grandes, la libéralité des sujets ne l'était pas moins. Chacun s'empressait d'apporter au roi de son choix ce qu'il avait de mieux en vins et comestibles de toute nature. Aussi, malgré les repas permanents des trois journées que durait la fête, il était ordinaire qu'un bon approvisionnement vint indemniser le royal traitant. Aujourd'hui les splendides repas ont cessé, mais un bal, plus en harmonie avec notre civilisation, leur a été substitué.
Le village de Vernols était associé à la fête. Lui aussi possédait un fragment des reliques de saint Jean. Le roi et son cortège s'y rendaient à cheval, en procession. Au passage du ruisseau, on lui retirait son couteau qui lui était rendu ensuite au banquet. Arrivé devant l'église, il mettait pied à terre, le curé le recevait à la porte et le conduisait au chœur. La messe célébrée, et après la procession suivie à cheval par le roi et son escorte, les cavaliers, sous le commandement de l'officier porte-épée, s'exerçaient à la course, et des rubans devenaient le prix et l'ornement des coursiers les plus agiles. Après ces cérémonies et divertissements, dont la fin était marquée par la distribution d'un pâté fourni par la fabrique d'Allanche, le roi reprenait la route de la ville. Bientôt cette cavalerie brillante, enseignes déployées, se dessinait sur le ciel d'azur, couronnement de la montagne qui domine Allanche à l'ouest. Les citadins l'attendaient avec impatience, la saluaient de joyeuses acclamations, et le cortége, au milieu des transports de joie, faisait sa rentrée en ville par la porte du nord.
Mais cette rentrée n'était pas toujours exempte de désordres. C'était un honneur que d'arriver des premiers dans l'enceinte de la ville, et les habitants d'Allanche tenaient à jouir de cette prérogative. Leurs jaloux voisins la leur disputaient quelquefois. Alors s'engageaient des luttes qui ensanglantèrent souvent la fête, et pendant lesquelles les crânes épais et les robustes épaules des montagnards recevaient des horions auxquels d'autres athlètes auraient difficilement résisté. Le bâton, ce compagnon inséparable de l'homme dans ces contrées, jouait un rôle actif; mais une fois cette épreuve passée, la porte franchie, l'harmonie était subitement rétablie, et l'hospitalité recouvrait ses droits.
De nos jours, la fête de la St-Jean a perdu de sa splendeur, et depuis longtemps la bourgeoisie lui reste presque étrangère : elle semble pour ainsi dire ne se trouver là que pour enregistrer ce qui s'est fait depuis longues années. Mais la même indifférence n'existait pas dans le siècle dernier, à en juger par le passage suivant d'une lettre écrite en 1728 à l'un des notables habitants: « Au dernier voyage » que M. Chabrier de La Salle fit à Riom, il conclut avec mons. Neyraud, maistre musicien et joueur des instruments, dont vous serez content. Il n'y a qu'à savoir comment vous voulez distribuer en aubois ou en violons. On se rangera de la façon que vous voudrez; vous saurez que mons. Neyraud est le meilleur musicien et instrument d'Auvergne qui rangera les choses de certaine façon que vous serez content.
Cette lettre prouve qu'à cette époque l'art musical avait peu d'adeptes dans nos montagnes : nous devons le dire à regret, il en est encore aujourd'hui de même, et cette partie de la gaie-science est aussi négligée que jadis.
La fête de la St-Jean-Baptiste avait donc perdu sa gaîté et son importance, lorsque M. le marquis de Castellane, s'associant aux principaux habitants d'Allanche, chercha, en 1844, à lui rendre son antique splendeur. M. Benoid Poris-de-Félut ayant publié, dans les Tablettes historiques de l'Auvergne, un précis des cérémonies qui furent alors renouvelées, nous emprunterons à sa relation quelques détails plus particuliers, comme nous l'avons déjà fait dans plusieurs passages de cette notice.
La veille de la fête, on dressait une tente en feuillage devant la porte du roi, elle était conservée pendant les trois jours.
Lorsque le soleil tombait à son déclin, le son des tambours et des fifres annonçait le début de la cérémonie. Alors un cortége partait de l'église, musique et tambourin en tête. Ce cortége se composait du curé en habit de ville, des consuls et des membres de la fabrique : il se rendait au domicile du roi qui, la couronne à la main, prenait place à la tête, le porte-épée à sa droite et le porte-enseigne à sa gauche. On se rendait à l'église, et là, au milieu de la population entière, l'hymne de saint Jean: Ut queant Iaxis, etc., était entonné; tous les assistants et la musique le répétaient en chœur.
La prière finie, on quittait l'église, et l'heure des divertissements arrivait. Des feux étaient allumés dans tous les quartiers; la danse commençait; le roi, donnant le bras à la femme, la fille ou la sœur du premier magistrat de la cité, qui par réciprocité rendait le même honneur à la femme qui tenait de plus près au roi, visitait les feux, et faisait le tour de la ville, après quoi il rentrait chez lui, sa nombreuse suite rangée sur un seul rang.
Le lendemain, le roulement des tambours, les sons joyeux des instruments saluaient l'aube du jour; le roi se rendait à l'église où l'on disait une messe pour sa famille royale. A dix heures le rappel était battu, et bientôt de nombreux cavaliers, débouchant de toutes les parties de la ville, venaient se réunir devant la maison du roi.
Lorsque la troupe paraissait assez nombreuse, le roi montait à cheval. Maintenant le garde-champêtre, aussi à cheval, le sabre à la main, ayant à ses côtés un enfant de chœur qui porte le bouquet de la St-Jean, composé de fleurs métalliques séculaires, remplace l'archer du vieux temps, et ouvre la marche. Le maire, revêtu de son écharpe au lieu de la robe magistrale du consul, précède le roi et ses deux officiers; les cavaliers prennent rang à leur suite. Le cortége fait le tour de la ville, se rend à Vernols en sortant par la porte du sud, et rentre ensuite par celle du nord.
La fin du jour est consacrée aux cérémonies religieuses : la procession de St-Jean-Baptiste est faite au milieu d'un concours immense de fidèles, et la statue du saint est promenée pieusement dans toute la ville.
Une journée de repos était accordée après la fête principale qui avait toujours lieu un dimanche. Seulement une messe solennelle était dite le lundi en l'honneur de saint Eloy. Rien aujourd'hui ne peut nous faire apprécier les motifs qui associèrent le saint évêque à Jean-Baptiste.
Le mardi, second jour de la fête, est celui où l'on se rend au pré. C'est une vive contrariété pour tous, lorsque un beau soleil ne luit pas ce jour-là, mais surtout pour la jeune fille, qui depuis longtemps songeait à sa toilette et rêvait la fête du Pré.
Ce pré est une propriété de la ville, situé sur le revers de la côte à l'ouest, et disposé de manière à être aperçu de la ville.
Le roi se rend au pré avec la même pompe qui est usitée pour Vernols. Des groupes nombreux se forment et s'acheminent, guidés par la musette, au rendez-vous commun. Mais malheur à celui qui suit isolément la bande joyeuse; l'épithète railleuse de Iiabi (terme dont l'origine est inconnue) lui serait continuellement adressée. Rabi lui apprendrait que l'herbe du pré ne doit être foulée que par des cœurs unis, ou par le cavalier revêtu de son armure.
Arrivé au but de la course, le roi, à la tête de ses cavaliers, fait le tour de l'enceinte; puis il vient prendre la place qui lui a été réservée, et alors commencent les danses, courses et autres divertissements Après plusieurs heures passées ainsi, le signal du départ était donné par la distribution d'un énorme pâté coupé en morceaux, et jeté parmi les danseurs. Les réjouissances cessaient, le roi remontait à cheval, faisait un dernier tour du pré, suivi de ses cavaliers, reprenait le chemin de la ville.
Là se terminaient la fête et cette royauté de trois jours, n'ayan coûté aucune larme à ceux qu'elle avait gouvernés.
Mais nos bons aïeux étaient prévoyants; avec eux la royauté ne mourait pas; il fallait songer à l'année suivante, et la cérémonie était close par l'élection d'un autre roi et d'autres officiers. Ces nouveaux choix étaient accueillis par des transports d'allégresse : on se rendait de nouveau à l'église; à la sortie, les danses recommençaient comme la veille de la fête, et les tables dressées dans toutes les rues de la ville offraient aux servantes, parées de leurs habits de fête, l'occasion d'offrir leur gracieux accueil, d'être de nouveau l'interprète de l'hospitalité de leurs maîtres,-et de former le souhait du retour désiré de cette fête patronale.
Cette dernière phase de la fête a cessé depuis une trentaine d'années, où l'on voulut la renfermer uniquement dans les cérémonies religieuses. Le curé ne s'associe plus aux cérémonies en dehors du culte. Les règles de la séparation des pouvoirs n'étaient pas connues de nos pères : de leur temps l'autorité ecclésiastique partageait toutes les joies de la cité. Mais dans une ère où la loi est athée, le pasteur est enfermé dans un cercle de fer, et il ne peut plus franchir les portes de son église.
Une des particularités les plus singulières de cette fête, c'est que le mercredi, une espèce de parodie était exécutée par les enfants. Ils étaient tous réunis, flanqués de vieilles épées, de vieux sabres et de toutes les vieilles armes qu'ils pouvaient se procurer; heureusement, dans nos âges modernes, elles ne voyaient plus le soleil qu'une fois l'an! Sous la conduite du garde-champêtre, qui recevait de chacun d'eux une rétribution de dix centimes, ils se rendaient au pré, et y célébraient eux aussi ce que l'on appelait le petit Piara-Prat. Imitateurs des grands personnages, ils se livraient à des jeux, à des danses et à toutes sortes de divertissements. Leurs réjouissances terminées, ils revenaient en ville, et le pré de St-Jean devenait désert pour une année entière.
Cette suite de la fête, cette permission accordée aux enfants de se munir d'armes, cette absence complète de toutes les cérémonies religieuses, trop vénérées pour leur être livrées en amusements, nous semble une preuve de plus de l'origine chevaleresque des réjouissances, et une imitation des tournois qu'on y donnait aux temps derniers. Alors, en effet, tous les actes de l'éducation tendaient à inoculer, dans l'adolescent, les idées martiales. Leur vie d'homme devait s'écouler dans les périls et les hasards. Il fallait donc tremper vivement ces jeunes âmes; et dans ce but on leur accordait, outre le plaisir d'admirer les belles passes-d'armes, celui de les imiter eux-mêmes, autant que leurs forces le leur permettaient.
D'après la relation que nous venons de donner, on peut, sans trop s'exposer à une trop grande erreur, avancer, qu'au Moyen-Âge, à cette époque où tant de châteaux forts existaient dans nos montagnes, servaient d'asile à des hommes énergiques dont la guerre ou ses images étaient toute la vie, les tournois et autres exercices chevaleresques remplaçaient les réjouissances amollies de nos âges énervés. Il est certain que tous les hobereaux de nos contrées s'y rendaient avec empressement : certes, ils n'étaient pas hommes à manquer une aussi belle occasion de déployer leurs forces, manifester leur courage, et faire briller leur adresse à manier un coursier fougueux. La chronique suivante, conservée dans la tradition du pays, prouve combien peu de voisins s'abstenaient de ces réunions.