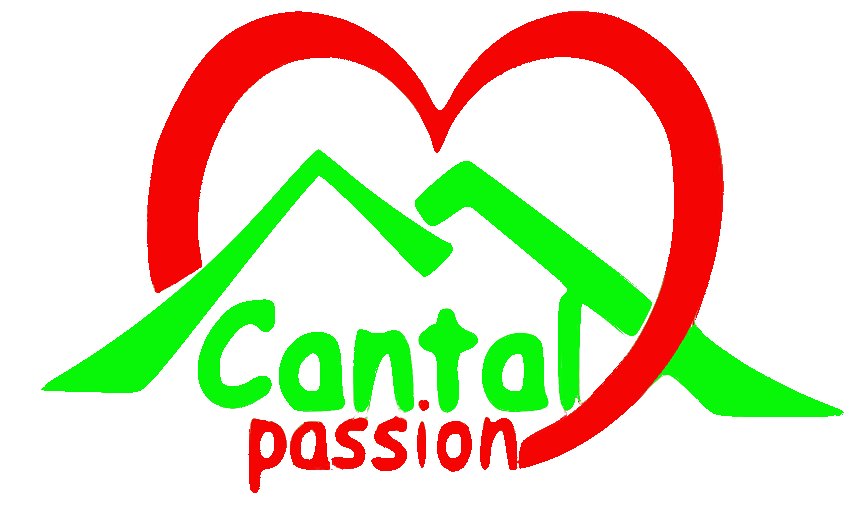"Moins de 2,5% des auteurs adressant un manuscrit aux éditeurs voient leur livre publié. Je ferai donc partie des 97,5% laissés pour compte : ceux qu’on appelle des écrivains ratés. Et pourtant j’aime écrire. J’accompagne des personnages ordinaires dans des situations vraisemblables. C’est ainsi que j’ai imaginé des enfants condamnés à n’avoir d’autre relation que la télévision. J’ai fait vivre à un quinquagénaire les bouleversements subis par un gagnant du loto. J’ai utilisé les annonces pour organiser une rencontre entre un paysan cantalien et une prof montpelliéraine. J’ai plongé dans un piège un jeune écrivain pour étudier le fonctionnement du pouvoir. Et... d’autres encore. Ecrire c’est aussi vouloir rencontrer des lecteurs. Les nouvelles techniques d’impression me permettent de faire imprimer mes romans à la demande, en petite quantité. L’évolution des moyens de communication peut m’aider par la création d’un site. Je vais informer ... le monde entier (!) de la parution de mes romans. Si tout va bien, j’aurai peut-être ... deux ..., rêvons ..., même trois ou quatre lecteurs". J.-C. Champeil
* * *
La Chute
Jean-Claude Champeil, auteur cantalien
1.1 11
Il arrive essoufflé chez le notaire où sa femme l’attend, dans le bureau du tabellion. Il répète ce mot qu’il trouve ridicule depuis qu’un client lui a dit qu’on nommait ainsi ces officiers ministériels. Tabellion ! Il se détend un peu. La voix de sa femme le hérisse très vite. Elle ergote. Elle hésite. Elle ne sait pas bien …
Lui, tient à sa brasserie. La colère va l’emporter quand elle se décide à signer.
« Tout est en ordre. Le reste est du ressort du juge » conclue le notaire en les raccompagnant.
Dunant se sent cocu deux fois parce que dépossédé. Il assène une gifle à sa femme, si violente qu’elle est projetée contre le mur. Le notaire se précipite pour l’aider à se relever.
« Vous n’auriez pas dû… »
« Ta gueule le tabellion ! Toi aussi tu la sautes ? »
L’histoire fait le tour de la petite ville. Dunant l’a racontée cent fois. De nombreuses variantes ont conduit sa femme à le supplier pendant que le notaire affolé rentrait par la fenêtre. Deux employés l’emportent, ivre mort, en fin d’après-midi. On parle de dents cassées, de fracture du crâne, d’intervention policière, d’internement psychiatrique…
Le lendemain, le bar ne désemplit pas. Dunant a retrouvé sa place, son rire et ses histoires. Il rabroue les indiscrets, bous cule ses serveurs et cuisiniers. Il est égal à lui-même, jovial et sûr de lui. Il est rassuré en voyant que les notables sont toujours là.
Les élections se préparent. Il est très sollicité. Le Maire lui propose un poste d’adjoint. Le chef de l’opposition sollicite son soutien. Une liste de commerçants pourrait être constituée. On lui demande d’en prendre la tête.
Il est ravi, mais il sait que ses clients viennent de tous les horizons. S’il choisit un parti, il est assuré de perdre les autres. Sa vie n’est pas à l’Hôtel de Ville. Elle est ici, dans sa brasserie où il règne sans partage. C’est sa famille et sa base de loisirs. Sept jours sur sept il est présent. Il s’est juste libéré pour se rendre chez le juge qui a prononcé le divorce.
Sa femme n’a pas déposé de plainte.
Il garde l’essentiel.
Une jeune caissière sourit aux clients. Elle le rejoint, les soirs où il le lui dit, dans sa chambre au-dessus.
Il ne lui manque rien.
Son horizon est limité à la terrasse.
Le monde entre chez lui.
Son banquier lui-même se déplace pour le conseiller.
Quand on lui parle de crise, il étale sa prospérité. « Du travail, il y en a pour ceux qui le veulent. Les feignants ont toujours existé. Et on leur donne des primes, des R.M .I., des allocations. C’est tout bénéfice pour moi puisqu’ils me l’apportent aussitôt. Ceux qui sont pauvres le veulent bien ! »
Pour ne pas perdre de client il sait adapter ses remarques aux idées politiques de chacun.
1.2.
Un inspecteur des impôts vient contrôler ses comptes. C’était le domaine de sa femme et du cabinet comptable. Dunant sort ses registres. La jeune caissière est moins performante que jolie. Sa mission consiste simplement à taper les notes et rendre la monnaie. Vite lassé par les questions, Dunant hausse le ton et refuse de répondre en menaçant de faire intervenir ses amis hauts placés.
Dès le lendemain, il est convoqué à la Direction des Services Fiscaux, alors que deux inspecteurs viennent vérifier la régularité des embauches et les stocks.
Les déclarations apparaissent très vite insuffisantes ou même fausses.
Plus les jours passent et plus la gestion de l’entreprise semble douteuse. Il a beau expliquer que l’achat de sa maison et celui de la villa d’Arcachon l’ont conduit à prélever beaucoup sur les fonds de la brasserie, que ces maisons appartiennent maintenant à sa femme, que c’est donc vers elle qu’il faut se tourner… Le redressement annoncé assomme Dunant : il doit près de trois millions pour les quatre dernières années. Il se précipite chez le Maire qui promet son soutien. Le Député annonce à son tour qu’il va s’occuper du dossier.
Les employés, informés des conditions légales de travail, se sont plaints. Les horaires étaient toujours dépassés. Les heures supplémentaires n’étaient pas payées.
La réaction de Dunant est violente : « est-ce que je compte mes heures moi ? Je vous donne du travail ! Vous n’avez qu’à partir. Je trouverai facilement des remplaçants. »
Les Prud’hommes sont saisis. L’URSSAF intervient pour les salariés non déclarés. Le patron nie le travail au noir : « j’aidais ces jeunes en les formant et en leur donnant un peu d’argent ! »
Bientôt, c’est le banquier qui s’inquiète. Il refuse tout découvert. Les fournisseurs de la brasserie n’acceptent plus de livrer qu’après avoir été payés.
Dunant s’assombrit et accable de ses plaintes les clients désireux de passer un moment paisible. Ils ne reviennent plus.
Les dossiers s’épaississent. Les échéances ne sont plus honorées.
La faillite est prononcée par les juges du Tribunal de Commerce.
Dunant, qui n’avait fait aucune distinction entre ses fonds personnels et ceux de son entreprise, perd tout dès l’énoncé de la décision. Le gros 4X4 qu’il aimait montrer à ses clients est saisi lui aussi.
Ses anciens amis ferment leur porte à celui qui est décrit par tous comme violent, noceur, abusant des jeunes femmes et des pauvres gens. Ils savaient tout de lui depuis longtemps, mais il était riche. Ces abus sont devenus intolérables maintenant qu’il n’a plus rien. « Moi aussi j’ai des frais…La vie devient de plus en plus difficile…j’aimerais pouvoir t’employer mais je licencie déjà mes salariés… »
1.2 13
Dunant se réfugie dans un hôtel à bas prix en sortie de la ville.
Plus personne ne le salue.
Le voilà devenu transparent.
Le regard des autres le transforme à ses propres yeux. Sa démarche s’alourdit. Ses épaules s’affaissent. Des poches sous ses yeux surmontent la barbe qu’il ne coupe plus. En fin de journée, dans les petits bistrots des ruelles sombres, il lui arrive de retrouver les ivrognes qu’il chassait de sa brasserie.
Ce matin, il se lève bien décidé à remonter la pente. Il va se venger. Il reprendra son bien.
La brasserie a rouvert. La décoration est refaite. Une partie du personnel est là. La petite caissière a repris sa place.
Il n’ose pas entrer. Il reste sur le trottoir, de l’autre côté de la rue.
Il s’éloigne tête basse.
Un jour il retrouvera sa place.
Ils verront !
Les courriers adressés en réponse à des annonces ou à des amis demeurent sans effet.
Il est trop vieux.
Il n’a pas le bon profil.
La plupart du temps aucune réponse ne lui est faite.
Un de ses cuisiniers, installé à la Réunion, lui dit qu’il est prêt à le prendre comme maître d’hôtel. Il se souvient de ce jeune sortant de l’école. Il l’avait gardé quelques mois. C’était au tout début. Il travaillait sans discuter ni compter les heures. Considérant qu’il était en formation, Dunant ne le déclarait pas et le payait très peu. Il était parti un jour en laissant sa cuisine en ordre. Son patron, désemparé, avait dû annuler les repas de cette soirée.
Francis !
Il lui était donc reconnaissant. Sans doute regrettait-il son départ cavalier.
Dunant se renseigne. Le voyage coûte neuf cents euros. Il essaie de mettre en avant sa situation difficile, mais rien n’y fait.
Il entreprend la tournée de ses amis. Certains donnent dix euros, la plupart évoquent leur propre situation difficile.
Il décide d’aller voir sa femme.
« Que veux-tu ? » Demande la voix sortant de l’appareil qu’il avait fait installer pour éviter les importuns. Il sait qu’elle le voit par l’intermédiaire de la caméra toujours en place.
« J’ai besoin d’argent. Je suis au bout du rouleau… »
« En quoi ça me regarde ? »
« Pardonne-moi. Je regrette de t’avoir giflée. »
« S’il n’y avait que ça. Tu oublies les années de mépris, tes maîtresses affichées, tes contrôles de mes moindres dépenses… »
« Laisse-moi au moins entrer. »
« Nous n’avons rien à nous dire. Tu as cessé d’exister pour moi. Ça ne me fait même pas plaisir que la vie te mette à ta vraie place. »
« J’ai trouvé un travail. Chez Francis. Tu te souviens du jeune cuisinier qui nous avait laissé tomber. C’est à la Réunion. Il me faut mille euros pour le voyage. »
Le grésillement de l’appareil lui signifie qu’elle n’écoute plus.
Il entre dans une épicerie pour acheter un litre de vin. Il ne veut pas dépenser dans un bar ce qu’il a reçu dans sa quête.
Il boit son vin au goulot, assis sur un banc. Il ne se cache même plus.
1.3 14
Dunant ne voit plus les autres.
Il somnole en tenant sa bouteille vide.
En ouvrant les yeux, il trouve une enveloppe sur ses genoux. C’est un chèque de sa femme : mille euros. Elle est trop heureuse de savoir qu’il s’en va au-delà de l’équateur.
Il se précipite à l’agence de voyage. L’hôtesse lui trouve une place. Il part dans trois jours.
Á la gare, il découvre qu’un aller pour Paris est au-dessus de ses moyens. Il partira en stop !
Calés dans leur égoïsme les automobilistes passent sans le voir.
Après une heure passée sur la route avec le pouce levé ses paroles lui reviennent quand il découvrait un auto stoppeur : « feignant ! Marche ! Ça te fera du bien. »
Il marche.
Un camion lui fait parcourir quelques kilomètres. Des jeunes l’emmènent à Clermont. Il quitte la ville et marche jusqu’à la nuit. Il décide de s’abriter dans une grange. Au matin, il atteint le péage. Il a écrit sur un carton « Paris », et, au-dessous en plus petit « S’il vous plaît ma vie en dépend. »
Les gens montent leurs vitres en regardant ailleurs.
Un vieil homme dit : « venez. »
Au moment où il s’assied, le conducteur lui dit : « J’espère que vous n’êtes pas un bandit. Je n’ai rien qui ait de la valeur. Ma vie elle-même ne vaut plus grand-chose. »
Dunant raconte son voyage. Comme le vieux l’écoute, il dit aussi ses infortunes, les vexations, le mépris des gens. « C’est comme si je n’existais plus. Je compte moins qu’un objet. »
Il se lance dans le récit de sa vie d’autrefois : sa brasserie, ses amis, son travail, ses projets…
En s’arrêtant dans une station service, le vieil homme dit : « demandez-leur d’en mettre pour trente euros. J’entends mal et j’ai toujours du mal à répondre si on me pose des questions. »
Un sourd !
Lui qui se sentait compris et soutenu par quelqu’un qui l’écoutait. C’est un sourd ! Il rit sans pouvoir s’arrêter. Il lui revient en mémoire tous ces gens qui lui racontaient leur vie. Ils avaient besoin de parler. Et lui n’écoutait pas.
Il a parlé. Á un sourd.
Tout au long de la route, il recommence à dévider ses projets, son passé, ce qu’il réussira, son retour triomphant…
Á Paris, Dunant visite les amis qui le recevaient lors de ses passages avant de séjourner chez lui ou dans sa villa arcachonnaise. Il a reçu d’eux des réponses évasives et des cours sur les difficultés économiques lorsqu’il les a sollicités. Dès son entrée les visages se ferment. Les mains sont longues à prendre la sienne. Personne ne l’embrasse. Seule l’annonce imminente de son départ pour la Réunion détend l’atmosphère. On le félicite pour son courage. On l’invite même à déjeuner ou dîner. On lui propose même un lit.
Dunant n’est pas dupe. Il sait qu’il ferme le livre du passé en évoquant les fêtes et les folies anciennes. « Envoie-nous une carte et fais vite fortune » entend-il régulièrement, et jamais : « tu peux compter sur moi en cas de difficulté. »
Ces retrouvailles lui rendent son allant d’entrepreneur capable de déplacer les montagnes. Son avenir est dans ses mains. Il va réussir et il reviendra. Tous ces faux amis verront qui il est véritablement. C’est un conquérant qui attend l’avion. Il sourit aux femmes. Il décrit ses projets à des interlocuteurs étonnés qu’un homme de cette importance voyage avec les modestes vacanciers et non avec les hommes d’affaires et les notables. Ils apprécient cet homme qui a su rester simple malgré sa réussite.
1.4 15
La chaleur l’accable dès sa descente d’avion.
Il n’avait pas pensé à la différence de climat.
Francis n’est pas là. Il a dû avoir un contretemps. Dunant marche dans l’aéroport. Il se sent comme neuf. Personne ne le connaît. L’accablement des derniers mois a disparu. Seule, la rage de se venger l’habite toujours. Il va se reconstruire. Il prouvera sa valeur.
Francis ne s’excuse même pas quand il l’appelle : « trouve un bus. J’ai du travail. Débrouille-toi. »
Le combiné à la main, Dunant reste un long moment hébété. « Débrouille-toi ! » Assommé par ces mots, il n’entend plus les bruits qui l’entourent.
Francis n’a pas trente ans. Il l’appelait « Monsieur ». Il le vouvoyait bien sûr, comme tous les employés. C’était pour le standing de la maison. Même celles qui partageaient occasionnellement son lit continuaient de lui dire « vous ».
Les rôles sont inversés. Dans ces pays on tutoie facilement. Mais ce ton…
La navette le conduit au centre de Saint-Denis.
Il admire l’océan dominé par les montagnes vertes. Il n’est pas insensible à la beauté de ces femmes de toutes les couleurs, si légèrement vêtues que leur corps semble s’offrir.
Il attend le car pour Saint-Pierre au milieu d’hommes, de femmes et d’enfants pour qui le temps ne semble pas compter. Ils sont assis sur leurs valises et leurs paquets, parfois même sur le sol. D’autres restent accroupis sans paraître se fatiguer. Tous parlent et plaisantent dans une langue dont il ne comprend qu’un mot de temps en temps. « C’est du créole » lui dit une jeune femme « nous connaissons tous le français. Si vous restez ici il vous faudra l’apprendre. » Elle lui dit qu’il est un « Z’oreil ». C'est-à-dire un métropolitain. Elle lui parle des « Malbars » et des « Z’arabes », tous venus de l’Inde, des « Cafres » descendants d’esclaves africains ou malgaches et des « Yabs », les petits blancs des hauts. Il aurait aimé continuer à parler avec elle, mais c’est une grosse noire qui s’assied près de lui. Contre lui, qu’elle repousse pour loger ses fesses et ses paquets. Placé du mauvais côté, il ne voit défiler que les falaises enserrées sous des filets de câbles.
Á Saint-Paul, Dunant parvient à changer de place. Le car suit une route étroite à flanc de montagne. Il admire la végétation exotique et la splendide vue, sans pouvoir oublier la chaleur accablante. Lorsque le vent ne pénètre plus par la vitre, la sueur ruisselle sur tout son corps. Et les arrêts sont nombreux. Partout où un voyageur attend sous le panneau annonçant une station. Il voit défiler « Les avirons », « L’étang salé », « Saint-Louis », et bien d’autres lieux au nom inconnu. Ils retrouvent la quatre voies qui les conduit à Saint-Pierre.
L’océan est à nouveau tout proche. La chaleur toujours présente.
L’hôtel restaurant de Francis est un bâtiment modeste d’apparence coquette. Par le hublot de la porte de la cuisine, Dunant observe son ancien cuisinier. Il a un peu grossi, mais il est toujours aussi blanc. La plage doit le laisser indifférent. Ils sont deux à s’affairer près de lui.
« Tu en as mis du temps. Je t’attendais plus tôt » dit sèchement Francis.
« Si tu avais envoyé quelqu’un me chercher je serais là depuis longtemps. »
« C’est ça. Tu me faisais conduire chaque jour quand je travaillais chez toi. »
« Mais…tu habitais… »
« Je n’ai pas de temps à perdre. Toi non plus d’ailleurs. Rejoins Denis au bar. Il va te dire ce que tu dois faire. Il faut dresser les tables. Les premiers clients vont arriver. Encore un mot : tu ne me tutoieras plus quand nous serons au travail. C’est pour le standing de la maison comme tu disais. En fait, comme nous nous verrons peu en dehors du travail le plus simple est que tu dises toujours « Monsieur ».
1.5 16
Sous le choc de cet accueil et de la fatigue accumulée, Dunant va vers le jeune Noir qui met en place les nappes.
« Je m’appelle Henri. Henri Dunant. Je viens de… »
« Je sais. Le patron nous a parlé de toi. Pose ta valise derrière le comptoir. Ta chemise mouillée fait mauvais effet. »
« Où est-ce que je peux m’habiller ? Dis-moi où est ma chambre. »
« Ta chambre ? Tu verras avec le patron. Change-toi dans les toilettes. »
Dunant se rase. Il aurait aimé prendre une douche et dormir un peu. La fatigue commence à peser.
Quel accueil !
Francis l’aurait-il fait venir pour se venger ?
Il doit se taire. Accepter. Travailler. C’est sa seule chance.
Après avoir passé sa tête sous le robinet d’eau tiède, il revient dans la salle à manger.
Francis est là. « Tu feras ce que te dira Denis. Il s’occupera des Créoles et toi des Z’oreils et des touristes. Nous mettrons les choses au point après. »
Dunant suit les instructions du grand Noir.
« Alors tu as fait faillite. »
« Oui. Enfin c’est le fisc qui m’a tout pris. J’avais créé une brasserie…une belle affaire… »
« Il paraît que tu étais un patron plutôt dur. Si c’est toi qui as formé Francis, je veux bien le croire. »
« Dur ? Je ne crois pas. Je bossais. Mes employés devaient en faire autant. »
« Moi aussi j’ai tenté ma chance. En France. Mais je suis Black. On dirait que l’esclavage n’a pas été aboli. Ici c’est par toujours super, mais c’est chez moi. J’ai les copains. La famille. »
« Tu es bien payé ? »
« Tu vas voir. On contrôle encore moins qu’en France. Les boulots sont rares. Quarante pour cent de chômeurs dans l’île. Les patrons ont le beau rôle. On apprend à fermer sa gueule. »
Les premiers clients arrivent. Les deux hommes se relaient au bar et dans la salle. Dunant a parfois du mal à comprendre les commandes. On se moque de lui. « Alors Z’oreil, tu parles pas le créole ? Il va falloir t’y mettre. »
« J’y compte bien. Dans huit jours je le comprendrai. »
Malgré le dépaysement et les clients inconnus, Dunant est à l’aise. Les bouteilles sont les mêmes. Les assiettes aussi. Il plaisante. Il accepte les moqueries.
Á la fin du service, Francis vient dans la salle. Il fait le tour des tables et parle avec les derniers clients. Le bon cuisinier a appris l’accueil.
« Tu te débrouilles bien. Ton affaire a l’air de marcher. »
« Merci. Je t’ai dit de ne pas me tutoyer. »
« Il n’y a personne. »
« Je suis toujours le patron. Souviens-toi comment c’était chez toi. Finis de débarrasser et occupes-toi de la vaisselle. Après tu seras libre jusqu’à dix-sept heures. »
« J’ai besoin de repos. L’avion et le car m’ont fatigué…où est ma chambre ? »
« Où tu voudras. Tu ne me logeais pas. Débrouille-toi ».
1.6 17
Denis lui conseille de faire la sieste sous les filaos au-dessus de la plage : « tu ne seras pas le seul. »
Insensible à la beauté des lieux, Dunant s’affaisse au pied d’un arbre. Le sommeil le terrasse d’un coup.
Denis le secoue : tu vas te faire engueuler. Il est cinq heures et demie. Le patron m’a envoyé. »
Francis est au bar : « c’est la dernière fois que j’accepte un retard. Si tu veux rester, tu devras respecter les horaires. »
« J’étais crevé… »
« Je m’en fous. C’est mon hôtel qui compte. Et les clients. Je t’ai fait venir parce que tu connais le boulot et que tu ne comptais pas tes heures. Les candidats à ton poste ne manquent pas. »
« Excusez-moi. Ça ne se reproduira pas. »
Après une toilette aussi brève que celle du matin, Dunant reprend le travail.
Il n’a pas le temps de penser. Ils ont moins de repas à servir mais les clients sont plus nombreux au bar. Á minuit, les derniers s’en vont.
Les verres sont essuyés. Les tables sont propres et le sol balayé.
Il fait nuit noire. Dunant ne sent plus la fatigue. Sur les nerfs comme il disait lorsque s’enchaînaient les journées difficiles.
« Je t’ai trouvé un endroit où habiter. C’est près de chez moi. Chez une cousine. »
« Pas trop cher j’espère ? »
« Non. Pas luxueux non plus. Ça va peut-être choquer le Z’oreil qui débarque. On est nombreux à vivre dans ces conditions. Ici les bidonvilles sont cachés. »
Ils atteignent une « ravine », comme dit Denis, sur les pentes de laquelle s’accrochent quelques cabanes en tôle éclairées par la lune.
Denis pousse une porte dont le grincement fait aboyer un chien qui en réveille dix alertant les autres. La ville entière est secouée par les cris de la meute. La lueur de la flamme du briquet laisse apercevoir un matelas posé à même le sol. De l’autre côté d’une table, un homme ronfle.
« C’est Ary. La case lui appartient. Il est Rmiste, et amateur de rhum et de zamal. C’est un brave type. Il sait que tu viens. »
La porte fait le même bruit sinistre en se refermant, déclenchant à nouveau les hurlements en cascade.
Les ronflements continuent.
Dunant s’effondre dans le sommeil sur le matelas baigné d’odeurs multiples.
Le soleil entrant par le trou qui sert de fenêtre est déjà brûlant.
Dunant cherche les toilettes. L’odeur le guide vers une baraque faite de planches disjointes. Deux pierres encadrent un trou.
En retournant à la case, il découvre un tuyau terminé par un robinet en plastique. Le tout est accroché à une branche basse de l’arbre qui ombrage la cour. L’eau coule sur sa tête et son corps sans parvenir à le rafraîchir.
1.7 18
La porte claque en heurtant la tôle du mur. Un squelette sans âge, sur lequel un vieux short a du mal à rester accroché, apparaît.
« C’est toi qui vas vivre ici ? » demande l’homme en s’approchant.
Ses yeux sont d’un jaune sale, strié de vaisseaux noirs.
« Je m’appelle Ary. J’étais marin avant. Dans la marine militaire. Maintenant je suis alcoolo. Tu veux un coup de rhum ? »
« Non merci. Je vous remercie de m’héberger. Je ne resterai pas longtemps. Je vais trouver un appartement… »
« Ouais. En travaillant à l’Hôtel de l’Océan tu auras du mal à payer le loyer. Ici c’est cent euros par mois. Moins si tu apportes du rhum ou de la bouffe. Surtout du rhum, parce que je mange peu. Tu entres et tu sors quand tu veux. Il n’y a rien à voler. Ne laisse rien traîner. La police ne chercherait pas ce qu’on t’aurait pris. Elle ne vient que s’il y a un mort. Et encore pas toujours. L’océan en a gardé plus d’un. »
Dunant se rase et lave sa chemise qu’il accroche à une branche. Il devra trouver un fer à repasser mais il n’y a pas d’électricité dans la case. Il le repassera à l’hôtel.
Il achète un ananas qu’il mange face à la mer. La misère anonyme sous le soleil lui paraît moins dure que chez lui. Il travaillera jour et nuit s’il le faut. Il économisera, et dans quelques temps…Une gérance d’abord, ou une toute petite affaire…
Il s’approche des camions bars et des camions pizzas stationnés sous les arbres. Investissement minimum. Frais d’entretien réduits. Il se renseignera.
C’est empli d’optimisme qu’il retrouve l’hôtel.
Francis est dans le petit salon où les clients ont déjeuné. Il a sûrement travaillé dur pour acheter cette affaire. Enfant d’une famille pauvre il n’avait rien à attendre de personne. Il montera encore, Dunant en est certain.
« Assieds-toi. Parlons argent. Soit je te déclare et je te paie cinq heures par jour, étant entendu que tu devras travailler selon les besoins du restaurant, soit je te donne trente euros. Pas la peine de te faire un dessin. Tu connais tout ça mieux que moi puisque c’est toi qui me l’as appris. «
« C’est peu pour ce que je fais. »
Francis éclate de rire : « tu as la mémoire un peu usée sans doute. Tu me donnais quinze euros ! »
« Mais tu…vous sortiez de l’école. Et il y a dix ans… »
« C’est pour ça que je te donne le double. Je te laisse le choix : vingt cinq jours à vingt euros ou trente à trente. Je préfère te déclarer et que tout soit en règle. »
« Et je ferai quinze heures par jour pour cinq déclarées. Je choisis les trente euros. Est-ce que je pourrai être payé chaque jour ? »
« Je comprends que tu aies des frais. De toutes façons ça m’arrange. Tu sais qu’il est plus facile de sortir trente euros chaque jour de la caisse que neuf cents une fois par mois. Voilà vingt euros pour hier, puisque tu n’as pas fait la journée complète. Ce soir tu auras les trente pour aujourd’hui. Allez ! Au travail. C’est l’heure d’ouvrir le bar. »
1.8 19
La matinée passe vite. Les premiers clients arrivent. Ils sont plus nombreux pour le déjeuner que la veille pour le dîner. Dunant trouve ses marques. Ils se complètent bien avec Denis. Á quinze heures, à la fin du service, il va au camion bar le plus proche. C’est un Belge qui le tient. Il raconte son installation. C’était à Saint-Gilles, la station à la mode. Les concurrents lui ont créé des ennuis, amplifiés par la police et les lenteurs de l’administration. Le camion pizza, ouvert seulement le soir, lui appartient aussi. Il envisage d’en acheter un second.
« Ça m’intéresserait de travailler avec vous » dit Dunant « je connais le métier. J’avais une brasserie en France jusqu’à ce que le fisc me la prenne. Il suffirait de m’apprendre à faire les pizzas. »
« On peut voir ça. J’ai essayé plusieurs fois de faire travailler des créoles, mais ils sont très lents. Un jour ils étaient là et pas le lendemain. Leur bébé était malade ou la voiture en panne…Que fais-tu ? »
« Je suis à l’hôtel de l’océan. »
« Chez Francis ! C’est un garçon sérieux. Il a commencé comme cuisinier, puis il a acheté un camion bar. Il faisait des reps bon marché. Il a pris la gérance de l’Océan. Il l’aurait même acheté. C’est un sacré bosseur. Tu ne vas pas t’ennuyer. »
« Le travail ne me fait pas peur. Je m’appelle Dunant. Henri Dunant. »
« Moi c’est Jean Smet. Reviens me voir. On fera connaissance. »
« Comptez sur moi. »
« Tu peux me tutoyer. Nous devons avoir le même âge. »
« J’ai quarante-trois ans. Et toi ? »
« Quarante-deux. Tu vois, on aurait pu être à l’école ensemble. »
Dunant repart tout joyeux à son travail. Les journées sombres sont derrière lui. L’abandon général, le mépris, l’alcool…c’est bien loin. Il a un travail et des projets. Il va démarrer avec Smet, puis, en travaillant à fond…
Denis n’est pas là. Dunant doit faire face seul au service de la salle et du bar. Francis intervient de temps en temps. Il ne décolère pas : « on ne peut pas compter sur eux. Une histoire de femme ou n’importe quoi. J’en ai vu qui prenaient une journée parce qu’ils devaient aller à la Poste chercher une lettre ou un paquet. Ils arrivaient en disant qu’ils avaient été obligés puisqu’ils étaient convoqués. Je croyais Denis sérieux. C’est sa première absence en un an. »
Le restaurant est complet ce soir. Francis a appelé la jeune femme qui fait le ménage de l’hôtel. Elle aide en cuisine. Un des cuisiniers seconde Dunant. Francis explique aux clients : «un accident. J’ai été prévenu trop tard… ». Pour compenser la lenteur du service il offre le café, ou même un digestif selon l’importance de la note.
Ils nettoient ensemble la salle. Il est près de deux heures quand Dunand retrouve son matelas après avoir erré dans les ruelles et les impasses. Un insecte passe sur son visage. Y a-t-il des serpents ? D’autres animaux dangereux ? Peut-être des mygales ? Il s’efforce de rester éveillé, mais le sommeil le terrasse.
Il est plus de sept heures quand le soleil l’atteint.
Il retrouve les latrines malodorantes avant de se doucher sous le robinet.
Pourvu que Denis soit là ! Á midi les gens sont toujours pressés, mais comme c’est samedi certains doivent rester chez eux.
Sa chemise n’est plus là où il l’a mise à sécher. Ary a dû la rentrer. Il la cherche en vain dans la bicoque où tout est visible au premier coup d’œil. Rien sur la table branlante ni sur les deux chaises bancales. Il regarde sous la vieille couverture roulée aux pieds du dormeur.
On la lui a prise ! C’était facile. Ils sont tellement démunis.
Dunant avance jusqu’au bord du ravin qui sert de poubelle à tout le voisinage. Des abris tout aussi misérables que le sien s’accrochent en face, au pied des villas blanches marquant la limite de la vie normale.
C’est la France !
1.9 20
Il lui faut une chemise. Il parcourt la rue des Bons Enfants et emporte ce qu’il cherche pour cinq euros. Il va devoir trouver une solution pour ses vêtements. Il pense aux animaux qui circulent sur son matelas, aux maladies…il ne s’est même pas renseigné en partant. Tout avait si peu d’importance…
Denis est au bar avec un bras en écharpe. Sa moto a été heurtée par une voiture qui ne s’est même pas arrêtée.
« Je suis resté KO jusqu’à ce que l’ambulance me dépose à l’hôpital. J’ai le bras cassé. C’est tout. Je ne pourrai pas conduire pendant un bon moment. De toutes façons ma moto est foutue. Elle a été mise en pièces pendant que j’étais à l’hôpital. Mes frères n’ont retrouvé qu’une épave. »
« Tu te mets en congé ? »
« Non. Francis veut bien me garder. Je pourrai m’occuper du bar et peut-être aider au service. Mais pour le ménage… »
« On se débrouillera. Il faut que tu gardes ta place et ta paie. »
« Oh ! Ma paie ! Il m’a annoncé que je n’aurai que la moitié puisque je ne travaillerai pas à fond. Il faut que je rembourse l’hôpital. »
« Tu n’es pas assuré ? Il ne te déclare pas ? »
« Je travaille au noir. Et toi ? Tu es en règle ? »
« Non. Mais je viens d’arriver. Je ne vais pas rester là longtemps. »
« C’est toujours comme ça ici. Tout le monde le sait et personne ne fait rien. En France tous les salariés sont en règle. Ils sont couverts en cas de maladie ou d’accident. »
Dunant ne répond pas. Il pense à tous ceux qu’il a employés illégalement. Certains étaient demandeurs d’emploi et bénéficiaient de la sécurité sociale, les autres…ils étaient jeunes…les parents devaient les aider. Ceux qui étaient seuls…
Après le déjeuner, Dunant va boire un café au camion bar. C’est jour de marché. Depuis le lever du soleil, les douze sièges sont occupés. Smet débite les bières, les rhums et les cafés.
Sur plus d’un kilomètre, la pelouse et les allées ombragées entre route et océan sont encombrées d’étalages chargés de fruits et de légumes, de volailles et de fleurs, et même de souvenirs made in Madagascar ou Indonésie, sur lesquels se précipitent les touristes avides d’authenticité réunionnaise. Les poulets rôtissent à côté des friteuses à samoussas et beignets.
Smet dit qu'il fait aujourd’hui le chiffre équivalent à celui du reste de la semaine. Dunant l’aide à servir les clients attablés. Vers seize heures, il ne reste que quelques touristes.
« Merci. C’est vrai que tu connais le boulot. Le samedi je prends un jeune pour m’aider. Il m’a laissé tomber. On ne peut jamais leur faire confiance. »
« Quand je m’occuperai de ton camion pizza je pourrai être ici le samedi matin. »
« On n’en est pas encore là. Il manque les autorisations. Quand je pense aux risques et aux soucis… »
« Nous pourrions nous associer. »
« Tu as de l’argent ? »
« Tu prendrais ma part sur mon salaire. »
« Il fait payer le camion et son équipement. »
« Combien ? »
« Cinq mille euros pour le camion et autant pour le four et le reste de l’équipement. »
Dunant sourit en pensant à ce qu’il gagnait avec sa brasserie. Il n’a aucun moyen de se procurer cette somme dérisoire.
1.10 21
« Et les banques ? »
« Tu en connais une qui prête aux pauvres ? »
« Tu n’es pas pauvre. Tu as tes deux camions. »
« Tu crois que ça impressionne un banquier ? Cinquante pizzas à huit euros…tu enlèves les produits et les frais…c’est pas le Pérou. »
« Je suis sûr qu’on peut y arriver. Je vais économiser. Je suis nourri. Le logement ne me coûte pas cher. Je peux garder le reste. »
« Ne laisse rien traîner. Tout disparaît vite ici. Les petits loubards ont l’œil. Je me suis fait braquer trois fois déjà. »
« Je ferai attention. Je sais me défendre. »
Dunant rejoint l’hôtel. C’est vrai qu’il ne peut rien laisser dans son taudis ou à l’hôtel. Il faudra qu’il ouvre un compte. En attendant il gardera son argent sur lui.
Un mois déjà.
Il a appris qu’il n’a rien à redouter des animaux. Il n’y a ni fauve, ni serpent ni mygale. Les cafards courent sur son lit et les margouillats crient dans le noir. Ce ne sont que de petits lézards chasseurs de mouches dont les ventouses facilitent les déplacements sur les murs et au plafond. Les moustiques sont les seuls agresseurs avec les cent pattes. Ces sortes de gros mille pattes ont une morsure très douloureuse. Il devient moins sensible aux piqûres des moustiques. Un voile, posé sur le dossier des chaises de part et d’autre du matelas, lui sert de moustiquaire.
Smet est d’accord pour s’associer avec Dunant. Dans un an il aura la somme nécessaire. Tout sera possible.
La lune est masquée par de lourds nuages. La saison des cyclones approche. Les rares gouttes ne parviennent pas à rafraîchir l’air.
Dunant éteint sa lampe. Les obstacles lui sont connus.
Alors qu’il approche de la cabane, un bruit l’alerte. Au moment où il braque sa lampe, un objet le frappe à la tête. Il bondit sur son agresseur dont il écrase le nez d’un coup de poing. Ils sont plusieurs à l’agripper. Les coups pleuvent. De poing. De pied. De bois et de galets.
Dunant reprend conscience sur son matelas mouillé. La pluie fait résonner les tôles sous lesquelles elle commence à passer. Il tente de se lever et retombe aussitôt.
Denis est près de lui.
« Ils t’ont bien amoché. Ne bouge pas. »
« Qu’est-ce que j’ai ? »
« Je n’en sais rien. Je viens d’arriver. Ary m’a prévenu. Nous t’avons trouvé devant la case. »
« J’ai peut-être quelque chose de grave. »
« Tu n’es pas mort. C’est déjà ça. Tu es resté inconscient pendant plusieurs heures. Le plus dur est passé. »
Dunant bouge ses jambes et ses bras. Il a mal partout mais tout fonctionne.
« J’ai mal à la tête. Les salauds ont mis le paquet. »
« Qu’est-ce qu’ils t’ont pris ? »
« Merde ! Mon fric ! »
Il fouille son pantalon. S’énerve. Grimace de douleur et s’effondre en pleurant.
« Ils m’ont tout pris. Tout ce que j’avais gagné depuis que je suis là. »
« Tu n’as pas de compte en banque ? »
« Je me disais tous les jours que j’allais en ouvrir un. Mille euros pour un banquier c’est ridicule. J’avais peur des suites de ma faillite. Peut-être reste-t-il des sommes à verser à mes créanciers. Le fisc…J’avais tout sur moi. Ils m’ont tout volé. Je dois recommencer. »
« Avec la tête que tu as, ça m’étonnerait que Francis te reprenne. »
« Il le faut. Je resterai en cuisine. Je ferai le ménage. »
1.11 22
Il se lève, titube et retombe sur le matelas.
« Un cyclone est annoncé » dit Denis « le restaurant va être fermé pendant un jour ou deux. Après tu verras. Je t’ai apporté de l’eau et quelques fruits. Repose-toi. Je reviendrai te voir. »
Dunant replonge dans un sommeil comateux.
Tout tremble autour de lui quand il s’éveille. L’eau monte autour de son matelas trempé. Le vent vrombit dans les tôles dont un coin se soulève et bat. Tout son corps est douloureux. Sa tête est déchirée par le bruit. Il se roule en chien de fusil.
Des images se succèdent qui n’ont aucun sens. Sa villa d’Arcachon battue par les vents. Un orage dans les prés quand il était adolescent. Une mêlée de rugby effondrée sur lui qui hurle de douleur. Le froid et la peur le tétanisent.
Un pan de toit s’envole. Le vent et l’eau s’engouffrent en tordant les plaques qui s’arrachent une à une.
Dunant hurle sans couvrir le grondement de la tempête. La porte à peine ouverte est emportée elle aussi. Il est projeté contre le manguier au pied duquel il se couche. Il tire le tuyau pour l’enrouler autour de l’arbre et de son corps. Les trombes d’eau ruissellent en torrents. Dans les accalmies du vent il sent un grondement qui fait trembler le sol. Ce sont les arbres et les rochers roulant dans la ravine.
Il ne pense plus. Terrorisé, il étreint l’arbre et serre dans ses mains les deux bouts du tuyau.
Soudain c’est le calme.
Le ciel s’éclaire.
Lorsqu’il se redresse, Dunant voit le sombre flot vomi par la montagne. Le bruit du torrent dans la ravine est comparable à celui d’un train lancé à vive allure.
Tout est haché, tordu, déchiqueté. Des tôles s’enroulent autour des arbres. Des vêtements pendent aux branches dépouillées.
Après avoir défait les nœuds du tuyau, il descend vers la ville.
Partout les gens s’affairent, clouant tôles et planches. Des ruisseaux transforment les rues en rivières. L’océan roule des vagues hautes et sombres.
Un véhicule de pompiers s’arrête près de lui : « ne restez pas dehors. Allez vous abriter » crie un Malbar.
« Je ne sais pas où aller. Tout est démoli chez moi. »
Le pompier l’aide à monter dans le véhicule qui le conduit à l’hôpital.
« Que vous est-il arrivé ? » demande l’infirmière en l’accueillant aux Urgences « ce n’est pas le cyclone qui vous amis dans cet état. »
« J’ai été agressé. Des voyous m’ont tout pris. »
Le médecin qui vient l’examine le rassure : « rien de cassé, mais on dirait que vous venez de passer dans un concasseur. Pourquoi n’êtes-vous pas venu plus tôt ? »
« Je ne pouvais pas bouger. »
« Votre famille… »
« Je suis seul. Ceux qui m’ont ramassé m’ont laissé dans une case en tôle que la tornade vient d’emporter. J’étais couché au pied d’un arbre en attendant la fin du monde. »
« C’est votre premier cyclone ? Vous êtes venu faire du tourisme ? »
« Oui. C’est mon premier cyclone. Et le dernier j’espère. Je travaille depuis plus d’un mois dans un hôtel. »
L’infirmière emmène Dunant dans une chambre : « douchez-vous. Je reviens faire les pansements. » Il repose bientôt sur le lit. Des agrafes ferment ses plaies du visage et de la hanche. Il est barbouillé de désinfectant. Des larmes coulent qui se perdent dans sa barbe naissante. On s’occupe de lui. Il n’est plus un animal abandonné.
Un homme entre pour descendre le rideau métallique de la fenêtre.
« Pourquoi faites-vous ça ? »
« L’accalmie est finie. Nous sortons de l’oeil du cyclone. La deuxième partie commence. »
Il a entendu parler de cette histoire. Il se souvient des superbes images de ce phénomène à la télévision.
Le cyclone ! Il y est depuis des mois entre les successions de violence et apaisement.
Le vent rugit subitement. Les trombes d’eau déferlent. Même s’il se sent protégé derrière les murs de béton, il ne peut s’empêcher de frissonner.
S’il était resté là-bas !
Que va-t-il faire demain ? Ils vont savoir qu’il n’a pas les moyens de payer ni aucune couverture sociale.
Un engourdissement dû aux médicaments l’entraîne doucement vers le sommeil.
1.12 23
Le rideau qui se relève ramène Dunant à la réalité.
« C’est fini » dit un jeune homme vêtu d’une blouse bleue « au moins pour celui-là. Nous en aurons sans doute d’autres dans les semaines à venir. »
« Vous en êtes sûr ? »
« Non. Personne ne le sait. Certaines fins d’été il y en a trois ou quatre et d’autres fois aucun. Sans être très fort, celui-là a causé pas mal de dégâts. »
Allumant le téléviseur il ajoute : « nous allons bientôt avoir les images de ce qui s’est passé. »
Dunant se lève pour aller aux toilettes. Il se sent mieux. Les heures de sommeil ont atténué ses douleurs.
Un journaliste annonce que l’alerte est levée. D’importants dégâts sont visibles, particulièrement dans le sud de l’île. De nombreuses habitations sont détruites. On compte déjà quatre disparus.
Dunant se demande s’il fait partie des disparus. Qui aurait pu signaler son absence ou celle de son hôte? Ary a dû chercher un abri plus sûr avant l’arrivée du cyclone.
Une jeune femme entre. « Bonjour monsieur. J’ai besoin de quelques renseignements pour votre admission. Avez-vous votre carte d’assuré social ? »
« J’ai tout perdu. J’ai d’abord été agressé. On m’a volé tous mes papiers et mon argent. Le cyclone est arrivé juste après. Je n’ai plus rien. »
« C’est ennuyeux mais nous allons retrouver les informations nécessaires. Les communications viennent d’être rétablies. L’ordinateur de la sécurité Sociale fera son travail. Votre nom s’il vous plait ? »
Dunant s’est préparé. Il n’a aucun intérêt à se faire connaître. Il a assez de dettes.
« Paul Hermant. »
« Votre adresse ? »
« 46 rue Victor Hugo à Dunkerque. »
« Votre date de naissance ? »
« 14 avril 1954. »
« Profession. »
« Agent d’assurance. »
« Vous avez une mutuelle ou une caisse complémentaire ? »
« Non. »
« Je vous remercie. Avec ces informations je vais pouvoir constituer votre dossier d’admission. Je reviendrai d’ici une heure ou deux. Reposez-vous. »
Elle croise en sortant une jeune femme qui pousse un chariot chargé de plateaux-repas.
« Bonjour monsieur. Ça va mieux ? »
La mince Cafrine, moulée dans sa blouse rose, lui sourit.
« Bonjour mademoiselle. Je vais mieux depuis votre entrée. »
Le rire joyeux accompagne le départ de la visiteuse.
Dunant se dit que la vie est facile pour les citoyens reconnus. Il en a profité. Il retrouvera ce monde.
Il mange avec plaisir le léger repas. Prolonger son séjour ne peut lui amener que des désagréments
Il doit partir.
Il sort dans le couloir, vêtu se son pyjama blanc. Une porte « réservé personnel » l’attire. C’est un vestiaire. Il enfile rapidement une chemise blanche et un pantalon beige. Des chaussures de toile complètent sa tenue. En fouillant les autres vêtements il trouve quelques pièces qu’il empoche.
Il se sent bien un peu faible en retrouvant la rue, mais il décide quand même de s’éloigner rapidement.
Partout les gens s’affairent. Ils entassent sur les trottoirs les branches et les morceaux de tôle, ainsi que les objets brisés apportés par le vent et le ruissellement des eaux.
1.13 24
Le camion-bar de Smet est en piteux état. Une tôle volante a ouvert une brèche dans le rideau où la pluie et le vent se sont engouffrés.
Francis range les tables et la terrasse avec Denis.
« Alors tu t’es bien reposé pendant que nous remettions l’hôtel en ordre ? »
« Denis ne vous a pas dit ? J’ai été attaqué. Je sors de l’hôpital. Mais je vais un peu mieux. Je pourrai reprendre le travail demain. »
« Je n’ai plus besoin de toi. Je me suis débrouillé en ton absence. Je voulais depuis longtemps engager une femme. C’est mieux pour les clients. Grâce à ton départ j’ai pu le faire. Tu peux chercher du travail ailleurs. »
« Mais vous ne pouvez pas ! Tu n’as pas le droit ! »
« Oh ! Le droit ! Autant que toi quand tu renvoyais une fille parce qu’elle ne voulait pas coucher avec toi. »
« Tu veux te venger… »
« Même pas. Mais je n’ai aucune raison de m’apitoyer sur ton sort. Tu ne le mérites pas. »
Une jeune blonde portant un petit tablier blanc arrive : « Francis. Quelqu’un veut retenir dix repas pour ce soir. Est-ce possible ? Veux-tu lui parler ? »
« Oui. Je viens. Va te reposer un peu. Le plus urgent est fait. »
« Voilà la spécialiste qui prend ma place ! Je vois que tu as bien appris. Elle aussi connaît ton lit. »
« Qui est-ce ? » demande la jeune fille.
« Dunant. Je t’en ai parlé. Celui qui a été mon patron en France. »
« Enchanté de vous connaître » ricane Dunant.
« Que vous est-il arrivé ? D’où viennent ces blessures ? » demande-t-elle.
« Je me suis fait rosser et dépouiller du peu que je possédais. Et maintenant vous me prenez mon boulot. »
« Francis il faut faire quelque chose. Je ne peux pas… »
« D’accord. Tu verras s’il mérite ta pitié. » Il se tourne vers Dunant : « je veux bien te prendre pour la plonge et en renfort de cuisine. Sois là à dix-huit heures. Tu auras quinze euros par jour. »
Dunant domine son envie d’insulter Francis : « vous pouvez compter sur moi. Excusez-moi pour ce que j’ai dit tout à l’heure. »
Francis entraîne la jeune fille qui l’embrasse en le remerciant.
« As-tu vu Ary ? » demande Denis.
« Il n’était pas rentré au début du cyclone. »
« Personne ne l’a revu. On croyait qu’il s’était abrité à l’école comme les autres fois. S’il cuvait son rhum sous un arbre…ça devait lui arriver un jour. J’ai vu ce qu’il reste de la case. Où vas-tu habiter ? »
« Je ne sais pas. Je vais voir Smet, le patron du camion-bar. »
Dunant s’éloigne vers la plage.
Des voitures circulent autour des branches et autres détritus.
Les agents municipaux, de l’Équipement, d’EDF, des Télécoms s’affairent partout.
Smet est devant son camion.
« On m’a dit que ta case était démolie. Je te croyais disparu. »
« J’ai passé quelques mauvais moments dans le cyclone. Des salauds venaient de me tabasser pour me prendre mon argent… »
« Tu n’es pas le seul à avoir des problèmes. Regarde. Il va falloir tout réparer. On m’a fauché mon stock. Nos projets en ont pris un coup. »
«Tu n’es pas assuré ? »
Smet part d’un rire sans joie : « Assuré ! Elle est bien bonne ! Qui accepterait d’assurer une épave sans protection ? »
« Et le camion-pizza ? »
« Ça va. Il n’a pas trop souffert. Ici c’est une saleté de tôle que le vent a projetée sur le camion. Il faut que je soude une plaque sinon tout va disparaître.
« Je pourrais coucher à l’intérieur. Ça arrêterait les voleurs. »
« Ce serait bien. Mais je n’ai pas les moyens de te payer. »
« Je ne te demande rien. Je n’ai nulle part où dormir. Ça me fera un abri. Je serai ton chien de garde. C’est la première étape vers la fortune. Je mettrai ça sur mon C.V. « Chien de garde pour camion la nuit et plongeur le jour » si j’ajoute que c’était à la Réunion, les gens imagineront un aventurier à la Cousteau. »
1.14 25
Á dix-huit heures, Dunant est à l’Hôtel de l’Océan. Côté cuisine, cette fois. Arrière-cuisine même. Il nettoie et récure les poêles et les casseroles, puis, le service avançant, les assiettes et les plats arrivent avec les verres, les fourchettes et les couteaux.
Il est plus de minuit quand Francis le libère en lui donnant huit euros : « tu n’as fait qu’une demi-journée. C’est ce que je te dois. »
La chemise blanche et le pantalon clair ont souffert de la plonge. Il devra les laver.
Smet l’attend : Fais gaffe. Il n’y a pas d’éclairage public. Le coin est plutôt sombre. Je ne peux pas laisser les lampes à gaz allumées toute la nuit. Je te prête une lampe de poche. Á demain. »
Une bouteille de bière dans une main et la lampe dans l’autre, Dunant s’allonge dans le camion. Il peut voir le ciel par le trou du rideau de fer.
Une silhouette se détache soudain. La lampe éclaire un grand Cafre surpris qui bondit en arrière. « Fous le camp ou je tire. Et ne reviens pas. Je serai là toute la nuit avec mon fusil. »
L’homme hurle des insultes et part en courant.
Dunant n’a pas peur. Il sent monter en lui une violence qu’il connaît bien. Il a eu souvent l’occasion d’affronter des ivrognes. Il sait où frapper. Les autres l’ont eu par surprise. Ici c’est lui le plus fort. Il est à l’intérieur.
Il installe deux canettes vides en équilibre. Un voleur les fera tomber.
Malgré la dureté du métal sur lequel il est allongé, il réussit à dormir. Personne ne vient. Le message sur le camion gardé par un fou portant un fusil a dû circuler.
Au lever du jour, sans perdre le camion de vue, Dunant se baigne dans l’océan. Un robinet utilisé par les marchands du samedi lui permet de laver l’eau salée.
1.15 26
Smet apporte une plaque de métal qu’ils vissent ensemble pour cacher la déchirure. Une fois peinte, elle ne déparera pas le vieux camion. Avant de partir à son travail, Dunant reçoit trente euros pour le gardiennage nocturne.
Francis l’accueille vertement : « je ne veux pas te voir venir dans cet état. Ta chemise est graisseuse et ton pantalon plein de rouille. Va te changer. Et vite ! »
Dunant ravale sa colère. Il retrouve le magasin dont les prix sont en rapport avec ses moyens. Il achète une chemisette, un boxer short et un pantalon.
Il est à nouveau sans le sou, mais assez propre pour récurer les casseroles et les marmites.
« Tu en as mis du temps » reproche Francis à son retour.
Dunant mange quelques restes en lavant la vaisselle. Au service il mangeait ce qui restait dans les plats au retour des tables. Là, il ne sait pas si ce qu’il trouve n’est pas plutôt le fond des assiettes reversé dans les plats. Il se dit que les SDF seraient heureux de partager son repas. Il peut choisir ses entrées, ses viandes et même ses desserts. Les bouteilles entamées étant récupérées pour le bar,seuls reviennent les fonds des verres qu’il n’hésite pas à boire. Son travail terminé, il rejoint Smet pour l’aider à peindre la pièce de métal. Après une courte sieste sous les filaos, il lave ses vêtements et se baigne dans l’océan tranquille.
Heureux.
Il est plongeur, sans le sou et sans domicile, et heureux. Un marginal, un pauvre type, comme il disait peu de temps auparavant, un de ceux qu’il faisait chasser de sa porte. Il a été battu, humilié, volé…mais il se sent heureux.
Il rit avec Smet à qui il raconte ses pensées : « Les situations dépendent du regard qu’on porte sur elles. Je veux toujours créer une affaire, mais peut-être plus la même. Quand je te vois vivre là, avec ton camion, au bord de l’océan…je me dis…mais bon. Pour l’instant je dois retourner à mes bacs à vaisselle. Le paysage n’est pas le même. Les odeurs non plus. On peut s’adapter à tout. »
Brigitte (c’est le nom de sa remplaçante, petite amie de Francis), le rejoint dans l’arrière cuisine : « monsieur Dunant, je voudrais que vous sachiez que je n’ai pas voulu prendre votre place. Francis avait depuis longtemps décidé d’engager une femme. Nous nous connaissons depuis plusieurs années. J’étais venue de Métropole passer un mois avec lui. J’ai décidé de rester. Après ma licence de psychologie, je n’étais plus tentée par le professorat. J’aime bien ce contact avec les gens. »
« Pour ça vous serez gâtée. Le contact vous l’aurez, avec les mains sur vos fesses, les plaisanteries plus grasses que mon eau de vaisselle et même les insultes. »
« Cela ne m’est pas encore arrivé. Je suis de taille à faire face. Je voulais vous dire que je suis prête à vous aider. »
« J’ai appris à ne compter sur personne. »
« Vous avez des amis ? »
« Des amis ! J’ai vu ce que c’était. Les copains des beaux jours et des loisirs qui savaient pouvoir compter sur ma villa d’Arcachon, mon bateau, mon fric…Pour le reste… »
« Votre famille et vos employés ont dû vous apporter leur soutien. »
« Je n’ai plus de famille. Mes parents sont morts depuis longtemps et je suis fils unique. Mes employés n’attendaient que leur salaire. C’est vrai que je ne leur faisais pas de cadeau. Francis a dû vous le dire. Comme lui ici. Comme les autres patrons. Un employé c’est fait pour travailler. Plus il travaille, moins on a besoin d’embaucher. C’est la règle simple du tiroir caisse. Ils me vendaient leur temps. »
« Certains étaient sans doute devenus vos amis ? »
« On ne passe pas des années côte à côte sans affinité. Nous nous comprenions pour le travail. Leur vie privée ne me regardait pas. Ça évite les complications en cas de maladie d’un enfant ou de perte de logement. Nous avions la brasserie en commun. Un point c’est tout. »
1.16 27
« Et votre femme ? »
« Elle m’a quitté en provoquant ma ruine. Pour les autres…j’étais le chef. Je ne cherchais pas à savoir si c’étaient mes beaux yeux qui les intéressaient ou mon fric, ou même une embauche. Je n’attendais rien d’autre que des bons moments partagés. Pour le travail nos relations restaient les mêmes. »
« Je suis sûr que vous exagérez. Vous n’êtes pas aussi dur. »
« Ce n’est pas de la dureté. C’est la vie. J’ai dû travailler à quinze ans. Déjà la plonge. Je suis devenu garçon de café. J’ai appris la cuisine sur le tas. Et la gestion aussi. Je ne devais mon argent qu’à mon travail. Personne ne m’a jamais fait de cadeau. Seriez-vous avec Francis s’il était plongeur ? »
« Bien sûr que oui. Je l’aimais quand il était chômeur. Ce n’est pas son hôtel qui m’attire. C’est lui. Quoi qu’il fasse nous serons ensemble. »
« Ouais. Comme dans les romans roses. Personne ne fait jamais rien pour rien. »
« Denis n’attend rien de vous et pourtant il vous aide. »
« C’est pour affirmer sa supériorité sur un blanc. Ou pour la reconnaissance de son dieu. En espérant une embauche le jour où je serai riche. »
« Je vous plains si vous croyez vraiment ce que vous dites. »
« La pitié non plus ne m’intéresse pas. Elle n’est pas cotée en bourse. Mais il faut que je continue mon travail si je ne veux pas me faire virer par le patron. Moi je ne couche pas avec lui. »
Une semaine est passée depuis le cyclone. Quelques tas de branches rappellent encore la violence du vent.
Smet déclare à Dunant : « il faut que tu trouves un autre endroit pour dormir. J’ai eu des réflexions de clients qui s’étonnent que j’héberge un clochard au milieu de ce qu’ils boivent et mangent. Je suis sûr que tu comprends. »
Dunant pense aux propos de Brigitte sur la générosité et l’entre aide. Tant qu’il était utile pour surveiller le camion il était accepté. Maintenant…
Ary a disparu, sans doute emporté par les eaux du torrent. Personne ne se soucie de lui. Les quelques tôles restées accrochées aux montants de la case ont été récupérées par les voisins qui grignotent peu à peu l’espace libre. Toutes les ordures déversées sur les pentes de la ravine sont parties dans l’océan. Elles étaient là dans cette attente.
Avec ses quinze euros quotidiens et ses frais de nettoyage des vêtements, Dunant sait qu’il n’est pas près de s’en sortir.
« Donne-moi un rhum. »
« Tu bois maintenant ? »
« Ça ne te regarde pas. Je suis un client. Un point c’est tout. Et je peux payer. »
Comme il arrive en retard à l’hôtel, Francis lui montre la pendule. Dunant fait un bras d’honneur dans le dos du jeune homme en gagnant la cuisine. Il boit quelques fonds de verres sans tenir compte de leur contenu. Il tombe d’abord un plat puis brise une assiette.
Á la fin de son travail, alors que les vapeurs de l’eau de vaisselle ont chassé celles de l’alcool, Francis dit en tendant les quinze euros : « tu n’as pas besoin de revenir. Tu sais que l’image du personnel a de l’importance dans un établissement. Les clients ne supportent pas plus un ivrogne à la plonge qu’au service. Ils veulent être sûrs que la vaisselle est propre. »
1.17 28
La nuit est noire.
Dunant vient de perdre son emploi et n’a nulle part où s’abriter.
Il erre dans la ville déserte. Pas un bar éclairé. Pas d’autre signe de vie que les aboiements des chiens aboyant leurs peurs et leurs angoisses d’être attachés sans protection à un arbre ou un portail branlant. Prisonniers du mètre de chaîne qui les torture, ils sont censés garder les cases en tôle et les villas. Le moindre bruit, le plus petit mouvement annonce peut-être un ennemi dont ils sont incapables de se défendre. D’autres errent, solitaires ou en bandes, à la recherche d’un os ou d’un quignon perdu. Nés d’une mère abandonnée ou jetés eux-mêmes d’une voiture parce qu’ils étaient devenus encombrants après avoir été si mignons. Ils sont des centaines dans chaque ville. Seules les voitures ont pitié d’eux en abrégeant leurs souffrances lorsqu’ils tentent la traversée d’une voie rapide. Leur corps gonfle alors au soleil, se décomposant pour nourrir les martins. On prend vite l’habitude de ne plus respirer quand on aperçoit une dépouille sur la chaussée.
Dunant se sent comme eux.
Perdu.
Malgré la nuit il a chaud. Il s’allonge sous les filaos. Les aiguilles et le sable sont un matelas supportable.
La pluie le réveille alors que le soleil éclaire les sommets. Le jour est là, aussi soudainement que d’habitude. On n’aime pas la nuit sur cette belle île. Elle est porteuse de tous les risques. Les superstitions d’Afrique, d’Asie et d’Europe se sont mêlées en multipliant les craintes.
Les premiers pêcheurs s’installent sur les roches noires et sur la plage.
Dunant transpire déjà, alors que la pluie n’a pas fini de sécher. Il a faim. Il lui reste trente euros.
Le camion de Smet est fermé. Ses vêtements de rechange et son rasoir sont à l’intérieur.
Il achète un journal et parcourt les annonces. Il lui manque une voiture ou un bac plus… L’ANPE peut-être ?
Après s’être informé, il rejoint la file d’attente déjà longue. En passant devant une vitre, il voit son visage barbu et ses cheveux collés par la pluie. Sa chemise et son pantalon sont tachés de graisse. Q’importe ce que pensent les gens. Il ne les connaît pas. Ses voisins ne s’intéressent pas à lui.
Il n’est qu’un débris.
Une épave.
En avançant il lit les annonces.
Lassé d’attendre, il décide de revenir plus tard, lavé et habillé, pour se faire inscrire. Il aurait dû le faire dès son arrivée au lieu de décider de s’en sortir seul.
Á la boutique du coin d’une rue, il prend une « pile plate ». Ces bouteilles, qui contiennent pour un euro de rhum, sont faites pour la poche. Bues d’un trait elles y vont rarement. La première brûlure s’estompe, remplacée par la chaleur. La conscience se dilue dès la deuxième bouteille.
Dunant connaît l’effet de l’alcool sur lui. Il se dépêche de boire pour fuir la lucidité aiguisée qu’il ne veut pas affronter. Ne plus voir les autres. Cesser de réfléchir. Sombrer. C’est ce qu’il demande.
1.18 1
Une violente averse le surprend sur le banc où il s’était effondré.
La pluie lui fait du bien. Allongé sur le ventre il laisse les grosses gouttes masser son dos. Il revoit les jets multiples et des bouillonnements de la baignoire choisie par sa femme. Il a la même chose ici en beaucoup plus grand. Il se met en marche vers les vagues. Il est bien. L’eau emporte les dernières brumes d’alcool.
Smet est dans son camion. Avec la pluie, les clients ont quitté le bord de mer.
« Où étais-tu passé ? Tu ne travailles plus ? La nouvelle serveuse est venue te chercher. Elle a dit que tu pouvais revenir. »
« Qu’ils aillent se faire foutre ! Je n’ai pas besoin d’eux. Je trouverai autre chose que ce boulot minable. »
« Tu fais comme tu veux. Tu avais de quoi manger. Tu aurais pu économiser… »
« Il m’aurait fallu six mois pour gagner ce que j’avais en un jour à la brasserie. »
« Ce passé est loin. Que vas-tu faire maintenant ? »
« Dormir. Nager. Attaquer une banque. »
« Ne dis pas de connerie. Cherche au moins un boulot. »
« Demain. Il aurait fallu que je me rase et que je m’habille, mais tu n’étais pas là. »
« Est-ce que tu as mangé ? »
« Quelques piles plates. »
« Tu n’as plus d’argent ? »
Dunant glisse sa main dans son slip : « il m’en reste un peu planqué là. Personne n’osera… »
« Tu ne les connais pas. Ils n’hésiteront pas à te mettre à poil. Prends un sandwich. Je t’en donnerai deux ou trois si tu t’occupes des bouteilles et des barquettes qui traînent. Tu sais que je ne suis pas riche. »
« Je ne te demande rien. Pas plus à toi qu’aux autres. En attendant de redémarrer je m’occuperai des alentours. »
« Tu devrais aller à Saint-Gilles ou à Saint-Denis, tu aurais plus de chances qu’ici de trouver un boulot. »
« Demain. Donne-moi une bière. J’ai de quoi payer. »
Après avoir bu la bière, Dunant en commande une autre, puis un rhum et un autre, et…il va s’allonger le long du mur dominant la plage.
Quand Smet ferme son camion, il glisse le sac de vêtements sous la tête du ronfleur. Demain il pourra se présenter à l’ANPE.
Des mains tiennent les bras de Dunant. D’autres enserrent ses jambes. Quelqu’un est assis sur lui fouillant son pantalon.
Les salauds !
Ils trouvent les billets dans le slip est s’enfuient dans la nuit.
En tâtonnant il découvre un sac vide. Ses vêtements et sa trousse à toilette ! Ils lui ont pris ça aussi.
1.19 2
Lorsque le jour se lève, Dunant se lave au robinet de la plage. Le ciel est dégagé. La chaleur est déjà pesante. Il décide de marcher vers Cora, le supermarché en bordure de la ville. Puisque c’est un self, il décide de se servir. Il mange quelques fruits et un gâteau. Les pertes sont incluses dans les prix affichés. Il débouche une bouteille de whisky, du meilleur, qu’il avale goulûment.
Deux mains se posent sur ses épaules. Arraché au sol, il est emporté vers une issue de secours. Un grand rouquin et un Cafre athlétique lui font face.
« Paie ce que tu as pris. Allez ! Sors ton fric ! »
Dunant lève les bras en riant : « trop tard les gars ! On m’a déjà tout volé. »
Un coup violent porté à l’estomac le projette au sol cassé en deux. Un pied le retourne. « Vide tes poches minable ! Non ! Mets-toi à poil ! On verra ce que tu caches. »
Il n’est pas de taille à affronter ces deux costauds. Il défait sa chemise et laisse glisser son pantalon.
« Le slip aussi. C’est lui qui vous sert de planque. »
Il enlève son dernier vêtement qu’il retourne. Un pied frappe son dos alors qu’un poing l’atteint au ventre. Une volée de coups s’abat sur lui qui ne cherche même plus à se protéger.
Projeté hors du bâtiment, il reste prostré contre le mur.
Il parvient enfin à s’asseoir et enfiler son pantalon. Son slip a disparu. Sa chemise est déchirée.
Dunant s’allonge à l’ombre des palettes.
La peur le gagne.
Il est au fond. Plus un sou. Des vêtements hors d’état. Il ne peut plus se présenter nulle part.
Le bruit d’un moteur le met sur ses pieds. Les palettes tombent autour de lui, poussées par un engin. Rien ne l’attache à la vie, sauf cet instinct qui le fait courir malgré ses douleurs. Il est resté des heures allongé au soleil. Sa peau est brûlée.
En recherchant l’ombre, Dunant marche vers le camion de Smet. Il récolte les bouteilles, les papiers gras et les barquettes vides qu’il pose dans une poubelle. Un groupe de jeunes lui jette les barquettes qu’il ramasse en silence. Ils sont ravis de voir ce blanc chercher leurs déchets à quatre pattes.
« Laissez-le ! C’est un paumé » intervient un adulte assis à une table.
Forts de leur nombre, les jeunes rient : « va l’aider mon frère. Ce blanc te le rendra. »
Smet ne dit rien. Ce sont des clients. Ils reviendront peut-être.
Assis sous un vacoa, face à l’océan, Dunant apprécie son sandwich. Il observe le jeu des vagues qui se brisent sur la barrière de corail et viennent poser leurs dernières rides sur la plage.
Lorsqu’il s’adosse à un arbre la douleur l’arrache à sa contemplation. Son dos brûlé ne supporte pas le contact du tronc. Il faudrait qu’il se soigne. Son nez est douloureux, peut-être cassé. Une de ses dents bouche lorsque sa langue l’effleure.
Il ne peut pas revenir à l’hôpital où on le reconnaîtrait peut-être. Il irait en prison.
Il n’a plus qu’à attendre.
Attendre que ses douleurs s’estompent. Son corps lui a toujours obéi. Il a toujours su dominer la souffrance, même après un match de rugby un peu rude ou une bagarre avec un client excité. Il est seul et personne ne le soignera. Il pourrait mourir sans éveiller le moindre intérêt.
Il n’est rien.
Un chien.
Un crabe.
1.20 3
Des centaines de personnes passent devant lui sans qu’une seule ne lui propose de l’aide. Il se souvient que lui-même ne s’intéressait jamais aux mendiants si ce n’est pour les faire chasser.
Ce n’était pas son problème.
Il payait des impôts.
Il doit s’en sortir seul.
Il remonte vers la ville et parcourt la rue des Bons Enfants, emplie de touristes et de promeneurs.
Il lui faut de quoi se vêtir et faire sa toilette. Il voit bien qu’on le surveille avec son allure d’épouvantail. Il s’assied au bord du trottoir et observe les passants.
Un couple de touristes aussi brûlés que lui s’approche. La femme lui tend un billet de vingt euros.
Trop surpris, il ne remercie même pas.
« Soignez vous. Allez dans une pharmacie. »
« Il ne te comprend pas. Ce doit être un Petit Blanc qui ne parle que créole » dit son compagnon.
Dunant éclate de rire. Mendiant ! Et créole ! Ils sont peu observateurs. Son dos brûlé aurait dû leur faire comprendre qu’il n’est pas né ici.
L’idée est bonne. Dès qu’il voit des touriste il tend la main : « pour me soigner s’il vous plaît. »
Et ça marche.
Vingt centimes, parfois cinquante ou même un euro. Il achète un pantalon, une chemise et un rasoir. Pendant que le vendeur s’affaire pour lui faire un paquet, Dunant enfile une paire de chaussures qu’il ne paie pas.
Il revient à la plage pour se raser, se laver et s’habiller.
Á la pharmacienne qui l’accueille, il dit qu’il est tombé dans les rochers. Ils parlent ensemble de la France. Elle refuse son argent : « je vous en prie. C’est mon métier. Vous emporterez j’espère un bon souvenir de mon île. »
Une chemise et un brin de toilette suffisent à changer le regard des gens. Apparence ! Les relations humaines ne sont fondées que sur les apparences. Il a un autre statut.
1.21 4
Á l’ANPE on demande à Dunant des justificatifs des papiers d’identité. Il doit aller à la mairie, d’où on l’envoie au commissariat pour une déclaration de perte. Ne pouvant justifier de domicile ni de travail, il devient vite suspect. Pour gagner du temps, il donne l’adresse de l’hôtel de Francis. Un policier décide de l’y accompagner.
C’est Brigitte qui les accueille. Elle confirme son identité. Elle indique qu’un client violent a maltraité Dunant qui est serveur au restaurant.
Quand le policier est parti, Brigitte dit : « nous vous cherchons depuis hier. Denis va nous quitter. Il a obtenu un emploi à la cantine municipale. Francis est d’accord pour vous reprendre au service. Nous travaillerons ensemble. Vous m’apprendrez le métier. »
« Merci. Je ne sais pas pourquoi vous faîtes tout ça pour moi. »
« Parce que vous êtes un être humain. Parce que la solidarité est une valeur forte. »
« Jusque là, j’ai toujours vu qu’on aidait les puissants, tout comme on ne prête qu’aux riches. On espère toujours récupérer largement sa mise. Peut-être croyez-vous en un dieu qui vous demande… »
« Non ! Je suis athée. Tous les gens ne sont pas aussi égoïstes que vous le dites. La générosité existe, tout comme le geste gratuit. »
« Je me souviendrai de ce jour. Je me suis fait dépouiller, tabasser, humilier…j’ai reçu des dons d’inconnus…et vous… »
« Nous pourrions nous tutoyer puisque nous allons travailler ensemble. »
« Mais, Francis… »
« Il a ses raisons. Je ne suis pas la patronne. Juste une employée comme toi. »
« Alors tu l’as retrouvé » dit Francis en entrant « et dans un drôle d’état. »
« Il est d’accord pour travailler avec nous. »
« Tu lui as dit les conditions ? »
« Ça c’est ton affaire » dit la jeune femme en s’éloignant.
« Bien. Tu seras payé au SMIC. Et déclaré bien sûr. Pour les horaires de travail, c’est sans changement. Brigitte m’a convaincu que j’avais intérêt à être en règle. Je serai à l’abri en cas de contrôle ou d’accident. J’aurais préféré quelqu’un d’ici, Cafre ou Métis, quelqu’un qui parle créole…tant pis. L’image du Métro reste toujours un gage de sérieux. Tu commences tout de suite. Pas la peine de te dire que si tu bois encore… »
« Vous pouvez compter sur moi. Je veux vraiment m’en sortir. »
« Où vas-tu loger ? »
« Je chercherai. Maintenant que j’ai un travail ce sera plus facile. »
« Je peux te laisser la petite pièce derrière la réception. Tu t’occuperas de l’accueil avec Brigitte quand je serai en courses ou en cuisine. La nuit tu contrôleras les entrées comme je le faisais au début. »
« D’accord. Puisque je serai sur place. Et pour ce travail de nuit… »
« Tu es logé, nourri, payé, déclaré, n’en demande pas trop. J’aurais été heureux d’avoir tout ça quand je travaillais chez toi. »
« C’est parfait. Je peux m’installer ?
1.22 5
Brigitte prépare les tables quand Dunant la rejoint: « je vous dois beaucoup. Grâce à vous j’ai un travail et un logement. Je ne comprends toujours pas… »
Elle rit : « il n’y a rien à comprendre. Mes amis m’ont toujours soutenue et je les aidais. Si le monde a pu évoluer c’est grâce à ces soutiens réciproques. Les gens se sont toujours réunis pour se protéger et travailler. »
« Parce que c’était leur intérêt. J’ai connu ces journées de corvées quand j’étais enfant. On s’échangeait des heures de travail pour les battages ou le déneigement parce qu’on ne pouvait pas s’en sortir seul. Les moissonneuses-batteuses et les chasse-neige ont rendu les gens à leur individualisme. La solidarité n’existe pas sans contrepartie. »
« Alors dis-moi quel intérêt j’aurais à t’aider ? »
« Je ne sais pas. Je trouverai. Pour l’instant j’en profite. Je suis un bon professionnel. Nous avons les mêmes intérêts. Ça je le comprends. »
« Tu es incorrigible. »
Les premiers clients arrivent. L’équipe se met au travail. Dunant observe Brigitte. Elle va nettement moins vite que lui. Elle écoute et parle. Il sait qu’elle a raison. Les gens viennent pour boire et manger, mais aussi pour se confier et être reconnus. Ils reviennent autant pour l’accueil que pour la qualité de cuisine.
Il pense à sa femme qui paraissait toujours s’ennuyer derrière sa caisse. Francis ne sait sans doute pas combien il a de la chance. Un jour elle partira avec un aventurier ou un notable. Peut-être même avec une épave qui donnera un sens à sa vie.
Á la fin du service et lorsque tout est en ordre, Dunant gagne son abri.
Un petit lit occupe la moitié de la pièce séparée de la réception par un rideau. Une penderie complète l’équipement. Aucune aération ne chasse l’air chaud.
Il monte se doucher au premier étage et sombre dans le sommeil
Deux fois, la sonnette l’arrache à son lit dans lequel il replonge aussitôt.
Tôt le matin, Dunant facture les départs et accueille les arrivants. Il enchaîne par la mise en place de la salle à manger.
Brigitte lui dit : « tu peux aller prendre l’air ou dormir un peu. Je veillerai sur l’accueil et le bar. »
« Je serai là dans une heure. »
Dunant boit un café que Smet lui offre.
« Alors tu as repris le boulot. »
« Tu ferais un bon flic. Tu es déjà informé. »
« C’est que tu es remarquable avec ta gueule cassée. Quand on m’a dit qu’un Z’oreil couvert de bleus travaillait chez Francis, j’ai su que c’était toi. Je savais que tu t’en sortirais. Nous pourrons reprendre nos projets quand tu auras fait des économies. »
Dunant rit. Il pourra raconter à Brigitte ce qu’est l’entre aide. Sans le sou il n’était bon qu’à ramasser les déchets. S’il s’en sort il sera un associé.
« Tu n’es plus d’accord ? » s’étonne Smet.
« Bien sûr que si. Mais il peut encore y avoir un cyclone. Le volcan peut se réveiller. Un raz de marée emportera peut-être ton camion. Je ferai des projets quand j’en aurai les moyens. J’attendrai au moins que mes plaies soient cicatrisées.
« La poisse ne s’accrochera pas indéfiniment à toi. Tu en es sorti. Je serai prêt à travailler avec toi dès que tu auras les moyens de payer ta part. »
« Merci de ta confiance. »
1.23 6
Dunant regarde l’océan. Il ne connaît rien de l’île. Tout est allé trop vite. Quoi qu’il en soit, il ne sera jamais un touriste. Les paysages l’intéressent peu. Les monuments encore moins. Il ne sait que travailler pour gagner de l’argent et se sentir fort.
Il demande à Smet : « tes parents étaient riches ? »
« Non. Je n’ai pas connu mon père. Nous étions trois enfants et ma mère travaillait rarement. C’était la misère. C’est maintenant que j’ai le plus d’argent. Tu vois que ce n’est pas formidable. Et toi ? »
« Je suis né pauvre. Mes parents avaient une toute petite ferme. J’ai bossé. J’ai réussi à faire partie des gens riches de ma ville. J’ai tout perdu mais je recommencerai. Je n’ai que quarante-trois ans. Je me sens costaud malgré la faillite, les coups et mon dos brûlé par le soleil. J’aurai ma revanche. »
« Tu veux te venger ? »
« C’est ce qui m’a tenu au début. Je les voyais me taper à nouveau sur l’épaule, m’appeler par mon prénom…tous ces notables…ces minables…Non. C’est fini. Je ne sais pas pourquoi je veux redevenir riche…je n’y ai jamais vraiment pensé. Lâche-moi un peu. La psychologue de Francis passe son temps à me questionner. Alors si tu t’y mets aussi… »
« Elle est bonne celle-là. Qui a commencé ? C’est toi qui voulait savoir si j’étais né riche. »
« Excuse-moi. Ces mois de galère n’ont pas arrangé mon caractère. J’ai dérouillé mais je suis là. Rien ne me descendra. »
Alors que son regard se perd sur l’océan, Dunant sent ses paupières devenir de plus en plus molles. Il se met debout. Il doit regagner son poste. Son dos douloureux l’a réveillé plusieurs fois au cours de cette nuit trop courte. Il se sent très fatigué.
En arrivant au bar il se sert un café suivi d’un grand rhum.
Brigitte le surprend quand il pose la bouteille : « tu ne devrais pas. Ça te fait du mal et si Francis te voyait… »
« Au travail ! » dit Francis en entrant « ce soir il y a du monde. Toutes les tables sont retenues et l’hôtel est complet. Un groupe de retraités. Je serai bloqué à la cuisine. Vous devrez vous débrouiller. »
« Tu aurais pu prendre un serveur de plus » remarque Brigitte.
« C’est ça ! Pour perdre le bénéfice. »
« Oh ! Trente euros ! Pour une recette de plus de mille cinq cents… »
« La recette n’est pas le bénéfice. Il y a les fournitures, les impôts, les amortissements, l’électricité…tu verras quand tu te mettras aux comptes. »
La jeune femme dépose un baiser sur la joue de son compagnon : cesse de toujours compter. Détends-toi. Vis. »
« Au boulot ! Pour la détente on verra plus tard. »
« Il a raison » dit Dunant « il ne faut pas mélanger les choses. Au travail il ne faut penser qu’à ce qu’on fait. Après on peut décider de sa vie. »
1.24 7
Brigitte rit : « Après ? C’est quand après ? Á quatre-vingt-dix ans ? Il travaille dix-huit heures par jour sans un jour de fermeture dans l’année. Il dort les six heures qui restent. Il n’a rien vu de la Réunion. Il veut gagner encore plus pour agrandir l’hôtel. Il aura alors plus de charges et encore moins de temps libre. C’est ça la vie ? »
« La sienne oui. Comme la mienne. Nous ne savons pas rester sur une plage à bronzer les yeux fermés. »
« On peut nager, marcher, lire, rencontrer des gens, voyager… »
« Une heure reste une heure. Une année a trois cent soixante cinq jours pour tout le monde. L’essentiel est d’aimer ce qu’on fait. »
« Dès que les clients vont arriver, plus rien n’existera que le service : se souvenir de la commande, vérifier s’il reste du pain, ne pas entendre la remarque blessante, courir, rendre la monnaie, desservir…et recommencer. »
« C’est la vie que j’aime. Surtout quand l’argent entre dans la caisse. Peut-être parce que ça ne me laisse pas le temps de penser. C’est mon territoire. L’argent me rassure pour l’avenir parce que j’ai été pauvre. Voilà Docteur. Ma réponse te satisfait ? »
« Non. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Toutes les heures ne se ressemblent pas. Il y a le temps qu’on nous vole et qui appartient à ceux qui décident pour nous : à l’école, à l’usine, dans le salon d’attente…Et celui dont nous disposons nous-mêmes : le temps libre. »
« Celui-là je le connais. Je viens de vivre libre pendant des mois. Tellement libre qu’il me fallait l’alcool pour oublier. Avant, le temps libre m’amenait les clients cherchant une oreille et d’autres personnes qui s’ennuyaient autant qu’eux. Ils oubliaient leur liberté en buvant. Pour d’autres c’est la drogue ou la déprime. »
« C’est aussi la méditation, la conversation, les loisirs, les amis…il est vrai qu’il faut apprendre à le vivre. Dès la naissance on impose au petit d’homme ce qu’il doit faire : ranger ses affaires, de dépêcher pour aller à l’école ou au lit, abandonner ce qui pourrait l’intéresser.
Peu à peu, ce dressage nous rend infirmes. Nous ne savons plus rien faire par nous-mêmes. Les vacances sont collectives, tout comme les autres moments de loisir. La retraite est un gouffre vide qu’on tente d’occuper par de nouvelles obligations à horaires fixes. On devrait apprendre l’autonomie aux enfants pour qu’ils sachent décider par eux-mêmes et choisir ce qu’ils veulent être. »
« Ta société serait drôle. On en serait encore à l’âge des cavernes. »
« Il ne s’agit pas de tout arrêter. Juste refuser la course au fric et au pouvoir. Ne pas se laisser imposer des choix par la société de consommation et les modes. »
« Pour l’instant nous devons bosser. Voilà les premiers clients. »
1.25 8
Dunant répond aux questions concernant son visage marqué. Il évoque le cyclone. Les touristes sont ravis. Certains le prennent en photo pour emporter des preuves de la violence du cataclysme.
Á chaque nouvelle interrogation il en rajoute un peu : sa case a été emportée par le torrent…les arbres s’abattaient autour de lui…les requins étaient en embuscade à l’embouchure de la ravine…la planche providentielle à laquelle il s’est agrippé… il a tout perdu…
Les pourboires sont importants. Alors que la règle veut qu’ils soient partagés entre ceux qui travaillent en salle, en cuisine et à la plonge, Dunant en détourne une partie. Il n’a jamais rien reçu quand il faisait la vaisselle. Il sait que Brigitte le voit mais qu’elle ne parlera pas.
Il regagne son coin dès que la salle est remise en ordre.
Personne n’entre cette nuit. Les vieux touristes dorment paisiblement. Il est plus de neuf heures et les petits déjeuners ne sont toujours pas demandés.
Dunant se sent bien. Les traces commencent à s’estomper. Son dos pèle et ne lui fait plus mal. Assis devant la porte il respire l’air venant du large.
Brigitte s’assied près de lui et murmure : « c’est ça le temps libre. »
« Je l’apprécie parce qu’il est exceptionnel et court. Parce que je sais que je vais travailler à nouveau. »
« Tu verras. Tu apprendras le bonheur. Un jour tu sauras apprécier chacun des instants de ta vie. »
« O.K. Professeur. En attendant je vais m’occuper des petits déjeuners. Je te laisse goûter les joies de cette matinée enchanteresse. »
La fatigue du voyage, la chaleur, la bonne chère et les alcools rendent le réveil des retraités difficile. Les considérations sur les lourdeurs digestives et les vieilles douleurs l’emportent sur les plaisirs de l’exotisme. Le miracle n’a pas eu lieu : ils se retrouvent comme chaque matin. Après la douche et le maquillage, la volonté reprendra le dessus. Les gais voyageurs monteront dans le car de l’aventure. Pour l’instant, en short ou en peignoir, c’est un groupe de vieux qui a triomphé de la nuit. Une fois encore. Les grognons trouvent le café froid ou le thé trop chaud ; le pain brûlé ou pas assez grillé ; les fruits trop durs ou trop mûrs…Quelques bons vivants plaisantent ou s’extasient sur la température et la vue sur l’océan.
Une grande et grosse octogénaire, bagues et bracelets au vent, retient Dunant : « J’ai deux hôtels restaurants. L’un de mes gérants ne me convient pas. Je vous ai observé hier. Comment se fait-il que vous soyez là ? »
Il raconte sa brasserie prospère, le départ de sa femme, le fisc, le comptable incompétent…il parle de ses projets.
« Laissez-moi votre nom et votre adresse ainsi que l’endroit où vous aviez votre brasserie. Je vous écrirai bientôt. Si ce que vous avez dit est vrai je vous confierai mon hôtel. »
1.26 9
Dunant se sent porté par des ailes inconnues. Il ne veut pas y croire. Et si…
« On courtise les grands-mères ? » rit Brigitte.
« C’est peut-être une fée. Elle possède deux hôtels et cherche un gérant. Tu te rends compte ! »
« Tu vois que la chance existe. »
« Il vaut mieux attendre avant de boire le champagne. Je n’ai de toutes façons pas de quoi le payer, pas plus que le billet de retour. Il m’a été volé avec le reste. Heureusement je travaille. Comme j’aime ça je ne me plains pas. »
Au moment de la coupure, Dunant dit à Smet les promesses de la vieille femme.
« Et tu abandonnerais nos projets ? Là-bas tu ne seras que gérant. Ici tu serais patron. »
« Á moitié puisque nous serons associés. »
« Tu seras vite à ton compte. Le tourisme se développe et la population augmente. Nous pourrons sans doute acheter un restaurant… »
« Je vais reprendre mon boulot. De toutes façons je n’ai pas de quoi payer le billet. »
« Je suis sûr que tu reviendras. On est mieux ici. »
Dunant a la tête ailleurs. Il se trompe de plat…oublie les notes…Brigitte le supplée. Pendant qu’ils rangent elle lui dit : « heureusement que j’étais là. »
« Excuse-moi. Merci encore. Tu es la personne qui aura fait le plus pour moi. Je te devrai sans doute ma nouvelle vie. »
« N’exagère pas. Je suis juste là au bon moment. »
« Sans toi je serai encore dans la rue. Ou en prison. La vieille veut peut être simplement se donner de l’importance. Au mieux elle va se renseigner et tenter d’obtenir que je travaille pour presque rien. Elle n’envisage pas de m’aider mais de régler son propre problème au mieux de ses intérêts. Toi c’est différent. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m’aides. »
« Parce que j’ai besoin d’être utile pour me sentir exister. Disons que c’est une infirmité. C’est quand je donne que je me sens bien. Tu m’apprends ton métier et beaucoup de choses sur la vie. N’oublie pas que je voulais être psychologue… »
« Donc c’est moi qui te rends service. »
« Peut-être plus que tu ne crois. Sans toi je serais sans doute repartie. »
« Et Francis ? »
« L’homme qu’il devient ressemble de moins en moins à celui que je connaissais. Il était désireux de réussir, mais il ne pense plus qu’à gagner de l’argent. Travailler toujours plus pour agrandir son entreprise et devoir travailler plus encore et encore. Ce n’est pas la conception que j’ai de la vie. Je veux partager le temps. Pour moi, l’unité de mesure de l’amour est le temps partagé. On entend trop souvent des parents dire à leurs enfants qu’ils laissent à une nounou ou une crèche : c’est pour toi que je le fais. Tu trouveras plus tard…De la même manière un homme dit à sa femme que s’il n’est pas auprès d’elle c’est pour gagner de quoi lui offrir des bijoux ou des robes…Les cadeaux ne sont pas des preuves d’amour. Juste des compensations et des dédommagements. »
1.27 10
« Alors les bavards ! Vous travaillez de temps en temps ? » intervient Francis sortant de sa cuisine.
« Après la journée d’hier » dit Brigitte « nous pouvons peut-être prendre quelques minutes. »
« Du moment que tout sera prêt pour le repas vous pouvez faire ce que vous voulez. J’espère qu’il y aura beaucoup de journées comme celle d’hier, sinon nous serions moins nombreux à travailler ici. »
« Si ce n’est pas une menace, ça y ressemble » dit Dunant « on dirait que vos relations changent. Pour ce qui est du travail, il exagère. Il faut bien deux personnes pour la salle, même en dehors des coups de bourre. »
Dunant se rend à la Poste. Il trouve bien les deux hôtels de la vieille. L’un est un simple hôtel de tourisme de seize chambres, l’autre est un deux étoiles de vingt-huit chambres. Elle lui a parlé du second, mais le premier lui suffirait si elle confirmait son projet. Il pense un moment appeler le président de la chambre de commerce ou le président du syndicat des hôteliers de son département. C’étaient deux amis…avant… Ils informeraient peut-être la propriétaire… Il a le temps. Il vérifiera la comptabilité avant de signer.
Ce temps d’errance lui a appris la patience. La modestie et une autre forme de courage font aussi partie de ses nouveaux atouts. Sa vision du monde a changé. Il comprend Francis qui lui ressemble beaucoup, mais ses conversations avec Brigitte le font réfléchir.
Attendre.
Les journées passent sans à coup. Parler avec Brigitte aide le quadragénaire à mieux se connaître.
« Je suis ta psychanalyste » s’amuse-t-elle « et tu me rends le même service. En fait, il suffit de rencontrer quelqu’un qui nous écoute. »
« Je suis donc devenu psychiatre. »
« Psychanalyste, ça suffira. Grâce à toi j’ai évolué. Je vais bientôt partir. Je veux vivre. »
« Á l’époque où l’on travaillait du matin très tôt jusqu’à la nuit, on n’avait pas besoin de ces guérisseurs de l’âme. »
« C’est vrai. Quand on meurt de faim et de froid, on va d’abord vers cette urgence. Les sociétés anciennes étaient plus accueillantes pur les vieux et ceux qu’on appelait les fous. On les gardait souvent dans les familles, même si rien n’était simple. Maintenant chacun s’enferme et s’isole, laissant à la collectivité le soin de veiller sur les faibles. »
Dunant est à l’accueil lorsque madame Morlou appelle : « pourrais-je parler à monsieur Dunant ? »
« C’est moi. Bonjour madame. »
« Madame Morlou. Vous vous souvenez de moi ? Je me suis renseignée. On m’a confirmé vos dires. Quand pouvez-vous venir ? »
« Pas avant un mois. Mon préavis… »
« Ce sera trop tard. J’ai besoin de vous dans huit jours. Après je devrai choisir quelqu’un d’autre. Les candidats ne manquent pas. »
« Je m’en doute. Puis-je vous rappeler ? »
« Ce n’est pas la peine. Dans huit jours je prendrai ma décision. Avec ou sans vous. Au revoir. »
Il n’a pas le temps de répondre. Elle a déjà raccroché.
1.28 11
Il sent la peur monter en lui. Un an plus tôt il se serait mis en colère.
Il lui faut l’argent du billet.
« Une mauvaise nouvelle ? » demande Brigitte.
« C’est plutôt une bonne. J’ai l’accord de la vieille pour l’hôtel restaurant. Elle me donne huit jours. Mais je n’ai pas de quoi payer le billet. »
« Je peux te le prêter. »
« Tu ferais ça ? »
« Mais bien sûr. Combien te faut-il ? Mille euros ? Un peu plus avec les frais ? »
« Mille euros ! Ce serait parfait. Je vais essayer d‘avoir un billet revendu. Je te signerai une reconnaissance de dette. »
« Non. Je sais que tu me le rendras. Tu n’es pas un voleur. Je ne me vois pas te poursuivant devant un tribunal. Dans quelques temps ce sera une petite somme pour toi. »
« Merci. Encore merci. Je te le rendrai bien sûr. J’espère pouvoir t’aider à mon tour. Quoi qu’il arrive, de n’importe où, tu pourras compter sur moi. C’est la première fois que je le dis mais tu peux me croire. »
« Je te crois. »
Lorsque Dunant annonce son départ à Francis, il s’entend répondre : « il n’en est pas question. Tu peux revoir ton contrat. Tu me dois un mois de préavis. C’est la contrepartie de la sécurité. Je n’ai personne pour te remplacer. »
« Tu trouveras facilement. »
« Je t’ai dit de ne pas me tutoyer. »
« Tout ça c’est fini. Je te tutoie si je veux. Je pars. Un point c’est tout. Je vais faire cette journée et peut-être demain si je n’ai pas de place dans l’avion pour que Brigitte ne soit pas seule. »
« Je te poursuivrai devant le tribunal de Prud’hommes ! »
« Oui. Je leur parlerai de la plonge et du travail au noir, comme de tes aides cuisiniers non déclarés. Tu sais bien que tu ne peux rien me faire. »
« Ça m’apprendra à écouter Brigitte. Quand je pense à ce que je te donne… »
« Justement ! Tu me dois dix jours. »
« Elle est bonne celle-là ! Tu peux courir. Tu vois l’avantage d’être payé à la journée ? Tant pis pour toi. Tu peux partir. Tu n’auras rien. »
« Tu ne veux pas que je finisse la journée ? »
« Tu ferais ça ? »
« Je te l’ai dit. Je ne veux pas laisser Brigitte seule avec tout le boulot. »
« Je n’y comprends rien. »
Dunant parcourt les annonces, à la recherche d’un billet revendu. Il appelle plusieurs personnes, mais c’est toujours trop tard ou les billets sont pour la semaine suivante. Enfin : « Oui. Pour après-demain. J’en demandais cinq cents euros. Mais comme on se rapproche de la date je l’ai baissé à quatre cents. Vous pourrez partir après demain ? »
« C’est parfait. Où pouvons-nous… ? »
« Donnez-moi votre adresse et je vous l’apporte. »
Avec l’argent de Brigitte, Dunant complète sa garde-robe pour ne pas choquer sa future patronne.
La soirée se passe dans le calme. Comme s’il craignait quelque débordement, Francis vient souvent surveiller le travail. Il ne peut comprendre le zèle de son employé qui ne sera pas payé.
Au matin, alors que Dunant se prépare à quitter l’hôte, Francis lui tend cent euros. « Tu me laisses tomber, mais tu as bien travaillé. »
Les deux hommes se quittent sans un mot de plus.
« C’est toi… » dit Dunant à Brigitte.
« Je voulais qu’il te paie toutes tes journées mais il a refusé, comme il refusait que je te conduise à l’aéroport. J’ai répondu que j’étais libre. J’ai dû le menacer de partir moi aussi. Je ne le reconnais plus. Je vais bientôt rentrer. Je reprendrai peut-être mes études. Nous nous reverrons. »
Le trajet se fait au plus vite. Brigitte doit rentrer pour le service. Elle laisse Dunant devant un hôtel de Saint-Denis. Il se sent plus ému qu’il ne l’a été depuis bien des années. Brigitte essuie une larme en disant : « merci. Tu m’as beaucoup appris. »
« C’est le bouquet ! Tu m’as sans doute sauvé la vie en me rendant un travail …tu me donnes de quoi redémarrer…et c’est toi qui me remercie. »
« Écris-moi. J’ai l’adresse de ton hôtel. Je viendrai bientôt te voir. Francis et moi c’est fini. Je vais le lui dire en rentrant. »
La voiture démarre brutalement pour disparaître au croisement des rues.
1.29 12
Dunant se dit qu’il n’a pas fait fortune mais que grâce à Brigitte il repart mieux qu’il est venu. Il va vers un projet.
Il marche dans les rues de la capitale réunionnaise sans voir les gens ni les maisons. Il imagine l’hôtel et les négociations avec madame Morlou. Brigitte revient aussi dans ses pensées. Quelle fille formidable !
Il dort peu et arrive très en avance à l’aéroport. Il se sent plus détendu que la plupart des touristes qui courent en tous sens, ne prenant même pas le temps d’admirer les pentes abruptes qui enferment Mafate, ou l’océan bordant la piste. Il ne connaît de cette île que ce qu’il a lu sur les brochures touristiques ou les rares endroits où il a travaillé et souffert.
Le voilà revenu à la vie.
Il sort du trou dans lequel il avait été plongé. Il se sent plus fort. Il sait qu’il n’aura plus jamais le même comportement avec son personnel. Il se promet de tempérer ses ambitions et de garder du temps pour vivre.
L’île disparaît lorsque l’avion fait son demi tour et s’élève au-dessus des nuages.
Ile de rêve pour touristes avides d’exotisme sans danger dans ce coin de France perdu dans l’océan Indien.
Ile de souffrance pour des milliers d’esclaves africains et malgaches comme d’engagés chinois et indiens.
Ile de tous les excès avec d’immenses fortunes et une grande misère.
Dunant somnole dans son fauteuil trop étroit. Des images du cyclone lui reviennent avec les violences subies. Le visage souriant de Denis se mêle à celui d’Ary hagard ou de Smet qui lui demande de revenir. Et Francis. Froid et inhumain comme il l’était lui-même. Et Brigitte aussi. Paisible et réconfortante. Bien loin de l’image des top models affichée sur les murs et en première page des magazines. Rassurante. L’amie que chacun voudrait avoir.
Ah ! S’il était plus jeune !
Elle n’a pas trente ans et lui n’est qu’un miséreux de plus de quarante.
Un jour peut-être…
Il sourit en se demandant si l’actif qu’il était devient un rêveur. Il voit Brigitte venir vers lui, fatiguée et sans ressources… elle lui tend les bras, elle…
« Que désirez-vous monsieur ? »
C’est l’hôtesse, la serveuse volante qui expliquait tout à l’heure, pour la millième fois peut-être, l’utilisation des gilets de sauvetage. Elle apporte le repas et les boissons avant d’enlever les restes et la vaisselle sale. Bien loin de l’image qu’il se faisait de ces déesses escortant princes et maharadjas. Des femmes de service pour citoyens ordinaires depuis que le transport aérien s’est démocratisé.
Dunant sourit en observant la belle dame soigneusement maquillée, impeccablement moulée dans son tailleur rouge, affairée à servir le clochard qu’il était quelques jours plus tôt.
Il referme les yeux pour mettre un terme à l’enquête menée par sa voisine. Elle lui a déjà infligé le récit de toutes ses excursions, l’étude comparative de toutes les plages, temples et musées. Elle a tout vu de l’île et tout compris de ses habitants en une semaine de voyage organisé.
1.30 14
Il fait nuit lorsque l’avion amorce sa descente.
Paris.
C’est là que sa vie recommence.
Dunant n’ose pas aller tout de suite à l’hôtel de madame Morlou. Demain. Il ira demain.
Il achète un sandwich et marche dans les rues.
Les sans domicile sont partout. Des jeunes souvent. Mais aussi des vieux, des femmes et des enfants.
Il ne voit qu’eux. Eux qui n’existaient pas pour lui lors de ses rares séjours parisiens.
Les gens défilent devant ces invisibles assis ou même couchés dans les rues froides. Ces gens ordinaires, les bras chargés de paquets provenant de magasins débordant de nourriture et de vêtements, d’appareils modernes et de jouets futuristes. Ils ne voient plus ces marginaux au cœur de la cité, rejetés comme les épaves que la vague dépose. Inadaptés. Brisés par la vie et les humains.
Il a été comme eux.
Il pourrait être là. Accroupi sur le trottoir. L’œil vague et la main tendue, espérant un regard ou un mot.
Il s’assied près d’un homme à peu près de son âge et lui tend un billet de vingt euros.
L’homme le regarde avec méfiance, n’osant prendre le billet : « pourquoi ? »
« J’étais comme toi il y a peu de temps. Nous avons sans doute le même âge… »
« Moi j’ai vingt-huit ans. Je cherche du travail. »
« Je te croyais plus vieux. Tu as un métier ? »
« J’ai fait trente six boulots : coursier ou balayeur, gardien et cueilleur de pommes, porteur et magasinier…mais là je n’ai plus rien. Il fait froid. »
« Je reviendrai te voir. Je vais diriger un hôtel restaurant. J’aurai peut-être besoin de toi. »
L’homme ne l’écoute plus. Ses yeux sont fixes. La fatigue ou l’alcool. Ou bien la maladie ou quelque drogue.
Dunant choisit un hôtel discret. Les douches sur le palier suffisent à son standing. Il s’endort d’un coup et se réveille avant le jour. Il s’habille avec soin avant de prendre un petit déjeuner copieux. Son pantalon est parfaitement repassé après la nuit entre sommier et matelas.
Á l’Hôtel de Lyon, il demande madame Morlou.
La jeune fille qui l’accueille répond : « je ne connais pas cette dame. »
« C’est la propriétaire. Elle m’attend. »
« J’appelle monsieur Raymond. »
Un homme de son âge avance vers lui : « Raymond Morlou. Vous voulez voir ma tante ? »
« Oui. Je l’ai rencontrée lors de son voyage à la Réunion. Elle m’a dit qu’elle cherchait quelqu’un pour gérer son hôtel. »
L’homme rit : « cela ne m’étonne pas. Il faut toujours qu’elle parle de ses hôtels. Elle en avait deux. Ou plutôt son mari possédait deux hôtels. Il est mort l’an dernier. C’était mon oncle. Jusqu’au dernier moment il les a dirigés seul. Mon frère et moi en avons repris un chacun avec la contrepartie de veiller sur notre tante. Elle invente souvent des histoires. Il ne faut pas lui en vouloir, elle a quatre-vingts ans. »
Dunant tombe dans un fauteuil. « Elle ne cherchait personne ? C’était un bobard de vieille gâteuse ? »
« Je ne vous permets pas ! »
« J’ai laissé mon emploi. J’ai pris l’avion. Je n’ai plus un sou… »
« Croyez que je regrette. Si vous voulez déjeuner je vous invite. »
« Déjeuner ! Et après ? Où trouver du travail ? Vous avez besoin de quelqu’un ? J’avais une brasserie. Je peux servir. Je sais cuisiner. Je peux tout faire. »
« Les temps sont durs pour tout le monde. J’ai plutôt trop de personnel. »
« Un de vos collègues peut-être… »
« Personne à ma connaissance n’a besoin d’un employé. Vous pouvez retourner à la Réunion reprendre votre travail. On doit y être mieux… »
« Je n’ai pas de quoi payer l’avion. »
« Croyez que je regrette. Je gronderai ma tante qui ne m’écoutera pas. Allez à la mairie ou à l’agence pour l’emploi. »
Il accompagne Dunant jusqu’à la porte : « je suis sûr qu’avec votre expérience vous allez trouver…bonne chance ! »
Dans le premier bar Dunant commande un cognac. Puis un autre. Il est assommé.
Une folle !
Et il l’a crue !
Cette fois c’est la fin. Il lui reste cent trente euros. En faisant très attention il tiendra une semaine.
Et après ?
Refaire le tour de ses « amis » parisiens ? Demander dans les bars et les restaurants ?
Il continue à boire jusqu’à perdre conscience.
1.31 15
Le froid le réveille. Une petite pluie fine dégouline dans son cou. L’imperméable entr’ouvert a laissé passer l’eau sur ses jambes. Il grelotte. Les camions poubelles emportent les ordures. Il se recroqueville dans l’encadrement d’une porte.
Lorsqu’il décide de pousser la porte d’un hôtel, le veilleur de nuit lui demande de payer d’avance. Il est cinq heures. Il devra libérer la chambre pour midi.
Non ! C’est trop bête !
Les premiers clients arrivent dans le bistrot où il vient de s’installer pour savourer un chocolat près du radiateur.
Quatre-vingt dix euros ! C’est tout ce qui lui reste. Il a bu quarante euros. Il pleure dans ses bars repliés. Il est seul. Mouillé. Á Paris.
Il achète du pain qu’il mange en marchant.
La pluie a cessé.
Á treize heures, Dunant choisit un hôtel modeste : vingt euros la chambre.
« Comme vous n’avez pas de bagage je dois vous demander de payer d’avance. »
Il prend la clé que l’homme pose sur le comptoir et trouve la petite chambre indiquée. Le radiateur est à peine tiède. Il suspend ses vêtements humides et s’allonge sous la couverture. Il met longtemps à se réchauffer. Les bruits de la rue disent que la vie continue. Il n’arrive pas à fixer ses pensées. Dans son rêve, une vieille femme dit : « je n’ai besoin de personne ». Smet lui offre son camion.
La pendule de la réception affiche dix-sept heures lorsque Dunant accroche sa clé. Il n’a plus froid. Ses vêtements sont presque secs.
Il a faim. Il commande une omelette et une bouteille de vin dans une brasserie. Il ne veut plus penser que l’argent file de ses doigts. Il est bien. Il fait bon. Le patron essuie son comptoir d’un geste machinal. Une grosse femme trop peinte trône derrière sa caisse.
Moins d’un an !
C’est tellement lointain. Comme une autre vie.
« Vous voulez autre chose monsieur ? »
« Non merci. »
Quand l’homme revient avec la note, Dunant dit : « j’avais une brasserie il y a quelques mois. Un divorce… le fisc…J’ai tout perdu. Connaîtriez-vous quelque chose ? »
« Vous voulez acheter ? »
« Oh ! Non ! Il n’en est as question. Juste travailler. Je peux tout faire. De la cuisine au bar en passant par la salle ou même la plonge. »
« Vous en êtes là ? Ça fait combien de temps » dit l’autre en s’asseyant.
Dunant raconte ses années de travail, son divorce, les procès. Il passe rapidement sur l’alcool et la rue.
1.32 16
« Apporte-nous un calva » dit le patron d’un ton sec.
La caissière dépose devant eux la bouteille et deux verres.
« Tu te rends compte ! Il était comme nous. Le fisc lui a tout pris parce que son comptable n’avait pas fait son boulot. Nous devons nous méfier. Avec tous ces va nu pieds, ces fainéants et ces minables qu’il faut nourrir, on n’arrête pas de payer des impôts. Ils nous feront jeter hors de chez nous.
« Tu ferais mieux de vendre » dit la femme « je te le dis depuis longtemps. On se retirerait chez nous. »
« Facile à dire. Encore faudrait-il trouver un acheteur. Là encore, au moment de la vente, ils vont nous prendre une part importante de ce qui nous appartient. »
« Ça vaut mieux que de tout perdre ! » murmure Dunant.
« Bon ! C’est pas tout ça ! Les clients vont arriver. Encore un verre ? » propose le patron en quittant la table pour rejoindre son abri. Derrière le comptoir il est à l’abri de ce malheureux qui porte peut-être la poisse.
Dunant sort, sans même finir son alcool. Il marche en évitant le regard de ceux qui lui tendent la main ou restent assis derrière une casquette ou une affichette rappelant leur sort. Arrivé à l’hôtel, il s’enfonce sous la couverture et remonte ses jambes, l’esprit vide.
Il a chaud.
Il voudrait que le temps s’arrête.
Il ne veut plus se battre. Aucune lutte ne l’intéresse plus.
Avoir chaud et manger. Voilà ses seules ambitions.
1.33 17
La nuit est agitée. Les portes qui se ferment et l’eau qui coule à toute heure l’amènent à penser qu’il est dans un hôtel de passe.
La prostitution : c’est un univers qui lui est resté inconnu. Lors de son service militaire, certains de ses copains rejoignaient régulièrement celles qu’ils appelaient « les putes ». Il ne les avait jamais suivis. Par manque de moyens peut être, mais surtout parce qu’il ne comprenait pas ce type de relation. Ce n’est pas un travail. Ce « plus vieux métier du monde », comme disent certains, n’est pas un métier. Il ne s’agit pas de vendre ses bras pour quelques heures, c’est tout son corps qu’il faut livrer à des inconnus. Dunant a regardé des films porno où des femmes acceptent des relations sexuelles avec un partenaire. Il s’est toujours senti gêné. Mais ces femmes-là sont volontaires et connaissent leurs partenaires. Elles sont protégées des violences par la présence des techniciens. Il n’a d’ailleurs jamais vu une grande différence entre elles et les vedettes du « grand »cinéma qui se roulent nues sous les caméras pour des films « d’art ». Très souvent ses clients l’ont amené à défendre son point de vue sur ce sujet revenant souvent dans les conversations de comptoir. Au fil des années, sur ce sujet comme sur bien d’autres, il a appris à se connaître en écoutant ses clients. Son enfance solitaire et son adolescence rurale lui laissent définitivement une réserve par rapport aux femmes en général et aux relations sexuelles en particulier, même s’il lui est arrivé d’amener ses employées qui le voulaient à partager un moment de son intimité. Des rêves et de courts moments d’éveil l’emportent malgré lui avec ses voisines.
« Il est dix heures ! Je dois faire la chambre. Est-ce que vous restez une journée de plus ? »
Les coups frappés à la porte le font bondir hors du lit, en sueur et tremblant.
« J’arrive. J’en ai pour cinq minutes. »
Il se rase hâtivement au lavabo de la chambre avant de compter son argent : il lui reste soixante euros. Il doit partir pour faire durer ce qui lui reste. Il trouvera un hébergement moins coûteux.
Il ne pleut plus. La météo a toujours eu de l’importance pour ce fils de paysan. Il lui fallut ensuite décider ou non d’installer la terrasse, préparer des repas chauds ou des salades, chauffer la salle ou lacer les ventilateurs…Elle devient l’un des éléments majeurs de sa survie d’animal à la recherche d’un abri.
Il achète une baguette, regrettant aussitôt de n’avoir pas choisi un pain. La baguette est pour les riches. Il faut qu’il dépense moins. Soixante euros ! Combien de temps tiendront-ils ? Á peine deux ou trois jours, sauf s’il trouve un abri.
Où aller ?
1.34 18
Dunant cherche l’homme avec qui il a évoqué ses projets. Il lui avait même parlé de l’embaucher ! Il n’est plus là. Il n’a sans doute pas de base fixe, errant au gré du temps…tous les lieux se valent quand on n’attend rien.
Une gare !
Dans une gare il sera à l’abri.
Les voyageurs passent vite, évitant les corps allongés.
Dunant observe un homme de son âge, entouré de deux garçons et deux filles beaucoup plus jeunes. Avec sa barbe blanche et ses cheveux longs il ressemble à Moustaki. Les jeunes rient de celui qui s’est agenouillé devant eux en débitant une tirade inaudible de loin. Lorsque les gens dont il s’approche le repoussent, l’homme roule comme un judoka pour se redresser au milieu de ses admirateurs. Il est vêtu d’un blouson et d’un jean en bon état alors que les quatre jeunes sont sales et portent des vêtements déchirés. Ils ont les yeux brumeux, chargés de fatigue et d’alcool.
D’autres dorment près des radiateurs ou sur un banc.
Deux policiers arrivent et demandent leurs papiers aux dormeurs et à la bande de jeunes. Ils les entraînent tous jusqu’à l’extérieur. Après un bref moment d’attente dans le froid sous le regard des policiers, tous rentrent par une autre porte.
Dunant pense à ses papiers d’identité. Une attestation de perte délivrée par le commissariat de Saint-Pierre lui a permis d’embarquer. Sa validité n’est que d’un mois. Que fera-t-il ensuite ?
Des images décousues traversent son esprit puis s’estompent. Il retrouve l’état du voyageur dans l’attente d’un train ou d’un avion, hors du temps et de la réalité sur laquelle il n’a pas prise. Un temps qui appartient à d’autres, ceux qui définissent les horaires des correspondances. En vacance de responsabilité parce que dépossédé de tout contrôle. C’est peut-être pour ça que certains aiment voyager. Ils sont pris en charge, hors des décisions leur appartenant.
Dunant mange son pain par pincées occasionnelles. Il boit au robinet qu’il découvre au bout du quai. Après avoir rincé une timbale en plastique apportée par le vent, il la glisse dans son sac. Son adolescence lui revient qu’il croyait oubliée : la pompe sur le trottoir réservée aux pauvres qui n’ont pas l’eau chez eux ; les commerçants refusant de donner le pain ou les légumes : « dis à ta mère de payer ce qu’elle me doit. » Il partait, honteux, sous le regard des clients dont certains étaient ses copains de classe, ou, pire, ses copines. Il entendait encore : « ça fait plus d’un mois que j’attends. Ils perçoivent les allocations et s’achètent des choses inutiles… »
Partout il se sentait observé. Au collège on se moquait de ses vêtements reprisés ou de son vieux cartable. Il avait triomphé de tout ça en devenant riche. Une larme coule sur sa joue qu’il essuie furtivement. La peur monte en lui. L’esprit vide, il reste paralysé. Ses pieds sont gelés. Il décide de marcher. Il longe les murs pour éviter la pluie. Ses chaussures sont trempées. Il lui faudrait des bottes.
Il entre dans un magasin. Les pieds au sec et au chaud il se sent déjà mieux. Quinze euros de moins, mais c’était indispensable. Il a même failli s’acheter une cape en plastique. Il a décidé d’attendre. Les mêmes sans domiciles sont dans la gare. SDF ! Qui a eu l’idée d’ajouter le qualificatif de fixe ? Pour faire croire qu’ils ont une résidence mobile ? Une caravane ou une roulotte ? Peut-être même un somptueux camping- car ?
Comme lui ils sont bien sans domicile. Aucun endroit où se cacher. Pas de niche protectrice. Au chaud, adossé contre le mur, Dunant s’endort. Les annonces des hôtesses ne le dérangent plus.
De temps en temps, un policier ou un employé de la SNCF contrôle ceux qui ont l’air le plus misérable. Ils sont conduits à l’extérieur et reviennent peu après.
Dunant est bien vêtu. Le sommeil lui fait du bien. On ne lui demande rien. Il fait partie du monde des nantis qu’on protège des rebuts de la société.
Les passants savent-ils qu’ils seront peut-être bientôt à la place de ceux qu’ils ne veulent pas voir ?
Il fait nuit.
1.35 19
Il ne trouve que des toilettes payantes, se souvenant du temps où la SNCF laissait les WC ouverts à tous. Rentabilité oblige. Même pour uriner, il faut avoir de l’argent. Tout au bout du quai, là où stationnent des wagons vides, l’odeur lui indique un lieu fréquenté. L’idée lui vient de monter dans un train et de se laisser emporter. Où pourrait-il être bien ? On lui prendrait le peu d’argent qui lui reste pour une amende. Non. Ce n’est pas la solution. Il se lave les mains et boit une timbale d’eau. Les voyageurs sont plus nombreux, hommes d’affaires et touristes, travailleurs et étudiants. Chacun marche du pas assuré de celui qui est dans la vie active.
Dunant commence à se sentir chez lui. Il a parcouru les coins et les recoins de son nouveau territoire. Il se demande pourquoi on ne laisse pas quelques wagons pour les sans logis. Bien sûr il faudrait les nettoyer. Le rassemblement de ces pauvres choquerait les voyageurs qu’il faut protéger. C’est bien plus simple est de rejeter ces rebuts de la société plus loin. Toujours plus loin. Comme on le fait pour la neige tombée devant sa porte en attendant qu’elle fonde. Mais la pauvreté ne fond pas.
Au lever du jour, Dunant part dans les rues. Il entre dans une boulangerie et lit longuement les étiquettes. Il achète une grosse boule qu’il coupe en deux avant de la fourrer dans son sac. Il prend une pomme sur un étalage et la croque avec bonheur.
Autour de lui les gens courent pour ne pas perdre une seconde de leur précieux temps. Ce temps dont lui ne sait que faire. Il ne souhaite que le vendre comme eux tous, contre plus ou moins d’argent selon ce que la société a décidé que valait leur profession. Très peu si leur tâche est fondamentale, comme boulanger, paysan ou éboueur. Beaucoup s’ils sont banquier, notaire ou pharmacien. Certains gardent une importante part de ce temps pour leurs loisirs ou leurs enfants. D’autres le vendent entièrement pour posséder plus. Les plus forts dictent leurs codes qui s’imposent aux autres, par la mode ou par la loi. Comme au Moyen-âge, des serfs travaillent pour des seigneurs et des miséreux meurent sur les chemins. La forme seule a changé, ainsi que le nom des diverses catégories sociales.
Dunant se sent devenir révolutionnaire, alors qu’il défendait férocement l’ordre établi quand il en avait les avantages.
S’il avait su !
Si les autres savaient !
1.36 20
Il fait beau. Le soleil illumine les arbres du bord de Seine que l’automne a peints de superbes couleurs.
Il s’assied sur un mur et regarde les péniches et las bateaux emplis de touristes.
« C’est beau Paris » se surprend-il à dire à voix haute.
Il boit un grand chocolat dans un bistrot, refusant les croissants déposés devant lui. En portant sa main à son visage, il sent sa barbe. Il se rase tranquillement dans les toilettes. Une femme arrive, sans doute avertie par un client : « il ne faut pas vous gêner ! Vous n’êtes pas à l’hôtel ! Un chocolat sans croissant ! Une heure à table ! Et en plus vous faîtes votre toilette. Où vous croyez-vous ? »
Il sourit : « merci pour votre accueil. Un jour vous irez peut-être vous aussi faire votre toilette dans un bar…vous ne savez pas ce que l’avenir vous réserve. »
La colère de la patronne semble avoir fondu. Ce que dit cet oiseau de malheur l’effraie.
Dunant retrouve ses angoisses. Encore moins d’argent, nulle part où aller, aucun espoir d’améliorer sa situation. Appuyé contre un arbre il vomit. Adieu pomme et chocolat.
Avec la pluie et le changement de climat il a sans doute pris froid. Il ne manquait plus que ça.
Aller voir un médecin ? Et après ? Il faudrait le payer, acheter des médicaments et…se retrouver sur un banc. Que risque-t-il ?
« Docteur Laurent. Consultations de 8 h 30 à 10 30 ».
Deux femmes et un enfant attendent, assises côte à côte. Un petit homme un peu rouge ouvre la porte : « c’est à qui ? »
Dunant se retrouve seul. Encore un bon endroit pour se mettre au chaud, comme les salons dentaires ou de coiffure, les administrations… Autant de lieux bien chauffés dont l’entrée est libre.
Il se sent fiévreux. Des idées bizarres trottent dans sa tête.
« C’est à vous. Que vous arrive-t-il ? »
Dunant dit son retour de la Réunion, la pluie, le froid…
« Déshabillez-vous ».
Le stéthoscope se promène sur sa poitrine et son dos. Il tousse. Ouvre la bouche. Depuis combien d’années n’a-t-il plus subi tout ça ? Depuis son enfance ?
« Vous avez pris un bon coup de froid. Quelques jours de repos bien au chaud devraient suffire. Votre tension est trop basse. Est-ce que vous vous alimentez correctement ? Je vais vous prescrire de quoi vous remettre en forme. Donnez-moi votre carte vitale. »
« Je n’en ai pas. Je n’ai plus ni travail ni domicile. »
« Vous avez de quoi me payer ? »
« Non. »
« Je vais appeler la police. »
« N’exagérons rien. Je vous ai juste pris un peu de temps. Vous aurez du mal à me faire condamner. Mais si ça vous fait plaisir…au moins, en prison je serai nourri et soigné. »
« Dehors ! Voyou ! Á votre âge… »
« Il n’y a pas d’âge pour être à la rue. Ni pour être généreux. Je croyais les médecins sensibles à la misère humaine. »
« C’est ça ! Voleur et donneur de leçons ! Vous ne manquez pas d’audace ! »
1.37 21
Il doit se reposer.
Il marche dans une rue étroite où le soleil ne pénètre pas.
Il lui faut un lit.
19 euros. Il ne trouvera pas mieux. Il paie et prend sa clé.
La chambre est sombre, l’odeur des pensionnaires précédents partout.
Dunant se glisse sous la couverture sans enlever sa chemise.
Très vite il transpire.
Il a soif. Il aurait dû prendre une bouteille d’eau.
Il enfile son pantalon et part à la recherche d’un lavabo qu’il trouve sur le palier, devant la porte des toilettes. Il boit longuement avant d’emporter le verre posé près du robinet.
Un homme est près de lui : « vous êtes malade ? Vous voulez un médecin ? »
« J’arrive d’un long voyage. J’étais très fatigué. Quelle heure est-il ? »
« Midi. Ça fait plus de vingt-quatre heures que vous avez pris la chambre. Vous devez une journée de plus. »
« D’accord. »
Dunant se sent très faible. Il n’a pas mangé depuis longtemps. Il entend sa mère lui dire : « il ne faut pas nourrir la fièvre. » C’est une excellente maxime pour les pauvres gens.
Il boit quelques gorgées d’eau avant de se raser. Il mange un morceau du pain conservé dans son sac.
Bien décidé à ne pas payer la chambre, il descend l’escalier en essayant de ne pas faire craquer les vielles planches usées.
Il aperçoit le gardien qui est peut-être le patron.
Lorsque l’homme se retourne pour franchir une porte derrière le comptoir, Dunant file dans la rue. Il aperçoit l’hôtelier, debout sur le trottoir, devant sa porte. On a dû lui jouer ce tour un bon nombre de fois. Il ne s’agit là que de quelques heures de dépassement. Pas de quoi ameuter le quartier.
Les jambes flageolantes, Dunant s’adosse au mur. Il rejoint une rue plus importante et pénètre dans une galerie marchande. Un homme, un peu plus vieux que lui vient s’asseoir à ses côtés : « donnez-moi un peu d’argent. Je n’ai rien mangé depuis hier. »
« Moi c’est pire. C’est depuis avant-hier. J’ai du pain dans mon sac. On va le partager. Je m’appelle Dunant. Henri Dunant. Je n’ai pas de maison, pas d’argent, pas de travail… et je suis malade. »
« Je m’appelle Pierre. Tu n’es pas dans la rue depuis longtemps. Tu es trop bien habillé. Regarde mes loques. Et je pue. Tu devrais faire la manche. Quand on est bien fringué, les gens donnent plus souvent. Sans doute parce qu’on leur ressemble. Moi je suis moins qu’un chien. Personne ne me voit. Sauf les flics et les vigiles. Tiens. Quand je te disais… »
Deux gardiens sont devant eux. Ils s’adressent à Pierre : « Dehors ! Tu sais que tu ne dois pas rester là. »
« Il est avec moi » dit Dunant « il ne fait rien de mal. »
« Je sais » dit le plus âgé « on le connaît depuis longtemps. Mais on nous paie pour ça. Les mendiants font fuir les clients. Si on ne les chasse pas on risque notre place. Allez ! Va-t-en. Tu reviendras plus tard. »
1.38 22
Dunant suit Pierre dans un escalier roulant qui les emporte plus haut.
« Tu vois. C’est toujours comme ça. Je vais d’un endroit à l’autre. C’est souvent pire qu’ici. »
« Tu vis de quoi ? »
« Quelquefois on me donne une pièce. Je vais à l’église. L’Armée du Salut fait des tournées avec des soupes. Les Restos du cœur servent des repas. Je me débrouille ».
« Mais pour dormir ? Pour te laver ? Pour t’habiller ? »
« Ah ! Ça c’est plus compliqué. Quand j’échappe aux flics qui nous emmènent dans des dortoirs avec les clochards, je dors dans le métro jusqu’à la fermeture. Après j’essaie les gares. Je connais des couloirs et des parkings… »
« Et tes vêtements ? »
« Des cadeaux. Parce, moi, je ne fais pas les poubelles. »
« Tu vis comme ça depuis combien de temps ? »
« Je ne sais pas. Je ne sais plus. Avant je travaillais. J’ai même des enfants. Ils sont grands. Ils n’ont pas besoin de moi. Tu vas voir. On se débrouille. Tant qu’on n’est pas malade… »
« Est-ce que je peux rester avec toi ? Pour voir… ? »
« Non. Á deux on fait peur aux gens. Moi on me connaît. J’ai mes habitudes. Salut. »
Dunant le regarde partir. Il marche la tête basse et le dos rond.
Quelle vie affreuse ! Fuir. Se cacher. Mendier. Dormir sur le sol. Toujours dans l’indifférence ou même l’hostilité. Quel âge a ce vieux ? Pourquoi n’est-il pas dans une maison de retraite ?
Il se souvient de celui à qui il donnait son âge et qui n’avait que vingt-huit ans. La rue use et vieillit. Celui-là n’est peut-être que quinquagénaire.
Il doit trouver un emploi. Il sait faire tant de choses. Il est prêt à accepter tous les boulots pour se sortir de là. Rien ne le rebutera.
Il se sent faible.
Il doit manger.
Il entre dans un self et choisit un potage et un fromage. En approchant de la caisse il regrette déjà de perdre le peu qui lui reste. Quatre euros vingt. Il mange sans joie et dépose son plateau sur le chariot de la serveuse qui le remercie. Pendant qu’elle essuie les tables, il prend des restes de pain et une pomme abandonnés.
Il se souvient de tout ce qui partait à la poubelle après chaque repas dans sa brasserie. Les services de l’Hygiène sont inflexibles : rien de ce qui est allé sur les tables ne doit être réutilisé. Tout doit disparaître. Passe encore pour ce qui reste dans les assiettes, mais les plats revenus aux trois-quarts pleins nourriraient bien des malheureux. Il ne pouvait pas le vendre, ni même le donner à des éleveurs de porcs comme on le faisait avant.
On jette la nourriture devant des hommes et des femmes qui ont faim.
Il va tenter de se faire accepter par quelques plongeurs qui lui glisseront des restes de repas.
1.39 23
Où coucher ?
Il frissonne.
Il reprend sa marche. Il ne veut pas organiser une survie misérable. Il travaillera.
Il regarde les annonces dans un bureau de l’ANPE. Toujours il faut une voiture ou un diplôme, parfois les deux.
Son tour vient de s’asseoir face à l’employée qui demande : «où habitez-vous ? »
« J’arrive de la Réunion Je n’ai pas de domicile. »
« Que faisiez-vous là-bas ? Pourquoi êtes vous parti ? »
« J’étais serveur dans un hôtel restaurant. Et aussi réceptionniste. On m’a proposé la gestion d’un hôtel à Paris. Et…ça ne s’est pas fait. »
« Pourquoi ? »
« Parce qu’en fait l’hôtel n’était pas libre. La vieille femme qui me l’avait promis n’a plus toute sa tête. »
« Vous auriez pu vérifier. »
« Comment aurais-je pu penser ? Le nom du propriétaire était bon, puisque c’est son neveu qui l’a repris. »
« Donnez-moi vos attestations d’emploi, votre C.V et votre carte d’assuré social. »
« J’étais patron d’un brasserie avant de partir à la Réunion. Mon divorce et une enquête fiscale m’ont tout fait perdre. »
« Vos papiers ? »
« Je les ai perdus. Ou plutôt on me les a volés après m’avoir battu. Voilà l’attestation du commissariat. Je vais les faire refaire. Mais ce n’est pas gratuit et mon argent aussi a disparu. »
« Revenez me voir lorsque vous aurez réglé ce problème. »
« Comment vais-je vivre si je ne travaille pas ? »
« Allez à la mairie. Demandez les services sociaux. »
Elle s’adresse à un jeune homme debout derrière lui : « asseyez-vous. »
Dunant va s’asseoir sur le banc où attendent les autres.
Il frissonne toujours.
Il est perdu.
Son esprit est vide. Il n’arrive pas à penser.
Un homme tape sur l’épaule de Dunant : « il faut partir. On ferme. Rentrez chez vous. »
Chez lui !
Il se retrouve sur le trottoir, devant le rideau qui descend.
Chez lui. Il y est. Ce trottoir. Cette rue. C’est là chez lui. Dans le froid de cette fin de journée hostile.
Chez lui. Il répète ces deux mots qui rythment son pas lourd. Chez lui. Chez lui.
Et s’il sautait dans la Seine ? Ou sous une voiture ?
Il a de quoi tenir encore un peu. Il va trouver une solution.
Il entre dans un supermarché. Un vigile lui demande de laisser son sac. Des clients passent près d’eux portant des cabas et des sacs à main sans qu’aucune remarque ne leurs soit faite. Aurait-il déjà l’allure d’un miséreux ?
Il sent qu’on le regarde. Des caméras le guettent sans doute.
Reprenant son sac il retourne à la rue.
Il achète un pain et un litre de lait.
La nuit tombe.
Il parcourt les petites rues à la recherche d’un hôtel bon marché.
Il faut qu’il se repose. Demain il sera mieux.
1.40 26
« Je n’ai que quinze euros » dit Dunant à l’homme debout derrière le comptoir.
« C’est bon. Prenez la 1. Á droite en haut de l’escalier. »
Un petit lit occupe toute la chambre minuscule.
Il ouvre sa bouteille de lait et boit à grandes gorgées. Le pain ne le tente pas.
Il se couche sans ôter sa chemise ni son pull. Il ne parvient pas à se réchauffer. Ses jambes sont douloureuses.
« Trouver un travail ! Un travail ! Un travail… » Il s’assoupit en répétant ces mots.
Des gens parlent dans l’escalier. Les portes claquent. La chasse d’eau est fréquemment tirée tout contre la cloison. Il se sent quand même protégé par sa porte fermée à clé.
Chez lui.
Ici personne ne le voit.
Il s’est réchauffé, recroquevillé dans le lit étroit dont les ressorts pénètrent sa peau.
Quand il se réveille, il fait encore nuit. La double ligne des phares parcourt de plus en plus fréquemment le plafond. Il essaie de comprendre dans quel sens vont les véhicules par rapport au parcours de la lumière.
Il se décide à s’asseoir pour manger un bout de pain et boire une timbale de lait avant de retomber dans un sommeil entrecoupé de rêves. Il est derrière un comptoir. Brigitte tient la caisse. Smet et Francis servent les clients.
Des coups frappés à la porte l’arrachent au lit : « il est dix heures ! Dehors ! »
Il se trouve face à l’homme qui l’a reçu la veille. « Tu ne paies même pas le prix et tu voudrais rester deux jours ? »
« Excusez-moi. Je m’en vais. Je n’ai pas l’heure. C’est pour ça… »
« Et bien moi je l’ai. Bon vent ! »
Une petite pluie qui fait presser les gens l’accueille sur le trottoir. Il referme son imperméable et avance rapidement. Il garde sa brique de lait à la main pour ne pas la renverser. Comme le froid engourdit ses doigts, il avale ce qui reste. La prochaine fois il choisira une bouteille avec un bouchon à vis.
Ne trouvant pas de poubelle, il laisse tomber l’emballage au sol.
« Salaud ! » dit un homme qui le croise.
On le chasse de l’hôtel dont il avait payé la chambre, on l’insulte dans la rue. Et lui le violent ne réagit pas.
Il est redevenu transparent. L’homme invisible que les regards traversent. Si c’est le regard des autres qui nous fait homme, il est à nouveau un animal. L’envie lui vient de s’allonger sur le trottoir sous les pas. Il rit : « personne ne s’arrêtera. Ils s’essuieront les pieds sur toi. »
Le voilà qui parle seul. Comme ceux qu’il observait depuis sa vitrine. Perdus dans leurs pensées. Seuls au monde. Avec ses clients il se moquait de ces solitaires. Peut-être l’observe-t-on même s’ils sont très nombreux à errer ici.
1.41 27
Arrivé à la gare, il se rase à l’eau froide avant d’aller s’accroupir au bout du quai. Il n’a pas eu le temps d’utiliser les toilettes de l’hôtel.
Les mêmes miséreux sont affalés sur les bancs ou tendent la main sans succès devant les voyageurs trop pressés.
Dunant s’approche d’une femme de son âge qui range sa monnaie « pourriez-vous me prêter de quoi acheter un ticket de métro ? On vient de me voler mon portefeuille. »
« Bien sûr. Avez-vous signalé le vol ? Vous devez être bien ennuyé. »
« Laissez-moi votre adresse, je vous renverrai… »
« Je vous en prie. Si cela m’arrivait, je serais trop contente qu’on me dépanne. »
Il reste avec ses cinq euros dans la main, la regardant s’éloigner. C’est la première fois…non ! Les jeunes touristes, à Saint-Pierre lui avaient aussi donné…c’est facile. Il a trouvé le bon filon.
Il entre dans un café et commande un café.
De retour dans la gare, il redit son histoire à des voyageurs. Ça marche une fois sur cinq. On lui donne un ou deux euros. Certains ne le regardent même pas. Un jeune homme lui dit durement : « c’est facile ton truc. Moi je travaille pour gagner de l’argent. Tu n’as qu’à t’y mettre. »
Deux policiers qu’il n’a pas vu venir l’encadrent soudain : « suivez-nous ! »
Ils l’entraînent dans une petite pièce : « vos papiers ».
Il leur présente l’attestation de perte du commissariat Saint Pierrois.
« C’est tout ce que vous avez ? »
« On m’a tout volé là-bas. »
« Où habitez-vous ? »
« Á l’hôtel. Je cherche du travail. » Il commence à raconter l’histoire de la vieille femme qui lui avait promis…
« Ouais. Des histoires bizarres, on nous en raconte tous les jours. Vide tes poches. »
Ils retournent son sac sur la table. Les chaussures tombent avec le pantalon et le pain.
Celui qui compte les pièces dit : « tu ne t’embêtes pas. En quelques heures tu gagnes autant que moi en une journée. Reprends ça et disparais. On ne veut plus te voir ici. »
Dunant ne dit rien. Il sait qu’il n’est pas le plus fort. Il récupère son argent : trente six euros ! Il décide de changer de gare et de reprendre son travail. Il rit en se disant qu’il a pensé « travail ». Le travail est une activité qui procure de l’argent. Il raconte une histoire. On le paie. Les acteurs ne font pas autre chose et sont bien mieux payés que lui.
Il descend dans le métro et répète son histoire. Les Parisiens, sans doute trop sollicités, sont plus rares à donner.
Deux jeunes le poussent vers un distributeur. L’un d’eux tient un couteau ouvert.
« Ton fric Pépé. Á toi ils donnent facilement parce que tu leur ressembles. C’est pas juste. »
Il ne résiste pas et les laisse fouiller ses poches.
Personne ne s’arrête.
Les voyous ne lui laissent rien.
C’est la loi de la jungle. Les plus forts triomphent toujours.
1.42 28
Il va s’organiser. Avec un plan il programmera ses lieux de collecte. Il doit soigner son apparence. Moins il aura l’air d’un mendiant, plus il recevra. Il s’offre un repas dans le petit restaurant voisin. Le patron, septuagénaire, a sans doute renoncé à faire fortune. Il prend le métro avec un ticket resté au fond de sa poche. Il pourra dire son histoire avec plus de conviction. Ce ne sera plus un mensonge. Il va devoir se méfier des voyous et des flics. Il y a tant de gares, de stations de métro et d’arrêts de bus, il pourra survivre tant qu’il sera présentable. Il va devenir un professionnel de la manche.
De temps en temps il change de lieu, boit un chocolat et s’offre même un sandwich.
Le soir il possède trente trois euros. Il choisit un hôtel semblable à celui de la veille : « vingt euros la chambre. Les WC et les douches sont sur le palier. Vous avez un broc et une cuvette dans la chambre » dit la vieille femme qui le reçoit.
« Je vais rester quelques jours. Je cherche du travail. »
« Mon pauvre, ce n’est pas facile. Surtout à votre âge. Que faîtes-vous ? »
Dunant raconte sa brasserie, le service, la cuisine …
« On embauche plus facilement des jeunes. Ça coûte moins cher. Avec toutes les charges…Regardez, moi, j’ai soixante-huit ans et je travaille encore parce que ma retraite ne me fait pas vivre. Je ne peux pas payer les réparations…la vie est dure pour tout le monde. »
La chambre est propre. La rue est calme.
Dunant se sent bien.
Il a un gîte et le moyen de gagner assez pour que ça dure.
Pour huit euros, il mange comme il ne se souvenait plus de l’avoir fait.
Il lave sa chemise, son slip et ses chaussettes dans la grande cuvette en faïence. Il nettoie son pantalon et son imperméable et s’endort tranquillement.
Á son réveil, tout est sec. Sa logeuse repasse la chemise pendant qu’il savoure le petit déjeuner fait de tartines de beurre et confiture.
Laissant son sac dans la chambre, Dunant quitte l’hôtel ragaillardi et impeccable. Il achète un attaché cas d’homme d’affaires.
Il n’a plus un sou mais il se sent fort. Il commence sa journée à un arrêt de bus où il reçoit dix euros en petite monnaie. C’est l’heure des ménagères et des vieux.
Malgré les risques, il décide de privilégier les gares.
Á midi il a plus de trente euros.
Il mange un steak frites et se promène dans ce Paris qu’il ne connaît pas.
1.43 29
Les policiers sont partout. Il quitte rapidement ce terrain fructueux.
Dans le métro, comme aux arrêts de bus, les gens sont pressés, fatigués et irritables. Dunant retourne à son hôtel. Il paie sa chambre à la vieille femme qui dit : « vous avez le temps. Je vous fais confiance. Je vois bien que vous êtes un honnête homme. Vous me paierez à la fin de chaque semaine. Je vous ferai un prix puisque je ne changerai pas vos draps tous les jours. »
Dunant se réconcilie avec l’humanité. L’aubergiste lui offre un petit alcool de poire de sa propriété limousine en lui racontant sa vie. C’est comme s’il trouvait une famille.
Il va rationaliser son travail, économiser son argent et, dans quelques temps…
Il dort comme un ouvrier fatigué qui sait qu’une dure journée l’attend.
Le lendemain, Dunant décide de ne pas perdre de temps aux arrêts bus et dans le métro. Il part pour Orly.
Les bagages enregistrés, les voyageurs ont du temps libre. Ils sont détendus puisqu’on les prend en charge. Bon nombre d’entre eux sont des gens aisés. Dunant modifie son discours : «Excusez-moi. Je suis vraiment très mal à l’aise de vous déranger, mais on vient de me voler mon portefeuille et mon téléphone. Je n’ai plus ni argent, ni carte de crédit, ni chéquier. Il faut que je prenne un taxi pour rejoindre ma famille à la gare… »
Ça marche. Au début de l’après-midi, il a plus de cent cinquante euros. Il ne s’arrête pas pour manger. Se méfiant des policiers, il change souvent d’étage. Ce sont deux civils qui l’encadrent soudain. Il est conduit vers une porte ornée de la plaque « police de l’air et des frontières ». Plusieurs personnes sont assises dans le petit local.
« Vos papiers ! » Il dit à nouveau son histoire.
« Envoie un message à Saint-Pierre » dit le plus âgé à son collègue.
« Où étiez-vous avant ? » Il parle de la brasserie et de sa vie d’avant. Le policier note tout.
« Demande confirmation au commissariat. » Revenant vers Dunant : « de quoi vivez-vous depuis que vous êtes à Paris ? »
Dunant parle d’économies et donne l’adresse de son hôtel.
« Nous allons vous garder le temps de vérifier. »
Il se retrouve sans ceinture et sans lacets dans une pièce dont un côté est fait de barreaux. Trois hommes sont déjà là qui parlent une langue gutturale.
On leur sert bientôt un potage et une purée en leur donnant une couverture.
Dunant s’allonge sur la planche qui sert de siège. Quelques heures plus tôt, il était le plus heureux des hommes, sûr de lui et de son avenir.
Tout recommence.
Il ne peut plus penser. Ces coups répétés l’ont fragilisé.
Quel mal faisait-il ? Il ne volait personne. Ses donateurs étaient des nantis. C’était juste de la solidarité. Qui va tirer avantage de son retour à la misère ?
Il n’a pas de colère. Juste une grande lassitude. Que peut-il faire contre ceux qui se liguent contre lui ? La police, les voyous, l’État…
1.44 30
Les deux policiers viennent le chercher à la fin d’une nuit sans sommeil : « On sait tout. Á la Réunion tu t’es battu. Tu as laissé ton travail en cours de contrat. Avant, dans ta ville, tu étais un clochard alcoolique. Te voilà devenu escroc. Tu as de la chance que le procureur ait décidé ne pas lancé d’action contre toi. Nous avons réglé ton hôtel, avec ton argent bien sûr. Tu n’as pas intérêt à ennuyer la patronne. Elle nous préviendrait aussitôt.
Tu vas où tu veux mais tu cesses tes histoires de vol. Ton argent reste consigné ici pour le cas où on aurait des plaintes de tes victimes.
Voilà quinze euros.
Tu sais qu’on t’a à l’œil. Tous les commissariats ont ton signalement. »
Ils le raccompagnent à la porte de l’aérogare.
Un pâle soleil perce la brume du matin. Il fait froid.
Dunant demande à un chauffeur de taxi qui dépose un client de le ramener à Paris : « je n’ai plus rien. Ni argent ni bagages. Puisque vous repartez… »
« C’est ça ! Je vais vivre de quoi ? Fais du stop. »
Après avoir essuyé plusieurs refus, il s’adresse à un jeune homme qui accepte de l’emmener à Paris.
« J’ai tout perdu » a simplement dit Dunant.
Au cours du trajet, le chauffeur ne pose aucune question à ce passager taciturne.
« Voilà la Porte d’Italie. Vous avez le métro et des bus. Bonne chance. »
La ville est animée. Les gens marchent, courent, parlent et rient.
Il reste comme un pantin dont on a cassé le ressort.
Le froid le pénètre peu à peu.
Il marche pour se réchauffer. Droit devant lui. Il ne voit rien ni personne. Le temps n’existe plus. Les autres ont disparu.
Il descend dans le métro. Il s’assied au bas des marches. Le froid glisse de l’escalier. Il voit des voyageurs sauter parfois par-dessus la barre au lieu de glisser un ticket. Ce sont des jeunes le plus souvent, mais parfois des hommes d’âge mûr. Quelques femmes se risquent aussi à cette acrobatie.
Dunant attend d’être seul, et, posant ses mains de part et d’autre du portillon, il saute. Il court pour échapper à un contrôle. Les policiers le connaissent. Il ne veut pas…
Sur le quai, la température est plus supportable. Il s’affaisse sur un banc et n’entend plus passer les rames.
Endolori, la tête lourde, il émerge d’un sommeil qui ne l’a pas reposé.
Il a soif. Il a faim.
Une jeune fille sale et mal vêtue lui demande : « donnez-moi un peu d’argent. Je n’ai rien mangé ni bu depuis hier. »
« Moi non plus. J’ai faim. J’ai soif. Je n’ai rien. »
« Menteur. Tu es trop bien fringué. »
L’attaché case de Dunant a disparu. Son voleur sera déçu. Les vêtements de rechange, les rasoirs et les bottes sont restés à l’hôtel. Sa logeuse les lui rendrait peut-être ? Elle appellerait peut-être la police.
Il n’est pas rasé. Ses vêtements sont froissés. Il ressemble de plus en plus à un SDF.
Il pousse la porte d’un bar. Les serveurs s’affairent. Il commande un grand chocolat qu’il savoure en dévorant un croissant.
« Les toilettes s’il vous plaît ? »
« Au bout du comptoir à gauche » répond le barman engagé dans une conversation avec deux clients.
Dunant découvre son image. Il paraît soixante ans. Des rides creusent son visage cireux. Sa barbe lui donne un air sale accentué par ses yeux rougis. Il se frotte avec ses mains mouillées. L’essuie mains lui sert de serviette.
En montant l’escalier, il se demande s’il aura assez d’argent pour régler sa consommation. Le bar paraît chic…
Des jeunes qui entrent le bousculent. Sans réfléchir il file par la porte restée ouverte. Il court comme il ne l’a plus fait depuis longtemps. Jusqu’à ce que ses poumons en feu lui interdisent d’aller plus loin.
1.45 31
Personne ne l’a suivi.
Il s’appuie contre un mur.
Les commerces se ferment déjà. Toutes les portes sont équipées de digicodes. D’un côté le calme, la chaleur, les familles et les bons repas, de l’autre la rue et ses dangers. C’est le domaine des misérables.
Dunant n’ose plus revenir dans une gare, ni même le métro.
Il s’enfonce dans les ruelles. Là aussi les portes sont bloquées. Il en pousse une plus délabrée qui s’ouvre sur un trou noir. Il cherche un interrupteur. L’ampoule qui pend au bout du fil découvre un escalier sous lequel s’entassent poubelles et cartons.
Il fait moins froid que dehors.
Il se glisse derrière les poubelles, étale des cartons sur le sol, s’allonge et se recouvre des emballages restant.
C’est plus confortable et tranquille que les bancs du métro.
Chaque fois que la porte s’ouvre, une bouffée de froid vient jusqu’à lui. Les pas montant l’escalier au ras de son oreille annoncent l’entrant : pieds légers d’un enfant, talons, choc lent et lourd…
Les bruits cessent. Il dort tranquillement.
« Dehors ! »
Ce cri le réveille brutalement.
Il ne sait plus où il est.
« Il faudra mettre une serrure pour se débarrasser des clochards. Un de ces jours il y en a un qui mettra le feu et nous grillerons tous dans nos lits. »
Un homme, plus grand que lui, le pousse vers la porte. Un pied l’atteint durement sur une cuisse. Il tombe sur le trottoir. Les passants le contournent sans s’intéresser à son sort. Son visage a heurté le pare-chocs d’une voiture en stationnement. Sa main est posée sur une crotte de chien. Le sang coule de sa pommette gauche. C’est l’odeur du chien qui le gène le plus.
Il traverse la rue pour laver la déjection dans l’eau du caniveau. Les employés municipaux qui nettoient le trottoir, regardent cet homme à genoux qui nettoie ses mains dans le courant emportant les papiers gras.
Dunant se met en route dans le flot des passants.
Alors qu’il entre dans un magasin, le vigile l’arrête : « tu ne peux pas entrer. Va te laver. Tu ferais fuir les clients. »
« Qu’est-ce que j’ai ? »
« Les restes de ta bagarre. Ton visage est plein de sang. »
L’homme entraîne Dunant devant un miroir dans lequel il découvre ses cheveux hérissé et son visage maculé. Le sang coule jusqu’à sa chemise et son imperméable. La barbe lui mange le visage.
« Allez ! Va-t-en ! » dit le gardien en l’accompagnant à l’extérieur.
1.46 3
Après avoir acheté une bouteille de lait et un demi pain dans une petite épicerie, il s’assied sur un banc pour reprendre des forces.
Le froid le remet en marche. Son sac en plastique pendant à sa main, il se décide à entrer dans une gare. La recherche d’un robinet le conduit au bout du quai, bien au-delà de la verrière. Il marche encore jusqu’à trouver un coin tranquille. Il baisse son pantalon et regrette de n’avoir pas ramassé un des nombreux papiers traînant dans la salle. Il est sale et malodorant. Ses vêtements ne l’ont pas quitté depuis plus de quarante-huit heures.
Il passe le reste de la journée de la salle d’attente au quai. Il a fini de manger son pain et de boire son lait. Il emplit sa bouteille d’eau. En observant les gens, il récupère quelques fins de sandwiches et des fonds de paquets de gâteaux abandonnés. Il n’ose plus solliciter les voyageurs par peur de la police. Comme les moineaux qui se chamaillent, il se contente de ce que les autres jettent.
Avec le soir, les SDF quittent les lieux. Dunant les suit. Ils s’approchent d’un fourgon stationné sur le trottoir pour recevoir de la soupe et du pain.
Une femme l’interpelle : « venez ! »
Elle lui tend un bol en plastique. « Vous venez d’arriver ? »
« Je suis là depuis quelques jours. »
« Vous avez besoin de quelque chose ? »
Il la regarde avec étonnement. « Oui. J’ai besoin d’un travail. Je suis cuisinier. Je peux balayer ou faire la plonge. N’importe quoi. J’avais une brasserie et… »
« Pour tout ça il faut que vous alliez à l’ANPE et aux services sociaux. Je parlais de nourriture. Notre association a peu de moyens. »
« Vous venez tous les jours ? »
« Tous les soirs. Á peu près à la même heure. Ne restez pas là. Retournez chez vous. »
Chez lui ! C’est où chez lui ?
Tous les soirs il aura de quoi manger. Boire chaud lui fait du bien. Il y a donc des gens qui s’intéressent aux pauvres.
1.47 4
Il retourne dans la grande salle. Ceux qu’il a vus quêter ou dormir ont disparu. Ils doivent savoir où se cacher. Dunant s’approche d’un groupe de jeunes qui se moquent des voyageurs. Certains ont les yeux voilés et les mains tremblantes. Les vieux pulls et les pantalons déchirés ne permettent même pas de distinguer les garçons des filles.
« Casse-toi le vieux ! » crie un des jeunes hommes « nos meufs ne sont pas pour tes sales pognes ! »
Les jeunes vont en bande. Les vieux sont solitaires. Comme chez les animaux.
Où dormir ?
Les policiers vont le chasser. Il ne veut pas retourner en cellule.
Dunant marche à la recherche d’un couloir ou d’un coin protégé. Ça et là, des corps sont enveloppés dans des couvertures sous des cartons.
Il ne peut faire comme eux. La peur et le froid l’empêcheraient de fermer les yeux.
Il se souvient de titres : « un SDF roué de coups. ». « Un mendiant jeté dans la Seine. »
Il doit trouver un refuge.
Ses muscles engourdis par une journée d’inaction se détendent peu à peu. Marcher lui fait du bien. Si seulement il avait des chaussures adaptées. Ses chaussettes sont trouées. Ses talons deviennent douloureux.
Il a poussé plusieurs portes. Les couloirs sont trop droits, ne laissant aucune possibilité de se cacher.
Dans le décrochement d’une vitrine, un tas de cartons s’offre à lui. Il en dépose une couche sur le sol et tire le reste sur lui, comme il le ferait d’un édredon anguleux. Personne ne peut le voir. Le froid s’atténue. Il s’endort.
« Au secours ! Laissez-moi ! »
Une lampe l’aveugle. « C’est pas prudent de te mettre là-dessous. J’aurais pu te traverser avec mon pic » dit un grand noir armé d’un outil pointu dont il se sert pour amener à lui les cartons que son partenaire expédie dans un camion. « Tu es seul ou ta fiancée dort encore là-dessous ? »
Dunant s’éloigne en tremblant : mourir dans la rue, transpercé par le pic d’un éboueur. Quelle fin horrible !
Insensible à la douleur de ses talons, il marche sous la pluie froide. Il avance comme s’il ne devait plus s’arrêter. Il se souvient des histoires de son grand-père racontant les journées de fuite ininterrompue devant les Allemands. Il marche comme lui. Sans savoir où il va. Sans penser ni souffrir.
Se souvenant soudain que les policiers lui ont laissé dix euros, il pousse la porte d’un café et s’installe au comptoir.
« Un café s’il vous plaît. »
« Dehors ! Je ne sers pas les clochards. Tu pues ! Va te laver ! »
Le petit homme qui ne lui arrive même pas à l’épaule, le pousse sur le trottoir.
« Tu n’as qu’à bosser. Tu pourras te laver chez toi. »
Il a froid.
L’eau dégouline dans son cou.
Il serre son billet dans sa poche. On ne veut même pas de son argent.
Les gens sortent du métro qui vient de démarrer. Il va pouvoir s’abriter. Il saute par-dessus le tourniquet.
Il fait moins froid que dans la rue mais il tremble toujours.
Il cherche quelque chose à manger dans les poubelles. C’est trop tôt. Elles sont vides.
Il tombe sur un banc et s’endort d’un coup.
1.48 5
Un poids contre son épaule l’arrache à ses cauchemars. « J’ai faim. Tu n’as pas quelque chose à manger ? » demande une femme affalée sur lui.
Il la repousse. « J’ai de l’eau. C’est tout. »
Tête renversée, elle boit au goulot.
Elle peut avoir la quarantaine. Elle est blonde et pas très grosse. Un épais manteau l’enveloppe.
« J’avais une belle maison. Mon mari m’a chassée. Mes amis se sont lassés. Je ne sais rien faire d’autre que le ménage et la cuisine. Je n’ai pas mangé depuis hier matin. Je n’ose pas mendier. Si j’avais du courage je sauterais sous le métro. Là au moins je les obligerais à s’occuper de moi. Mais vous vous moquez bien de ce que je dis. »
« Non. Je vous écoute et je pense comme vous. J’avais une brasserie et deux maisons. Le fisc et ma femme m’ont tout pris. Personne ne veut m’embaucher. J’ai connu les cyclones à la Réunion, les coups et la police…je viens de me faire chasser d’un café. Même mon argent pue. C’est le fond. »
« Vous avez de l’argent ? Á moi ils ne refuseront pas. Donnez-le moi. »
Il la suit jusqu’au buffet. Elle entre avec le billet de dix euros qu’elle dépose sur le comptoir. Dunant l’observe à travers la baie. Elle se fait servir deux cafés et deux croissants avant de se diriger vers une table près de la porte. Le serveur ne la voit pas sortir. Ils boivent le café chaud en dévorant les croissants. Elle tend son billet à Dunant: « je l’ai repris sans qu’on me voie. Ils sont tous attablés, le ventre plein et bien au chaud. Pourquoi eux ? On me disait trop douce. Je vais devenir enragée. »
« Moi c’est le contraire. J’étais plutôt violent et maintenant je supporte tout sans réagir. Trop c’est trop. Je suis une épave. Rien d’autre ne m’atteint que les coups et le froid. Je ne vois même plus les gens pour qui je n’existe pas.»
« Nous pourrions rester ensemble. Á deux c’est plus facile. »
« Je ne sais pas » pris d’un doute il annonce : « je n’ai que ces dix euros. »
« Ce n’est pas pour votre argent. C’est pour ne pas être seule. Une femme dans la rue c’est une proie pour tous. Je subis sans arrêt des propositions, parfois des violences. »
« Si j’étais une femme je n’hésiterais pas à me vendre. J’y gagnerais un toit et de l’argent. »
« C’est ce que j’ai fait pendant près de vingt ans… »
« Parce que vous étiez… »
« Pas dans la rue. Dans ma maison. Je n’avais qu’un client qui se servait de mon corps, de mes mains, de mon temps, jusqu’au jour où il n’a plus eu envie de moi. »
« Ce n’est pas de la prostitution. »
« Même si ça y ressemble, ça, je ne pourrai jamais…aller avec des inconnus…accepter tout d’eux…subir dans mon corps…Non ! Jamais ! »
Elle pleure doucement.
1.49 6
« Ça fait longtemps que je n’ai plus parlé. Ça fait mal. » Elle sourit « mais ça fait du bien aussi. »
« Depuis que je suis rentré de la Réunion, je n’ai parlé à personne moi non plus. Là-bas, la petite amie de mon patron, une psychologue, me faisait parler et voulait toujours tout expliquer. Pour elle le monde est beau et peuplé de gentils. Elle le croit vraiment. Elle parvenait à me convaincre. »
« Vous l’aimiez ? »
« Non. Peut-être oui. Qu’est-ce que ça veut dire aimer ? J’avais besoin qu’on m’écoute. Tout le monde a besoin de quelqu’un qui l’écoute, qui lui sourie, qui l’apprécie…comme les bébés…comme les enfants…même si moi… »
Dunant se raconte comme il ne l’a jamais fait. Il parle. Il parle. Comme s’il émergeait après avoir été entraîné par un courant irrésistible. Les mots qui sortent de lui sont aussi salvateurs que l’air qui pénètre dans les poumons du plongeur retrouvant la surface qu’il ne croyait plus atteindre. Elle l’écoute. Comme elle a écouté pendant toutes ces années. Ces années dont le sens est perdu puisqu’elle est rejetée. Ces journées d’attente du retour du guerrier chasseur rapportant au logis ce qu’il fallait pour vivre après avoir affronté les clients de sa banque.
Elle était la Femme. Comme au temps des cavernes.
Son Protecteur l’a chassée. Comme on jette un objet devenu inutile.
Elle voudrait dire tout ça, mais cet homme a trop besoin de se prouver qu’il est vivant.
Il dit : « je vais m’en sortir. Vous verrez. Je m’occuperai de vous. Ayez confiance. Je ne suis pas battu. »
Elle sourit.
Elle voudrait tellement le croire. Elle est pourtant sûre qu’il n’a plus de ressort. Il est brisé.
« Je vais chercher un sandwich. Nous trouverons une solution » dit Dunant.
Il revient en marchant vite, ne ressentant plus ses pieds endoloris. Il est décidé à raconter à nouveau des histoires aux voyageurs.
Elle…comment s’appelle-t-elle, Il ne lui a même pas demandé son prénom, pas plus qu’il n’a dit le sien. Elle fera le guet pour annoncer les policiers.
Á deux ils seront forts. Avec l’argent reçu ils loueront un appartement. Á son nom à elle et à son ancienne adresse puisqu’elle a des papiers. Dans quelques temps il cherchera une gérance. Un petit bar ou un restaurant ouvrier pour commencer.
1.50 7
Elle n’est plus sur le banc.
Elle est sans doute aux toilettes. Elle devait avoir quelques pièces dans sa poche.
Il a faim. Il partage le sandwich et ne se décide pas à manger seul.
Il attend.
Longtemps.
Et si…si elle n’était pas ce qu’elle a dit ? Si elle s’était moquée de lui ? Elle n’a peut-être pas volé les croissants ce matin. Elle a pu payer sans qu’il le voie. C’est peut-être une enquêtrice qui fait une étude sur les SDF. Il se tasse sur le banc.
La voilà qui revient !
Dunant court vers elle. « J’ai cru…Oh ! Pardon ! Je vous avais prise pour quelqu’un d’autre. »
Les manteaux se ressemblent mais ce n’est pas elle. La femme, trop maquillée, dit sèchement : « laissez-moi ou j’appelle la police. Des gens comme vous devraient être en prison. »
Il retourne s’asseoir. Sa main, crispée sur le demi sandwich, devient douloureuse.
Le tourbillon l’aspire toujours vers le bas. Encore et encore. Comme s’il n’y avait jamais de fin. Il tombe lourdement du banc.
C’est aux urgences de l’hôpital que Dunant reprend conscience. Un jeune homme l’ausculte. « La tension est basse et le pouls trop rapide. Avez-vous mal quelque part ? »
« Où est-ce que je suis ? »
« Á l’hôpital. Où avez-vous mal ? »
« Nulle part. Si. Au talon. Et à l’estomac. »
« Vous avez mangé ? »
« Oui. Non. J’ai encore un demi sandwich puisqu’elle est partie. »
« Qui est parti ? »
« Je ne sais pas. Elle ne m’a pas dit son nom. »
« D’accord. Et vous ? Comment vous appelez-vous ? »
« Dunant. Henri Dunant. On m’a pris mes papiers à la Réunion. Á l’île de la Réunion. »
« C’est ça. Ici on est à Tahiti et moi je suis Napoléon. »
Dunant revoit la femme au manteau. Elle l’attend sûrement. Il doit aller à la gare.
Pendant que l’interne s’éloigne, Dunant descend de son brancard et s’en va.
Il doit la retrouver.
Elle l’attend.
Il marche aussi vite qu’il peut dans la nuit.
Elle est peut-être partie en croyant qu’il l’abandonnait.
Brigitte !
C’était Brigitte. Il l’a laissée encore perdue.
Il marche sans savoir où il va.
Il a faim.
Il cherche dans les poubelles de quoi apaiser son estomac. Enjambant la clôture d’un petit square, il boit l’eau d’un bassin qu’il recueille dans ses mains. Il pénètre dans un parking dont les seules lumières des issues de secours l’aident à se guider. Il trouve des cartons, peut-être laissés là par un autre miséreux.
Il se dissout dans le sommeil. Un sommeil difficile que le froid pénètre peu à peu. Il cherche un véhicule qui serait resté ouvert pour s’y abriter. Il s’allonge sur un capot conservant un peu de la chaleur du moteur. Retrouvant sa cache, il s’enroule dans les cartons.
Les jours se succèdent entre la quête dans les poubelles et son parking.
Rien ne mesure le temps qui perd tout son sens. Il ne sait plus si la journée qu’il retrouve est la même ou une autre. Il cherche de la nourriture quand il a faim. Il boit l’eau du square. Il utilise un angle du parking pour ses besoins naturels.
1.51 8
« Fous le camp ! »
Un balai frappe son dos.
Un gros bonhomme rougeaud hurle : « dehors ! Salaud ! Je devrais te faire manger ta merde ! Si j’avais su que tu te cachais là ! »
Dunant titube jusqu’à la porte. Le gardien le pousse avec son balai jusqu’à ce qu’il s’effondre sur le trottoir.
Les passants contournent cet ivrogne drogué. Ils vont à leur travail ou rapportent leurs courses. Ils sont si nombreux ces rebuts de la société.
Deux policiers sont plantés à côté du corps qui se relève. « Ça va ? Vous ne pouvez pas rester là. Donnez-nous vos papiers. »
Fouillant ses poches, Dunant retrouve l’attestation réunionnaise.
« Ce n’est pas valable. Vous auriez dû faire refaire une carte d’identité. Où habitez-vous ? »
« Là » dit Dunant en montrant la porte du parking « le gardien vient de me jeter dehors. »
Il ne reconnaît pas la voix rauque et sifflante qui sort de ses lèvres.
Depuis quand n’a-t-il pas parlé ?
« Relevez-vous. Suivez-nous au commissariat» dit le policier qui n’ose pas toucher ce clochard malodorant.
Dunant parvient à se mettre debout. Le sol fuyant sous ses pieds rend son pas incertain.
Quand il entre au commissariat, il est en sueur et complètement épuisé.
« Assieds-toi. On va s’occuper de toi. »
« Dunant. Henri Dunant. On a quelque chose. »
La peur tord son estomac vide. Ils vont lui reprocher ce qu’il faisait à l’aéroport. Quelqu’un a peut-être porté plainte contre lui.
Il doit fuir.
La porte est trop loin. Ils le rattraperont tout de suite.
« Un avis de recherche :Madame Folet. Souhaitez-vous que nous l’informions ? »
« Je ne la connais pas. Je n’ai rien fait à personne. »
« C’est une dame qui aurait travaillé avec vous à la Réunion. Brigitte Folet. »
Brigitte.
Elle s’appelle donc Folet. Il ne l’avait jamais su. Elle veut récupérer son argent. Que risque-t-il ? Elle ne lui fera pas de mal.
« Alors ! Tu réponds ? »
« C’est d’accord. »
« Il signe le papier tendu par le policier sans même savoir de quoi il s’agit et retourne s’asseoir sur le banc.
La chaleur l’engourdit. Il s’endort, la tête appuyée contre la cloison.
« Henri ! Dans quel état ! »
Ouvrant les yeux, Dunant devine un corps devant lui.
« Viens. Je vais m’occuper de toi. »
Cette voix !
C’est Brigitte !
Depuis combien de temps est-il là ? Comment l’a-t-elle retrouvé ?
Elle prend sa main pour l’aider à se lever.
« Viens. »
« Pensez à lui faire faire des papiers d’identité. »
« Je m’en occupe. »
1.52 9
Elle le soutient jusqu’à un taxi en attente devant la porte du commissariat.
« Si j’avais su que vous récupériez un clochard, je ne serais pas resté » proteste le conducteur « laissez la vitre ouverte pour chasser les odeurs. »
La course n’est pas longue.
« J’ai vu de drôles de choses » grogne le chauffeur de taxi quand la jeune femme le paie « mais des jeunes nanas qui récupèrent des clochards pour les emmener chez elles, ça ne m’était pas encore arrivé » il crie en démarrant : « Pensez à le laver avant de vous en servir. Á moins que ce soit la crasse qui vous attire.»
Dunant regarde l’immeuble blanc vers lequel Brigitte l’aide à marcher.
« C’est vrai que tu ne sens pas très bon. Nous allons jeter tout ça à la poubelle. »
Il se tait en entrant dans l’appartement. Il est fatigué.
« As-tu faim ? Bien sûr, c’est une question idiote. Prends un bain. Je prépare le repas. Prends mon peignoir. Il doit être assez grand.»
Brigitte règle la température de l’eau qui coule dans la baignoire.
Dunant reste longtemps immobile.
Il a chaud. Il a soif.
Il boit l’eau chaude dans le creux de sa main.
Il entreprend enfin de se débarrasser du manteau, de la veste, de la chemise et du pantalon.
Il s’allonge dans la baignoire.
Ses muscles se dénouent douloureusement. Ses articulations sont traversées par des aiguilles. Il laisse glisser doucement sa tête sous la surface avant de se redresser en suffoquant et toussant.
Il reste assis.
« Le repas est prêt » crie Brigitte.
Il ne répond pas.
Elle découvre la tête posée sur le bord de la baignoire. La barbe grise et les cheveux collés rendent Henri méconnaissable.
« Je vais te laver la tête. Tu frotteras un peu le reste. »
La jeune femme savonne la barbe et les cheveux en frictionnant vigoureusement.
Le corps décharné et anguleux que les mains de Dunant découvrent lui paraît étranger.
« Rince-toi et viens manger » dit Brigitte en sortant de la salle de bains.
L’eau dégoutte derrière lui quand il entre dans la cuisine. Il s’assied et regarde la viande posée dans l’assiette.
Il n’a plus faim.
Il rêve.
Tout va s’arrêter. Il va se réveiller dans son trou.
« Brigitte ! C’est vrai ? Tu es revenue ? »
« Mange. Je te raconterai. Je te cherche depuis trois semaines. Je suis allée à l’hôtel que tu m’avais indiqué. Le patron m’a raconté l’histoire de la vieille folle. J’ai visité les hôpitaux. J’ai fouillé les gares. Des policiers se sont souvenus de ton nom. Je t’ai fait rechercher en disant que tu étais mon oncle. Ne t’inquiète pas. Il ne t’arrivera plus rien. Depuis une semaine j’ai trouvé un poste d’enseignante dans un centre de formation continue. Je viens de louer cet appartement. »
Elle lui sert de la purée qu’il mange lentement. Il boit beaucoup.
Installé au salon, Dunant semble apprécier le café.
« Raconte-moi… »
Il vient de s’endormir.
1.53 10
Elle l’allonge sur le canapé.
Quelle maigreur !
Malgré le bain, des traces suspectes apparaissent au milieu des griffures et des cicatrices.
Comment se peut-il ? En aussi peu de temps…
Si le corps a souffert, l’esprit doit être lui aussi en piteux état.
Comment sont ceux qui survivent ainsi depuis des années ?
Combien sombrent dans la folie et à se laissent mourir ?
Et leurs compatriotes poursuivent leur vie comme si ces pauvres n’existaient pas. Ils vont en vacances et au cinéma. Ils font des banquets et visitent les restaurants gastronomiques. Ils festoient à Noël et pour les anniversaires. Ils ne savent pas qu’ils sont eux-mêmes au bord d’un précipice qui les attend peut-être.
Elle somnole dans le fauteuil quand l’ouverture de la porte des toilettes la fait bondir.
Il vomit.
Elle l’accompagne dans la chambre. Il s’effondre sur le lit en tirant le drap sur sa tête, comme pour se cacher.
La jeune femme s’installe sur le canapé pour regarder la télévision avant de s’endormir.
Le bruit de la douche et de la cafetière ne réveillent pas Dunant.
Lorsque Brigitte entre dans la chambre, il est toujours sous le drap. Il semble ne pas avoir bougé depuis plus de quinze heures.
Sa respiration est paisible.
Elle laisse un mot : « mange. Bois. Fais ce que tu veux. Je serai là à midi. »
Quand il ouvre les yeux, Dunant ne comprend pas où il est.
Il ne bouge pas.
Le réveil indique neuf heures.
Brigitte.
Elle va lui dire de s’habiller et de partir.
Que peut-il attendre de plus ?
Il lit le mot posé sur la table.
Après avoir bu un grand bol de café dans lequel il a trempé du pain beurré, il reste à rêver, la tête posée sur ses mains.
Un claquement de porte le fait bondir.
On vient le chercher.
Il va être chassé.
Comme rien ne se passe il retourne dans la chambre et tire à nouveau le drap sur son visage. Il a chaud. C’est comme quand il revenait de l’école et qu’il se pelotonnait sous son édredon pour oublier les enfants qui s’étaient moqués du pauvre mal vêtu.
Toute sa vie il a eu besoin de se retirer quelques heures, parfois quelques jours, oubliant tout.
1.54 11
« Le déjeuner de Monsieur est servi. Si Monsieur veut bien venir à table. »
La voix joyeuse et le rire frais le rassurent.
Posant un survêtement gris sur le lit, elle dit : « c’est tout ce que j’ai osé choisir pour l’instant. Tu achèteras ce que tu souhaites pour tes sorties. »
« Mais je n’ai pas d’argent. »
« Moi j’en ai. J’ai ce que j’ai gagné à la Réunion. Comme mes parents veillent sur leur fille unique je ne manque de rien. Ce que tu portais était vraiment hors d’état. Je l’ai jeté. Tu me donneras ta pointure pour que je prenne une paire de chaussures. »
« Pourquoi fais-tu ça ? Tu ne me dois rien. »
« Oh ! Si ! Bien plus que tu ne penses. Grâce à nos conversations j’ai compris ce que devenait Francis. Le patron était si différent du jeune cuisinier que j’avais connu. J’ai surtout appris à me connaître. J’ai toujours eu besoin d’être utile. C’est sans doute la conséquence de ma vie d’enfant unique trop gâtée mais toujours seule. Allez ! Viens à table. »
La barbe et les cheveux longs ne parviennent pas à cacher son mauvais état général.
« J’ai demandé à un médecin de venir t’examiner. Tu as sûrement besoin de remontants. »
« Merci » dit-il en s’installant devant son assiette.
Elle n’ose pas l’interroger. Elle raconte son départ de l’Hôtel de l’Océan. Elle évoque Smet. Elle décrit ses recherches. Elle parle de son nouveau travail.
Il ne l’écoute pas. Il est reparti vers un ailleurs vide et cotonneux. Il voudrait retourner se coucher mais il ne veut pas la mécontenter de peur que le miracle ne se brise.
« Va t’allonger en attendant le médecin. »
Il se terre dans le lit.
Le médecin ? Pourquoi un médecin ? Il n’est pas malade.
Si c’était celui qu’il a fui sans payer ?
Si on décidait de l’hospitaliser ?
Il somnole sous son drap. Il a trop chaud dans son survêtement mais reste dans son abri jusqu’au moment où une main tire le drap. Un homme jeune lui sourit. « Ne craignez rien. Je veux simplement vous examiner. Déshabillez-vous. »
« Je ne suis pas malade. J’ai juste besoin de me reposer. »
« On va voir ça. »
Le médecin le soumet à un examen complet : le cœur bien sûr et les poumons, les réflexes et la tension, les yeux et les oreilles…
« Ce n’est pas brillant mais pas catastrophique. Votre tension est trop basse. Il faudra vous laver plus à fond. La crasse est une excellente réserve de microbes. Allez donc à la salle de bains. Je vais laisser l’ordonnance à votre fille. »
1.55 12
Il fait couler la douche. Il frictionne longuement son corps et le savonne encore et encore. Il se détend peu à peu appréciant ce bonheur retrouvé. L’eau chaude ! Quel luxe !
Un rasoir l’attend sur le lavabo. Ses mains tremblent. Il se coupe souvent. Le poil trop long résiste à la lame. Il ne reconnaît pas ce visage osseux ni ces yeux enfoncés dans les orbites.
Derrière la porte, Brigitte demande : « Ça va ? Tu te sens bien ? »
« Oui. Oui. Tout va bien. »
Il doit s’asseoir pour enfiler son pantalon.
Il se laisse tomber sur le lit.
« Tu vas prendre froid » dit la jeune femme qu’il n’a pas entendue entrer « mets ta veste et viens au salon. Nous allons acheter des vêtements. »
« Je n’ai pas d’argent. »
« Moi j’en ai. Tu me le rendras quand tu trouveras du travail. »
« Qui pourrait m’embaucher ? Je vais retourner dans la rue. »
Une larme qu’il ne sent pas descend sur sa joue.
« Reprends des forces et ta confiance reviendra. Tu sais faire tellement de choses. »
« Tu ne comprends pas. On me chasse partout…les coups…la police…depuis des semaines je trouve de quoi manger dans les poubelles…je dors dans des parkings ou des couloirs. Les chiens on les emmène à la fourrière et on les nourrit. Pas les hommes. »
« Tu resteras ici aussi longtemps que tu voudras. Tu me raconteras tout.»
Il se tait. Il veut profiter de ce répit. Après…après tout recommencera. Il le sait. La peur est toujours là qui lui noue l’estomac.
« Veux-tu que nous allions chercher des vêtements ? »
« Je suis bien comme ça. Je ne veux pas sortir. Dehors… »
Sa voix s’éteint.
« J’irai seule. Je vais t’acheter des sous-vêtements et des chaussures. Quelle est ta pointure ? »
« Quarante. Mais je n’ai besoin de rien. Je peux rester pieds nus. »
« Il faudra que tu marches. L’air te fera du bien. Veux-tu la télé pendant que je fais les courses ? »
Il ne répond pas. Brigitte lui place la télécommande dans la main avant de sortir.
Si elle veut qu’il ait des vêtements c’est pour qu’il reparte.
Elle va le chasser. Pourquoi s’occuperait-elle de lui ? Elle ne lui doit rien. Elle a sa vie.
1.56 13
Que faire pour qu’elle le garde ?
Comment lui dire ?
Il lave la vaisselle, nettoie la salle de bains et refait le lit avec soin.
Il pourrait faire le ménage et la cuisine. Il mangerait peu. Il coucherait dans le débarras qui prolonge le couloir. Personne ne le verrait.
Brigitte le trouve en train d’étaler des journaux sur le sol du placard.
« Qu’est-ce que tu fais ? »
« C’est pour dormir. Je n’ai pas besoin de lit. Tu pourrais me garder. Je m’occuperais du ménage et de la cuisine. Quand tes amis viendront je resterai là. »
La jeune femme lui prend la main et l’entraîne vers le fauteuil. Sans lâcher les doigts qui tremblent, elle s’assied face à lui.
« Tu partiras quand tu voudras. Je ne te chasserai pas. Tu dormiras dans la chambre, je préfère le divan du salon. Personne n’a besoin de moi. Mes amis ne sont pas parisiens. Ils ont construit des vies dont je ne fais plus partie.
Laisse-moi t’aider. C’est tout ce que je te demande.
Nous parlerons.
Je ne serai pas seule.
Tu feras ce que tu voudras. C’est vrai que tu cuisines mieux que moi.
J’ai sans doute plus besoin de toi que tu n’as besoin de moi.
Je ne sais pas vivre seule.
Il faut que je me sente utile. C’est sans doute ce qui m’avait conduit vers Francis.
Tu retrouveras l’envie de te battre et de réussir. Tu auras ton bar ou ta brasserie. Je viendrai manger chez toi. »
Il ne dit rien.
Il peut rester. C’est la seule chose qu’il retient.
Loin de la rue.
Au chaud.
« Regarde ce que j’ai acheté. Ce n’est pas très beau mais tu choisiras quand tu voudras. »
Elle étale sur le canapé la chemise et les chaussettes, les slips et le pull over.
« J’ai trouvé un imperméable. J’espère qu’il est à ta taille. Essaie les chaussures. »
Elle est à genoux sur la moquette pendant qu’il marche.
Hier il était moins qu’un animal, un déchet, et voilà qu’une femme s’agenouille pour lui mettre ses chaussures.
« Merci. Si tu savais… »
« Ne me remercie pas. J’ai tellement de plaisir à tout ce que je fais…je serai si heureuse quand tu seras redevenu toi-même. »
« Me retrouver…c’est impossible…je me suis perdu…complètement. »
« Ce n’est pas possible. Pas en si peu de temps. »
« Tout ça dure depuis un an. Les échecs et les coups. Les abandons et les rejets. Le froid. La faim. Les flics. Je croyais que mon enfance m’avait fait fort et je me retrouve aussi faible, plus même que lorsque j’étais petit. C’est à croire que le malheur est fait pour moi. »
Elle ne veut pas l’interrompre. Elle sait qu’il faut qu’il parle. Sa guérison est à ce prix.
1.57 14
Il s’arrête soudain, le regard vide. Il se laisse tomber dans le fauteuil.
Quand Brigitte revient après avoir préparé le repas, il dort tassé dans le siège.
Á la Réunion, malgré les coups et les échecs, il paraissait vivant. Le soleil effaçait les rides. Il a l’air beaucoup plus vieux et si fragile. Elle lui fera dire ses souffrances pour qu’il puisse revivre.
Elle se sent Pygmalion.
Il se disait dur et cynique et n’est qu’un enfant blessé.
Il ouvre les yeux, découvrant la soupière sur la table basse. L’appétissante vapeur qui se dégage confirme que tout est vrai.
« J’ai pensé qu’une soupe de légumes te ferait du bien ».
« J’en ai mangé un soir, dans la cour d’une gare. Les gens d’une association venaient chaque jour avec un petit camion s’occuper des SDF. C’était bon. Après, on se retrouvait seul. Les pauvres sont toujours seuls. C’est chacun pour soi. »
« Où dormais-tu ? »
« Dans le métro. Dans les salles d’attente des gares. On nous chassait. La police. Les gardiens. Les vigiles. Tous ceux qui protègent les bons citoyens contre les miséreux. Je trouvais parfois un couloir resté ouvert. Là aussi je me faisais jeter. Á coup de pied ou de balai. Comme un rat. J’ai trouvé un parking et j’y suis resté plusieurs semaines…je ne sais plus…c’est là que… »
Il frissonne et se tait. Ses yeux sont de nouveau perdus dans le vide.
« Je ne veux plus…c’est trop dur. »
« Ma soupe n’est pas bonne ? » demande Brigitte pour l’aider à quitter ses souvenirs trop lourds.
« Oh ! Si. C’est la meilleure…je ne me souvenais pas…je reviens d’un autre monde que je ne croyais plus quitter. »
« Mais tu étais libre ! »
« Il n’y avait pas de barreaux. Pas de porte. Enfin si, celles qui se fermaient, portes des maisons, des hôtels et des magasins. J’étais prisonnier de la rue. C’est pire qu’un camp. »
« Quand même pas. Les prisonniers connaissent des moments atroces. »
« Oui mais ils peuvent espérer qu’on pense à eux quelque part. Ils sont ensemble, nombreux à subir le même sort. Ils attendent une délivrance. Leurs bourreaux sont des monstres.
Il n’y a pas d’issue à la survie dans la rue. Pas de retour au pays. On n’est plus rien au milieu des nantis. Notre existence est niée par l’indifférence qui nous emprisonne. Pourquoi nous ? Pourquoi ne sommes-nous plus comme eux ? C’est notre faute.
1.58 21
Nous sommes les déjections du monde ordinaire. Des épouvantails rappelant à chacun qu’il pourrait nous rejoindre.
J’avais souffert déjà quand j’étais enfant… »
Il se tait. Enfermé dans sa souffrance.
Brigitte se rappelle les cours et les travaux pratiques de la fac, comme les stages dans les instituts et associations. Elle avait alors à faire à des enfants et des adolescents. Elle ne les connaissait pas.
C’est Henri.
Saura-t-elle l’aider ? Pourra-t-elle le rendre à la vie ordinaire ?
Réintégration. Réinsertion. On a su inventer des mots pour lesquels on a rarement les modes d’emploi. Comment revenir dans un monde qui rejette et piétine ?
Quelles sont les valeurs qui restent ? Quelles références ?
Pauvre dans un pays sous-développé, ce doit être terrible, mais on est entouré de gens vivant le même régime.
Ici, la vie continue pour tous. Pourquoi sont-ils rejetés ? Ils sont étiquetés comme incapables, mauvais, indignes de compassion.
Tout ce que la société a mis en place pour se protéger se retourne contre eux : les portes, les grilles et la police.
Ils savent tout de la surproduction et des appartements vides. Ils connaissent les lois protégeant les animaux.
Il leur reste les poubelles pour se nourrir et les trottoirs pour dormir.
Ils ne se rebellent pas. Enfoncés dans leur indignité.
Comment redevenir des hommes ?
La jeune femme se sent coupable. Elle n’a jamais rien fait pour éviter ces violences.
Elle votait pour ceux qui promettaient que plus personne ne serait sans domicile. Elle payait des impôts destinés à la protection des plus défavorisés. Elle confiait aux élus la charge de protéger le pays, d’entretenir les routes et les écoles…et… d’élection en élection, les mêmes revenaient, toujours soucieux de retrouver leur poste.
Brigitte se sent prête à s’engager pour que la solidarité joue, non pas celle des presque pauvres réunis dans des associations, mais aux côtés de ceux qui veulent changer ce système injuste.
L’urgence est de permettre à Henri de retrouver sa confiance.
« Veux-tu aller te coucher ? »
« Oui. Je vais dormir dans le placard. »
« Il n’en est pas question. La chambre est à toi. Aussi longtemps que tu le voudras. »
« Mais…je te gênerais moins…laisse-moi le divan… »
« C’est moi qui te gênerais par mes allées et venues. Par la télé et le téléphone. »
« Je dormais dans un parking ! Alors les bruits et les déplacements je suis habitué. »
« Tu dois oublier ces moments. Il faut que tu reprennes goût à la vie bourgeoise » dit-elle en riant.
« Et après ? Il faudra bien que je retrouve la rue. »
« Non ! Tu n’y retourneras pas ! Jamais ! »
Il va dans la chambre. Il ne veut plus discuter.
Il aurait préféré le placard. De cette manière il aurait pu rester sans gêner.
Bientôt elle ne supportera plus l’inconfort du divan. Il devra partir.
Il s’allonge sur le lit en tirant le drap sur lui.
Il ne dort pas.
Son esprit se vide.
1.59 22
Il fait à peine jour quand il entend les bruits de la cuisine et de la salle de bains.
Il ne bouge pas lorsque Brigitte entrouvre la porte de la chambre.
Seul.
Il veut rester seul dans ce lieu protecteur.
Si elle part, il aura quelques heures de sursis.
Le claquement du verrou de la porte d’entrée le rassure.
Il est bien.
Ça ne pourra pas durer.
Son petit déjeuner est prêt.
Aucun mot ne l’accompagne ce matin.
Ses vêtements sont posés sur le fauteuil, comme pour l’inviter à s’en aller.
Il ne veut pas sortir.
L’idée de se retrouver dans la rue lui coupe l’appétit.
Il retourne dans la chambre, ferme les volets et tire les rideaux avant de s’allonger sur le lit.
Quand Brigitte revient, elle voit les vêtements où elle les a laissés. Il n’a pas déjeuné. Il a dû sortir en survêtement. Mais non. Le verrou était fermé alors qu’il n’a pas la clé. Elle s’en veut de ne pas lui en avoir laissé une. C’est le meilleur moyen de le rassurer puisqu’il pourra revenir autant qu’il le voudra.
Elle est pourtant bien décidée à l’aider aussi longtemps qu’il le faudra. Son inconscient s’y refuserait-il ? Aurait-elle peur de cette aventure ?
Non ! Il s’agit d’un simple oubli. Stupide mais sans raison cachée.
« Bonjour Henri. »
Il n’a pas répondu quand elle a frappé, alors elle est entrée.
Il ouvre les yeux, esquissant un sourire.
« Bonjour ».
« Si tu veux venir manger, le repas est prêt. »
« Excuse-moi. Je voulais… je me suis rendormi… je préparerai les repas… »
« Tant pis pour toi. Tu devras te contenter de ce qu’a préparé la mauvaise cuisinière. »
« Je n’ai jamais été très exigeant. Faute de temps je mangeais ce qui me tombait sous la main. Alors maintenant…C’est tellement bien d’être au chaud. Ne t’inquiète pas. Ça ne se reproduira pas. Je m’occuperai de tout. »
La jeune femme raconte sa matinée avec ses élèves peu intéressés par l’enseignement théorique.
« Moi aussi j’ai été apprenti. En ce temps-là il n’y avait pas d’école d’apprentissage. On faisait nos devoirs dans nos rares temps libres. J’ai quand même eu mon CAP. Si j’avais eu de riches parents j’aurais pu faire des études. »
« Tu n’aimais pas ton travail ? »
« Je ne me posais pas la question. Le patron exigeait beaucoup. Comme je l’ai fait plus tard avec les apprentis. Il fallait éplucher les légumes, laver le sol, récurer les marmites…c’était peu intéressant. Quand j’ai commencé à cuisiner c’était mieux. Le service m’intéressait encore plus. On rencontre des gens, on parle… »
« Tu as des frères et des sœurs ? »
« Non. Je n’ai même jamais connu mon père. Ma mère n’a jamais voulu me dire. Elle a été chassée par ses parents quand elle a été enceinte. Elle est partie à Paris avec mon père. C’était un fils de riches. Il la maltraitait. Elle s’est sauvée. J’ai connu le métro quand j’étais tout petit. Et les centres d’hébergement. La rue aussi sans doute. C’est normal que j’y revienne. »
« Mais…tu m’avais dit…tu n’as pas toujours vécu à Paris ? »
« Nous sommes revenus dans sa ville quand mon grand-père est mort. Ma grand-mère est morte peu après. Ma mère faisait des ménages. Elle gagnait juste de quoi payer le loyer et un peu de nourriture. L’eau était dans la rue. J’allais remplir un seau à la nuit tombée pour que mes copains ne me voient pas.
J’étais le bâtard. Et pauvre en plus. C’est e travail qui m’a aidé à m’en sortir.
Me voilà revenu à la case départ.
Je me croyais tiré d’affaires. Définitivement. »
1.60 23
Il ne prend pas le temps de manger.
Pour une fois qu’on l’écoute, il doit parler.
« Je recevais tous les gens importants de la ville : les élus, les banquiers et les juges. J’en tutoyais beaucoup. Je les invitais. Je leur prêtais ma villa d’Arcachon. Je me croyais comme eux alors qu’ils profitaient de moi.
Lorsque ma femme est partie j’étais content. Enfin libre.
Quand le fisc s’en est mêlé, ils m’ont tous abandonné. »
« Il t’est bien resté quelques amis ? »
« Je pense que je n’en ai jamais eu. C’est quoi un ami ? Je ne m’intéressais qu’aux puissants.
Je leur prêtais même mon appartement pour leurs rencontres.
Tous m’ont laissé tomber comme s’ils ne me connaissaient pas.
Alors j’ai bu.
J’ai retrouvé ceux de mon vrai milieu : les pauvres, les exploités, les méprisés.
Et je suis venu à la Réunion pensant que Francis me tirerait de là.
Cesse-t-on un jour d’être seul ? »
« Moi j’ai toujours été choyée. Trop peut-être. Mes parents ne voyaient que par moi. Mais j’étais seule aussi puisque fille unique. J’aurais tant voulu avoir un grand frère. »
« Que diraient tes parents s’ils me trouvaient là ? »
«ll y a longtemps qu’ils ne me font plus de remarques. Ils sont toujours prêts à m’aider, mais je pense qu’ils sont mieux depuis que je suis partie. Ils voyagent. Ils veillent sur leurs rosiers. Ils se promènent. Papa joue au bridge. Maman boit le thé avec ses amies. Ils m’envoient de l’argent et me font des cadeaux. Ils ont même renoncé à devenir grands-parents. »
« Et Francis ? »
« Ah ! Francis ! C’était mon premier amour. Celui de mes quatorze ans. Nous étions dans le même club de natation. Il a travaillé très tôt. Je l’aidais à faire ses devoirs d’apprenti. Je payais nos entées au cinéma. J’apportais la tente et la nourriture pour les vacances. Je lui étais utile.
Et puis…
Tu connais la suite. Il n’a pas besoin de moi. Il n’a besoin de personne. Seuls comptent les clients et leur argent.
Maintenant je peux parler. Parler à quelqu’un qui nous écoute c’est exister vraiment. On apprend à mieux se connaître soi-même.
J’ai autant besoin de toi que toi de moi. »
Ils font la vaisselle ensemble et Brigitte dit : « nous allons à la mairie pour tes papiers. »
« Puisque je ne sors pas je n’en ai pas besoin. »
« Je t’accompagnerai. Habille-toi. Nous partons dans dix minutes. »
Dunant se douche et se rase. Il retarde autant qu’il peut le moment de sortir.
1.61 25
Il se résout enfin à rejoindre Brigitte.
« Personne ne te reconnaîtra. Tu es un autre homme. »
« Celui qui est dans ma tête est très sale et barbu. Il se cache. Tout le monde le maltraite. »
Soutenu par le bras de la jeune femme, Dunant marche dans la rue. Il rase les murs et s’efface pour laisser passer ceux qui arrivent.
Brigitte lui tend une pièce d’un euro quand ils trouvent un mendiant assis sur le trottoir.
« Non. Toi. Donne-lui. »
Les yeux fixés devant lui, l’homme ne remercie même pas.
Á la mairie, c’est Brigitte qui répond à la plupart des questions.
« Nous vivons ensemble » dit-elle plusieurs fois.
Il a un toit et quelqu’un le protège. Lui qui n’existait que pour la police réintègre le monde ordinaire.
« Rentrons. Je suis fatigué. »
« Nous allons prendre un taxi. »
« Non. Je peux marcher. Un clochard ça marche tout le temps. »
« Regarde » dit-elle en s’arrêtant devant le miroir d’un magasin « tu n’es pas un clochard. »
Il ne lève même pas les yeux sur cette image qui n’est qu’un reflet de ce qu’il n’est pas.
« On dirait que tu as vingt ans » s’étonne-t-il en admirant le visage de Brigitte rosi par le froid.
Elle rit : « merci. Mais je me demande si tu n’as pas besoin de lunettes. J’en ai presque dix de plus. Même si les années de fac usent moins que celles que tu as connues, j’ai quand même vécu. J’ai appris. Dans les livres et auprès des gens. J’ai travaillé avec des handicapés. J’ai eu quelques…copains. Je ne me sens pas vieille, mais loin de mes vingt ans. »
Comme ils arrivent devant la porte de l’appartement, la jeune femme tend une clé : « tiens. C’est la tienne. J’avais oublié de te la donner. Tu es chez toi. Tu entres et tu sors quand tu veux. »
Elle ouvre un tiroir : « L’argent est dans cette boîte. Tu prends ce qui t’est nécessaire. Ne te gêne pas. Je n’en manque pas. »
« Mais c’est à toi ! »
« Je me souviens de ma grand-mère qui avait toujours vécu à la campagne. Elle ne voulait pas de congélateur. Quand elle avait trop de haricots verts ou de poulets, elle en donnait à ses voisins. –Á quoi bon conserver- disait-elle- c’est meilleur quand c’est frais. Ses voisins lui donnaient aussi ce qu’ils avaient en trop. Pourquoi veux-tu que je garde l’argent ? Mes parents ont deux maisons. J’ai un salaire. J’aurai une retraite. Je ne m’intéresse pas aux actions, obligations et autres placements insensés. »
Il serre la clé dans sa main.
Elle est l’assurance d’un abri.
1.62 26
Sylvie tend une flûte de champagne à Dunant qui revient dans son survêtement. Il s’excuse : « je me sens plus à l’aise ».
« Á la fin des mauvais jours ! Á l’avenir heureux ! » dit la jeune femme qui se sent soudain attirée, pas seulement par le malheureux qu’elle aide à se reconstruire, mais par l’homme.
Elle ne veut pas qu’il parte.
Il boit en fermant les yeux. Son visage se détend.
« Á nous deux ! » reprend-elle.
Il lui sourit. « Je te dois la vie. Je serai comme ton chien si tu veux me garder. »
Elle s’assied près de lui et caresse sa main.
Comme il laisse tomber son verre, tous deux se penchent. L’arcade de Dunant heurte le front de la jeune femme.
Brigitte court à la salle de bains pour soigner la petite coupure d’où perle une goutte de sang. Elle pose ses lèvres sur la joue en murmurant : « c’est guéri. »
Ses lèvres glissent jusqu’à celles de Dunant qui n’ose bouger.
Leur baiser les emporte. Ils font l’amour sur le divan sans même se dévêtir.
Elle caresse le visage qui se durcit soudain. Il souffle : « tu ne m’en veux pas ? Je ne recommencerai plus. »
« J’espère bien que si. C’était plutôt bien. Aurais-tu souffert de ce moment ? »
« Non. Mais je ne veux pas t’imposer… »
Le rire de la jeune femme tinte : « tu as eu l’impression de m’imposer quoi que ce soit ? Je pense que c’est plutôt moi qui ne t’ai laissé aucune chance. »
Elle se dévêt, ôte la veste et le pantalon de Dunant et l’entraîne vers la chambre. « Après tout, j’aime autant le lit. Il est trop grand pour toi tout seul. »
Le désir les emporte à nouveau.
Il fait nuit depuis longtemps.
Á la lumière qui vient de la rue, la jeune femme observe l’homme qui dort paisiblement. Ses sourcils se froncent soudain. Un gémissement transforme le visage qui exprime la peur et la souffrance.
Elle le caresse doucement. Il se détend. Sa respiration se calme.
Il a besoin d’elle. Plus que tous ceux qu’elle a connus. Sans elle il est perdu.
Elle lui donne la vie.
Comme à un enfant. L’enfant qu’elle n’aura jamais comme l’ont affirmé les gynécologues. Elle était de toutes façons trop sensible pour être mère. Elle évitera les nuits blanches et toutes les angoisses, les départs renouvelés et les multiples arrachements.
Elle est libre.
Libre de se donner et se reprendre.
D’aider puis repartir.
1.63 27
Après s’être douchée elle prépare un plateau. Quand elle entre dans la chambre, Dunant s’assied brusquement, l’air hagard. Il crie : « non ! »
« Tu vas bien. Tu es chez toi. Je t’apporte de quoi te restaurer. Après tous ces efforts ! »
« Je faisais un cauchemar. Je tombais dans un puits… »
« Te voilà dans ton lit. Tout va bien. Il est quatre heures et nous n’avons rien mangé depuis hier midi. Le temps a passé si vite. »
« Je n’aurais jamais espéré…tu ne regrettes pas ? »
« J’ai l’air malheureuse ? C’était bien. Pour moi ça n’a jamais été l’essentiel dans mes relations…mais je vais peut-être changer d’avis. »
Ôtant sa chemise, elle se glisse près de lui.
« Je me cache pour éviter les critiques. »
« Comment veux-tu ? Je ne comprends toujours pas. Tu es jeune. Tu es belle. Tu es riche. Et tu m’acceptes, moi qui ne suis qu’une épave, un raté, un minable. »
« C’est tout ? Tu n’as pas dit combien je suis intelligente, et forte, et douce, et…et…enfin une femme extraordinaire. Mais je suis aussi affamée. Tu vas me laisser manger seule ? »
« J’ai faim. J’ai soif. Je suis vivant. J’ai peur de rêver. Peur que tout s’arrête. Peur que tu me voies comme je suis. Que tu te lasses vite. Que tu me chasses. Peur de retrouver la rue et le froid. La faim et la violence. »
La main de Brigitte parcourt le dos qui se détend peu à peu. Les muscles se dénouent sous ses doigts.
« Mange. Je suis là. Je resterai tant que tu le voudras. Tant que tu auras besoin de moi. »
Elle l’embrasse doucement.
Ce n’est pas un baiser violent qui emporte tout comme ceux de la nuit. Celui-là est doux. Réconfortant. Amical et maternel.
Ils se font manger et boire comme des adolescents amoureux.
En silence.
Seuls leurs yeux et leur peau gardent le contact.
« Les miracles existent » dit-il « un cadeau inespéré qui m’arrache à cette mort lente. »
« Cadeau ! Il ne faut pas exagérer. C’est bien parce que la lumière est faible que tu dis ça. »
« Garde-moi » reprend-il « je serai ton cuisinier, ton homme à tout faire…
« D’accord. Dans tout il y a aussi l’amour. C’est un amant que je veux. Un ami aussi. Pour le ménage je peux me débrouiller seule, mais parler seule, et dormir au milieu de ce grand lit…Moi aussi j’ai besoin de toi. De tes bras, de… »
Elle l’embrasse et ils se trouvent à nouveau emportés, s’accrochant l’un à l’autre, se fondant l’un dans l’autre…vivants.
C’est lui qui ouvre les yeux le premier.
Le soleil éclaire le lit en désordre.
Il regarde Brigitte endormie sur son bras qu’il n’ose retirer. Ce visage bronzé semble à peine sorti de l’adolescence. Quelques rides pourtant, et même un cheveu blanc, prouvent que la vie fait son chemin.
L’aime-t-il ?
Elle est sa maison et son pain, l’air et l’eau qui le font vivre…c’est tellement plus qu’un amour ordinaire. Elle lui est aussi indispensable qu’une mère pour le bébé accroché à son sein.
Elle est sa vie. Il ne doit pas la perdre. Il fera tout pour qu’elle le garde.
Il ne reviendra pas à la rue.
Jamais !
1.64 30
Elle le regarde en souriant.
« Á quoi pensais-tu avec cet air sérieux ? »
« Á toi. Á moi. Á nous. Á la chance que j’ai. Á ces journées de rêve. Beaucoup de gens s’éveillent sans apprécier la chance qu’ils ont d’avoir un lit et du pain. De ne pas être seuls. »
Nous devrons nous le rappeler chaque matin, chaque soir, à tous les instants. Ne jamais oublier. »
« « Pour moi je sais que je me le dirai. Peut-être, toi…bientôt…un autre plus beau et plus jeune… »
« Je ne rêve d’aucun prince. Ni de yacht, ni de palais. J’ai tout ce que je voulais. Le prince irait par monts et par vaux chercher des princesses. Son temps appartiendrait aux autres. Je préfère un homme prêt à partager toutes ses heures avec moi. »
« Alors tu as fait le bon choix. Je serai près de toi. Toujours. Je ne veux plus jamais être seul. »
Aucun moment de la journée ne les sépare. Ils se regardent et se parlent. Comme si les yeux et les oreilles ne suffisaient pas ils se touchent souvent pour que leur peau confirme la présence.
« Nous devrons consacrer chaque jour un moment à nous caresser » dit Brigitte « c’est le meilleur moyen d’apaiser les craintes et même chasser les maladies. On prouve ainsi qu’on est deux. »
« Parler. Parler pour ne plus être seul. Si tu savais… »
« Tout se dire. Tout comprendre. Tout savoir l’un de l’autre. Connaître ses souvenirs comme ses pensées, ses désirs comme ses espoirs. »
Alors qu’il somnole, la tête posée sur les genoux de la jeune femme, elle allume la télé. Il ouvre de temps en temps un œil, comme pour vérifier qu’elle est bien là.
« Si nous allions dormir » dit Brigitte, lors d’un des réveils.
« C’est vrai que tu travailles demain. La télé est faite pour les oisifs et les solitaires. Je n’ai jamais suivi les programmes du soir puisque j’étais avec mes clients. »
« Tu aurais pu enregistrer ce que tu aimais pour le voir le matin. »
« Le matin je faisais les achats, je rangeais, je préparais le déjeuner, je servais les lève-tôt. En fait je n’avais jamais de temps libre. »
Ils se couchent et se serrent l’un contre l’autre déclenchant à nouveau une vague qui les emporte et les bouleverse. Le sommeil les prend dans les bras l’un de l’autre.
Quand Dunant s’éveille, il fait grand jour. Brigitte est partie sans qu’il l’entende.
Les évènements de la veille lui reviennent doucement. Ils défilent derrière ses yeux clos.
Il se lève brusquement pour fouiller ses poches. La clé est bien là.
Il est à l’abri.
Tant que Brigitte le voudra.
Á l’abri et au chaud.
Il ferme les yeux pour mieux savourer ce bonheur.
Il doit tout faire pour rester.
Il sera le compagnon rêvé. Disponible et attentionné.
Dès qu’il a déjeuné et fait sa toilette, il commence à mettre de l’ordre et nettoyer l’appartement.
Il faut qu’elle soit heureuse de rentrer.
Il prépare le repas, gardant même le temps de confectionner la tarte aux pommes qui était sa spécialité.
Quand la porte s’ouvre, la table est mise. Brigitte se jette dans ses bras : « Je n’ai plus rien à faire. Quand je pense à toutes ces femmes harassées qui reviennent pour se lancer dans la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage…sans compter les rougeoles et les devoirs des enfants ! J’ai bien de la chance. Je vais en profiter tant que tu ne te seras pas remis dans la folie du travail.»
Il est rassuré.
Ils dressent ensemble la liste de courses qu’il fera l’après-midi. Aujourd’hui elle travaille quatre heures le matin et trois l’après-midi.
« Nous pourrions aller ensemble au magasin quand tu rentreras » dit Dunant.
« Les magasins sont tout près. Tu auras le temps. »
« Ce n’est pas le temps. Mais je n’ai pas très envie de me retrouver seul dans la rue. »
La jeune femme ne répond pas. Elle est certaine qu’il doit surmonter ses craintes. Il faut qu’il retrouve sa confiance en lui.
Elle dépose une liasse de billets sur la table du salon : « il y a cent cinquante euros. Si tu penses à autre chose achète-le. »
Comme quand elle était seule, elle verrouille la porte en partant.
Le bruit de la clé qui tourne le réconforte. Il est dans son repaire. Loin du monde. Mais si elle ferme c’est qu’elle a déjà oublié sa présence. Il occupe bien peu de place dans sa vie pour que le travail permette à Brigitte de l’effacer si vite.
Il doit se rendre indispensable. Malgré son angoisse il ira faire les courses.
Il reste longtemps devant la porte qu’il vient d’ouvrir, écoutant les bruits de l’immeuble. Pour ne pas prendre l’ascenseur avec un inconnu qui lui poserait des questions, il descend l’escalier.
Le voilà dans la rue.
Il transpire malgré la fraîcheur de l’après-midi. Sa main moite serre les billets dans sa poche. Cet argent confirme son nouveau statut. Il n’est plus un mendiant.
S’efforçant de relever la tête, il respire violemment. Dès qu’on le croise, il s’arrête et s’efface contre le mur. Que le marcheur soit un enfant, un vieux ou un adolescent.
Il passe plusieurs fois devant le supermarché sans oser entrer. Les vigiles le regardent sûrement. Rencontrant son image de français moyen dans une vitrine, il se persuade que personne ne peut voir en lui un mendiant.
Pendant plus d’une heure il parcourt les rayons. Faire la queue à la caisse est encore une épreuve. Il emplit les deux sacs que lui tend la caissière. Elle le rappelle : « monsieur ! Monsieur ! » Il est soudain glacé. Ça recommence. Il renonce à s’enfuir en voyant le vigile dans l’entrée.
« Votre monnaie » dit la jeune femme en lui tendant sa main emplie de pièces.
C’était ça. Simplement. Il présente sa main tremblante : « merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. »
Il avance vite pour retrouver la sécurité de l’appartement.
La porte de la rue est fermée.
Il ne connaît pas le code. Il est figé par l’angoisse.
Que va-t-il devenir ?
Il ne sait plus à quelle heure revient Brigitte. Il ne sait même pas l’heure qu’il est.
Le temps s’est arrêté.
La porte s’ouvre plusieurs fois, poussée par des gens qui entrent ou sortent. Il n’ose pas en profiter de peur de se faire rejeter.
Brigitte le découvre adossé au mur quand elle sort du métro. Son visage est comme mort. Ses yeux perdus dans le vide ne voient rien. Ses bras pendent les mains serrées sur les sacs.
Comme il a dû souffrir.
Elle s’en veut de l’avoir contraint à sortir.
Il est trop tôt.
Á quoi bon le bousculer ?
La jeune femme prend les sacs en disant : « viens ».
Il dit son incapacité à ouvrir la porte puisqu’il ne connaissait pas le code.
Dès qu’ils entrent dans l’appartement, il se laisse tomber dans le fauteuil, sans même ôter son imperméable.
Quand elle lui tend le bol d’infusion, il dit : « je ne pouvais pas entrer. J’ai cru que tout recommençait. »
Après lui avoir retiré son imperméable, elle s’assied contre lui.
« Rien ne recommencera jamais. Nous sommes ensemble. »
Il se lève pour gagner la chambre.
Elle se promet de mieux veiller sur lui. La misère et la peur sont des maladies dont on ne guérit pas vite.
Dehors est le danger.
Il ne sortira que s’il le veut. Quand il se sentira prêt.
Elle dîne seule en suivant le programme télé d’un œil distrait. Elle a préféré le laisser seul quand elle l’a aperçu dans sa position en chien de fusil la tête sous le drap. C’est la position fœtale de ceux qui souffrent et veulent se protéger.
Dunant suit tous les bruits. De la cuisine à la salle d’eau. Quand le canapé s’ouvre il sait qu’il sera seul.
Il aurait dû faire un effort.
C’est la fin de la belle histoire.
Il s’agissait juste d’une expérience pour la psychologue.
Il aurait dû la faire rire de sa mésaventure.
Ses angoisses le poursuivent dans le sommeil.
Brigitte vient quand elle l’entend geindre et parfois même crier.
Quand la jeune femme apporte le plateau du petit déjeuner, une larme coule sur la joue de Dunant : « tu veux bien me garder quelques jours encore ? Je ferai attention. Je t’aiderai. »
Elle l’embrasse doucement.
Cette faiblesse le rend attirant.
Il a tellement besoin d’elle.
Elle se glisse dans le lit et l’aide à retirer la chemise et le slip qu’il avait gardés. Ses caresses agissent vite et ils se retrouvent dans cet acte qui devient un remède contre la peur.
« J’ai faim » dit-il soudain en prenant le plateau resté près du lit.
Brigitte le voit revivre une fois encore.
Il ne peut vivre sans elle.
Elle caresse le visage de l’homme qui vient de s’allonger contre elle. Sa respiration se calme. Il s’endort en tenant la main de la jeune femme, comme un enfant craintif ou un grand malade. Il est un peu les deux.
Elle pense à tous ceux qui ne surmonteront jamais ces épreuves. Assommés par la peur. Usés par le froid, les coups et le manque de nourriture. Broyés parce que trop faibles, trop sensibles, victimes des coups du sort.
Elle travaille pour des institutions de handicapés pendant que d’autres sont abandonnés par la société irrationnelle, alors qu’ils avaient tout pour vivre.
Comment se fait-il que les rues ne se transforment pas en coupe-gorges? Ne se décideront-ils pas un jour à se venger ?
Faudra-t-il alors les enfermer ou les détruire ?
Elle sent monter en elle une envie de se battre contre les notables et tous ceux qui profitent toujours plus en écrasant les pauvres rejetés après avoir été exploités. Elle se sent complice pour accepter les miettes qui la font échapper à ces sorts misérables ;
La solidarité devrait s’imposer. Celle dont les élus parlent en s’appropriant toujours plus pour eux-mêmes.
Elle finit par s’endormir.
Dunant ouvre les yeux alors que le soleil est déjà haut.
Brigitte n’est pas allée travailler.
Il n’a pas osé demander son emploi du temps. Les horaires de travail d’un enseignant n’ont pas grand-chose à voir avec ceux d’un patron de brasserie. Lui travaillait tôt le matin jusqu’à une heure avancée de la nuit, sept jours sur sept. Il gagnait de l’argent, bien sûr, mais sa vie entière était consacrée à cet unique but.
« Á quoi penses-tu ? » demande la jeune femme.
« Au travail. Depuis l’âge de quinze ans je n’avais jamais arrêté. Comme apprenti, puis comme cuisinier, serveur, gérant ou patron. Toujours plus de temps de présence. Je me demandais pourquoi j’avais mené cette vie. »
« C’était ta vie. Tu aimais cet ensemble. »
« Oui. Dans ces métiers-là on ne peut faire autrement. Pour bien des gens, un bar c’est mieux que leur domicile. On parle des habitués. Changer leurs habitudes un jour par semaine, c’est risquer de les perdre. Ils trouveraient peut-être ailleurs une oreille et un peu de chaleur humaine. »
« Certains bars ferment de temps en temps. »
« C’est qu’ils sont liés à un secteur d’emploi : cité administrative ou usine. Lorsqu’on s’installe en centre ville on sert de lieu d ‘accueil permanent. »
« C’était le métier que tu avais choisi. »
« Je ne sais faire que ça. Loin de ma brasserie je m’ennuyais. Comme un drogué, il fallait que je revienne vite. Mes amis venaient m’y retrouver. Le tiroir caisse était à moi.
Tout ça pour arriver à la rue !
Toi tu es sûre de garder ton travail jusqu’à la retraite. »
« Pas vraiment. J’ai un contrat pour un an. Ce n’est pas l’Éducation Nationale. C’est un institut de formation professionnelle qui m’emploie. Ses ressources peuvent diminuer. Je me retrouverai au chômage.
Je travaille moins que tu ne le faisais, mais chaque heure de présence m’impose au moins deux heures de préparation. »
« Que tu peux faire chez toi quand tu le veux. » Il ajoute rapidement « je ne veux pas te contrarier »
« Tu ne me contraries pas. Je n’attends aucune agression de ta part. »
« Je veux te protéger. Laisse-moi retrouver mon équilibre. »
« Je suis heureuse que tu sois là. Veux-tu m’aider à préparer le repas ? »
Ils s’affairent côte à côte, et c’est lui qui prend la direction des opérations.
« Passe-moi une poêle !
Hache les oignons !
Rince la casserole. »
Ses gestes sont précis. Son regard est attentif.
Brigitte comprend que seul le travail lui rendra son équilibre. Seule l’efficacité compte.
Lorsque le repas est prêt, il tombe sur le tabouret.
« J’espère que je ne t’ai pas bousculée ? Dès que je cuisine je suis obligé d’aller vite. Je suis loin d’avoir retrouvé ma forme des grands jours. »
« Dans une cuisine il faut un chef. Comme pour un orchestre. Laisse-moi m’occuper du service. »
Elle prépare la table comme pour une fête. Lorsqu’elle apporte une bouteille de champagne elle dit : « c’est toi qui l’ouvre. Je n’ai jamais su le faire. Et pourtant c’est ma boisson préférée. »
La première flûte fait briller les yeux de Dunant. Ses pommettes ont rosi. Sa voix prend de l’assurance. Il emplit à nouveau les verres, puis avale le contenu du sien d’un seul trait.
Il mange peu et parle des soirées exceptionnelles qu’il organisait à l’occasion de la venue d’artistes renommés. Les personnalités se pressaient chez lui avec des jeunes filles et des sportifs qu’il invitait. Il refusait des clients.
« Je gagnais beaucoup ces soirs là. Mais ce n’était pas l’essentiel. L’image de la brasserie se trouvait valorisée. J’en sortais épuisé mais toujours très heureux. Je donnais du bonheur. »
« Était-ce du bonheur ? »
« Ils oubliaient leurs soucis. Ils riaient. Ils chantaient. »
« L’alcool les aidait aussi à chasser le quotidien. »
« Bien sûr qu’ils buvaient. Comme nous ce soir. L’alcool fait souvent voir la vie en rose. »
« Comme toutes les drogues. »
« Tu fais partie d’une ligue ? C’est pourtant toi qui as apporté la bouteille. »
« Chacun est libre de faire ou détruire sa vie. Le problème avec tous ces euphorisants, c’est qu’on est souvent plus mal après leur usage. »
« La vie est comme ça. Faite de temps forts et de temps faibles. Avec des hauts et des bas. Sauf lorsqu’on est au fond du trou, sans pouvoir remonter. »
Le visage de Dunant s’assombrit.
Brigitte lève sa flûte : « Á nous deux ! Au bonheur ! »
L’alcool n’agit plus. Dunant boit ce qui reste comme si c’était de l’eau. Il mange sans prêter attention à la qualité du repas malgré les compliments de Brigitte.
Il s’endort dans le fauteuil sans boire le café.
La jeune femme observe le visage qui ne parvient pas à se détendre.
Elle le guérira. Elle le veut. Elle y mettra le temps nécessaire.
Le bruit de la vaisselle arrache Dunant à son sommeil. Il ne bouge pas et se reproche son inertie. Il devrait l’aider pour ne pas la lasser trop vite.
Il referme les yeux en entendant Brigitte revenir. Il prend la main de la jeune femme lorsqu’elle s’assied près de lui.
« Je me suis endormi. Tu m’en veux ? »
Il se lève : « pour me faire pardonner, je vais laver la vaisselle. »
« Trop tard ! C’est fini. »
« Excuse-moi. Je regrette… »
« J’étais très contente que tu te reposes. Ton travail c’est de retrouver ton goût de vivre et de te battre. Je ne veux qu’une chose : t’aider à redevenir toi-même. »
« Moi ? Je ne sais plus qui c’est. Le mendiant ? Le plongeur de la Réunion ? L’enfant pauvre ? Le commerçant qui avait pignon sur rue ? C’est toi la psychologue. C’est à toi de me dire qui je suis. Mieux même : tu dois me dire qui tu veux que je sois. »
« Je sais qu’on ne peut pas changer fondamentalement. L’environnement nous force à nous adapter, révélant des faces cachées, misérables ou héroïques. Ce n’est pas Hitler qui a transformé de braves gens en bourreaux, ni Pétain qui a créé les délateurs et les lâches. Les tortionnaires de la guerre d’Algérie ne sont pas nés là-bas. Chacun a utilisé les circonstances pour laisser monter la boue qui était en lui. D’autres ont résisté, refusant de devenir inhumains. Les mêmes causes n’ont pas les mêmes effets sur tous. »
« Alors, si j’ai sombré dans la rue, c’est que je suis un minable. »
« Tu n’as pas sombré. Tu as fait comme le passager tombé du bateau. Tu as nagé. Tu as fait face aux tempêtes et aux blessures. Tu t’es accroché aux planches qui flottaient. Tu as survécu. Il fallait du courage. Tu es le même. Plus fort même qu’avant. »
Oh ! Le courage ! La force ! Je n’étais qu’une loque. Je me cachais et je mangeais les déchets des autres. »
« Tu vivais. Tu laissais passer l’orage. »
« Oui. Que suis-je maintenant ? »
« Repose-toi. Laisse ton corps reprendre des forces et ton esprit s’apaiser. Tu feras ensuite ce qui te conviendra. »
« L’attente risque d’être longue. »
« Nous avons toute la vie devant nous. Profitons de tous les instants. »
« Tu dis ça aujourd’hui, mais quand tu retrouveras tes parents, tes amis…. »
« Mes amis sont dispersés, menant des vies où je n’ai plus de place. Mes parents viennent ce soir. Tu vas les connaître. »
« Oh ! Non ! Je ne peux pas. Ils vont me jeter dehors. »
Elle rit en lui prenant la main : « nous sommes chez nous. Personne ne te jettera jamais de chez nous. »
« Tu m’as dit qu’ils t’aidaient, qu’ils payaient… »
« Oui. Mais ils ne m’achètent pas. Ils aiment leur indépendance et respectent la mienne. J’ai toujours été libre… »
« Un pauvre type comme moi ! Une loque ! Un minable ! »
« C’est tout ? Je leur ai parlé de toi. Ils connaissent les grandes lignes de ton parcours. Ils savent que je t’aime. Ils te respecteront. »
« Ce sont tes parents. Ils ont des ambitions pour toi. »
« J’espère qu’ils n’ont que mon bonheur comme ambition. Ils ont toujours compris ma manière de vivre. Ils acceptent mes choix. »
« Pourquoi viennent-ils si tôt ? Excuse-moi. Je dis n’importe quoi. »
« Tu dis ce que tu veux. Nous ne devons rien nous cacher. Je comprends tes craintes. Si nous ne pouvions affronter ensemble un moment comme celui-là, nous n’aurions pas grand-chose à espérer. Si nous le voulons, rien ni personne ne nous séparera. »
J’ai besoin de toi. Plus que tu n’as besoin de moi.
Ils viennent nous donner leur ancienne voiture. Ils viennent d’en acheter une neuve. Nous serons plus indépendants. Nous n’aurons même plus à prendre le bus ou le métro. »
« Il faut que je me rase et que je m’habille. Tu ne dois pas avoir honte… »
« Quel drôle de mot ! Il ne peut exister entre nous. Je t’ai dit que je t’aimais. »
« Pardonne-moi. J’ai tellement de mal à croire… »
Dunant se douche et se rase avec soin. Il est sûr que cette rencontre sera difficile. Ils vont l’observer. Le questionner. Il va perdre ses moyens.
Ses mains tremblent.
Il reste immobile devant ses vêtements.
Fuir.
Se cacher.