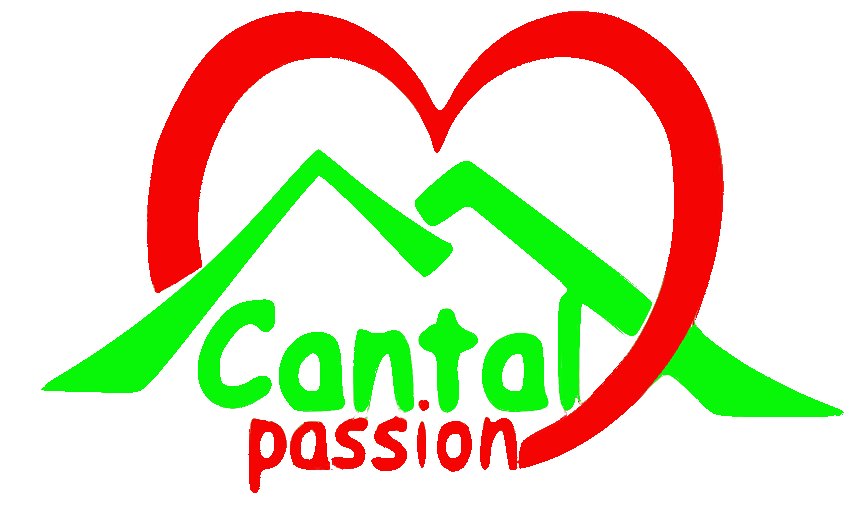Ces pages ayant été numérisées nous ne pouvons garantir une fidélité exacte à 100% du texte malgré le soin apporté à sa correction.
Naucelles.
— La commune de Naucelles, comprise dans le canton sud d'Aurillac, est bornée au nord par celle de Reilhac; au midi par celle d'Ytrac; à l'est par celle d'Aurillac; et à l'ouest par la rivière d'Authre qui l'arrose, ainsi que les ruisseaux de Reilhaguet, de la Réginie et de Veyrières. La surface de son territoire se compose de 947 hectares, dont 457 en terres labourables généralement sur calcaire, et d'un produit remarquable ; 430 en pâturages,' estimés quoique un peu marécageux ; enfin de quelques bois de faible importance.
HISTOIRE.
La seigneurie de Naucelles appartenait à saint Géraud, le glorieux fondateur, au X° siècle, de la première commune en Auvergne.
D'entrée de cause, je prie donc le lecteur de me permettre de lui dire quelques mots très-succincts, sur la formation des communes en général, et sur celle d'Aurillac en particulier, afin d'arriver logiquement ensuite à l'origine probable des communes rurales de notre pays. Cette question ne me parait pas encore avoir été examinée. Les communes, on le sait, sont un démembrement de la puissance féodale. Dès le début, la féodalité pour bien s'implanter, se montra douce. Peut-être fut-elle acceptée sans peine pendant les deux premières races, car elle faisait cesser l'antagonisme romain, persistant à lutter contre l'élément germanique, et déchirant la Gaule, de la fin du V° au LX° siècle. Qui sait même si elle ne satisfaisait' pas jusqu'à un certain point les idées de l'époque sur les attributions de la puissance souveraine, et sur les droits, tels qu'on les concevait alors, de la famille et de la propriété. Comme les Francs, maîtres du sol, s'étaient établis de préférence au milieu de leurs terres, cette importante innovation changea la prépondérance sociale, qui des villes passa aux campagnes. Bientôt autour des châteaux, centres que le système féodal avait créés, vinrent s'abriter une multitude sans défense, des peuplades sans patrie. Le principe de la servitude se trouva modifié dans quelques points essentiels, parce que les hommes, au lieu d'être attachés à la personne du maître, ne le furent plus qu'à la terre. L'esclavage antique se transformait donc en servage, c'était déjà beaucoup : on faisait un pas vers la liberté. Alors sans doute, la féodalité eut pour quelque temps un germe d'avenir; alors, quoique continuant à blesser la dignité humaine, rachetat-elle ce vice par une autorité calme et tutélaire. Alors, je le crois, elle eut sa raison d'être, et se substitua, non en usurpatrice comme on l'a dit si souvent, mais en reine consentie, à une organisation reconnue insuffisante, à une société morcelée et jamais en repos.
Mais la féodalité qui avait été utile pendant tout un siècle, une l'ois assise et solidement établie, devint oppressive. Fière d'une part, d'avoir porté Hugues Capet sur le trône, et fait d'un des siens un roi à son image, elle en profita pour accroître sa domination aux dépens de la couronne royale chancelante encore; tandis que de l'autre, elle se montrait avide et cruelle envers ses vassaux. Le régime féodal devait donc avoir contre lui ces deux forces, le jour où ces deux forces pourraient se montrer. Cela ne manqua pas.
Le force des serfs ne se créa que lentement. Pendant tout le XI° siècle, il se fit dans les entrailles de la nation, mystérieusement et sourdement, un travail d'agrégation occulte. L'an mille était passé avec ses terreurs, et l'humanité revenue à l'espérance, selon qu'elle se trouvait guerrière ou religieuse, élevait des tours ou construisait des églises. Chaque seigneur attirait des colons dans ses domaines par des concessions de terres; les monastères s'en procuraient aussi aux mêmes conditions, et en recueillaient en outre un grand nombre par la proclamation du droit d'asile. Des villes se formèrent ainsi, s'organisèrent. s'agrandirent. L'ordre, qui avait été nécessaire dès le premier jour, produisit le travail, celui-ci la richesse ; la richesse amena l'instruction, et cette dernière fit sentir le besoin d'une certaine indépendance. Oui, tel est le ferment de la nature divine vivante en nous, tel est l'ascendant de cette loi suprême de la raison humaine, que la société la plus ignorante finit toujours par deviner ses droits et avoir la conscience de sa noble destinée ! Les vassaux arrivés à ce degré, achetaient donc successivement quelques franchises, faisaient des acquisitions foncières, et obtenaient moyennant finance, protection pour leur commerce et leurs personnes. Or, à une heure donnée, toutes ces franchises rassemblées en faisceau, firent une masse de droits. C'est en ce moment que les populations des villes, composées de bourgeois, de petits propriétaires, de marchands, tous mûris par l'exercice de la vie sociale, se sentant assez d'intelligence pour surveiller leurs intérêts, cherchèrent à échapper au pouvoir féodal, en devenant communautés libres. Les soigneurs s'y opposèrent, essayant de retirer ou de restreindre les franchises accordées, et l'insurrection commença. L'insurrection fut donc obligée; elle n'est là que comme formule, comme consécration de certaines idées. Ainsi naquirent généralement les communes; leur enfantement fut long et presque toujours sanglant; il eut toute la gloire, mais aussi toutes les douleurs de la fécondité.
La lutte entamée, Dieu seul put savoir tout ce que ces pauvres bourgeois déployèrent de dévouement et de persévérance pour la soutenir. Ils auraient probablement succombé à la longue, si quelque voix venue des plus hauts lieux, ne leur eût conseillé d'invoquer l'appui du roi. Celui-ci du reste, était bien aise qu'on invoquât sa suprématie dans ces diverses conjonctures, car il y trouvait son profit. En effet, la royauté s'interposant en toute circonstance entre les seigneurs et leurs vassaux, organisait ces derniers et commençait à s'en servir comme d'un levier pour ébranler l'édifice féodal, en attendant qu'elle pût les employer en guise de massue, pour l'abattre. A leur tour, les communautés bourgeoises, prenant l'habitude d'en référer au souverain, contractèrent avec lui des relations, et commencèrent leurs rapports avec le gouvernement central. C'est de cette manière, qu'à l'ombre de la main royale, naquit et se forma le tiers-état.
Voilà ce qui se faisait généralement en France aux XI° et XII° siècles ; mais dans la Haute-Auvergne, disons le bien haut, les choses étaient mieux et autrement.
Ici, sur notre sol, alors privilégié, le régime municipal romain s'était acclimaté facilement, parce qu'il avait respecté l'organisation celtique si riche de liberté. Ce municipe latin modifié, s'incarna dans nos bourgades, et s'y fortifia par l'appui du clergé. En effet, la société civile gallo-romaine se sentant impuissante à vivre seule, vint se rallier à la société religieuse plus jeune et plus virile. Saint Géraud qui était encore plus chrétien que Gaulois, prit de l'église le statut romain, déclara l'allodialité de son patrimoine, et au commencement du X° siècle, donna des libertés particulières à la ville d'Aurillac. Une foule de monuments écrits nous racontent, qu'en 916, le jour de la consécration de l'église de l'abbaye, le comte Géraud affranchit cent serfs, et leur abandonna ainsi qu'aux habitants, un franc-alleu considérable, circonscrit entre quatre croix En outre quelques individus, qu'avait désignés un vote public, furent investis par sa volonté, d'un certain pouvoir en ce qui touchait l'administration de la ville qu'il venait, non de fonder, mais d'agrandir. Certes, c'est un des monuments les plus anciens de l'application municipale en France. Par saint Géraud survécurent donc les derniers débris de la curie antique dont avait joui la province. Cette constitution ne fut pas écrite sans doute ; c'était inutile puisqu'elle existait déjà. Mais proclamée solennellement, elle se classa à l'état de fait actif, et sa permanence se manifesta par sa pratique et sa longue durée. Les élus d'Aurillac ne prirent pas le nom d'échevins, ce qui eût été germanique, mais le titre de consuls, afin de se rattacher de plus en plus à la filiation romaine. La commune exista dès lors, vivant de sa vie propre, car elle avait le mallus, ses fourches patibulaires, sa cloche, son sceau, ses armes. Au xi* siècle, il n'y eut rien à faire pour nous: Aurillac était en possession depuis longues années, d'un régime pareil ou analogue à celui qui s'organisait partout. Aussi lorsque en 1280, après plusieurs débats entre les consuls et le monastère, il fallut écrire une transaction et attribuer la vie légale à nos privilèges que l'abbé voulait amoindrir, on donna à cette charte la qualification de Paix, ce qui impliquait l'existence de contestations longues et antérieures. A ce moment le consulat ne fut pas établi, il fut seulement reconnu. C'est donc à saint Géraud seul, que nos ancêtres doivent d'avoir vécu libres, et cela dès le règne de Charles-le-Simple. Les franchises d'Aurillac ne sont L'œuvre d'aucune concession royale, d'aucune lutte primitive. Nous ne sommes redevables aux rois, que de quelques lettres-patentes portant des règlements sur les attributions du consulat.
L'érection des communes, dont la première selon toute apparence, se fonda dans la Haute-Auvergne, fut un coup mortel pour la féodalité. Celle ci, ombrageuse, continua à vivre tout d'une pièce, dédaignant de s'assouplir aux phases ambiantes de la France. Et pendant que les communes, dans leur mission opposante, répondaient aux besoins des choses et des esprits, en faisant de l'espace autour d'elles, la féodalité au contraire, amie des ténèbres, garda son corselet tissé d'une maille si serrée, que la lumière et le progrès, n'y purent pénétrer. Evidemment la féodalité appartenait au passé et le fermait, les communes ouvraient l'avenir et y entraînaient le monde.
Communes rurales.
— Telle est l'origine de la commune d'Aurillac. Poursuivons nos investigations pour arriver à la formation des communes rurales en Auvergne, et notamment sur les terres dépendantes de l'abbaye. Nous allons voir ici l'élément féodal se combinant avec l'élément catholique. Tachons donc de déterminer le mode et la mesure de ces deux principes, en prenant garde de ne pas trop exagérer l'action de l'un, ni de trop réduire l'influence de l'autre.
Pour être mieux compris, je vais indiquer l'état de la population agricole, soit antérieurement au X° siècle, soit après.
Et d'abord, l'origine de la classe rurale qui a tant préoccupé les érudits et les penseurs, ne me parait être dans notre pays, ni l'effet primitif de la conquête, ni l'œuvre de la législation, mais tout simplement le résultat de l'extension de la famille.
En effet, sous l'ère celtique, bien que les Gaulois ne possédassent pas en propre une quantité de terre déterminée par des limites invariables, cependant les bourgades n'étaient formées que par la réunion de ceux qu'unissait un même lien de consanguinité. Aussi était-ce dans la famille que chaque tribu choisissait ses magistrats, et ceux-ci distribuant les champs, fixaient à chacun la portion de sol qu'il avait à travailler dans l'intérêt du clan, appelé par tacite. Pagus — Voilà les premiers cultivateurs arverniens.
Ultérieurement, quoique l'invasion romaine ne nous eût point atteints par ses soldats armés, néanmoins elle entoura la Haute-Auvergne et lui ceignit les reins de si près, qu'elle fit naturellement pénétrer jusqu'au sein de nos montagnes, sa civilisation et ses lois, toutes deux bien plus parfaites que les nôtres.
Du 1er au V° siècle, la situation des populations rurales se trouva adoucie, au moyen du colonat.
En ce temps-là on devenait colon, par un contrat passé avec le propriétaire dont on recevait une portion de terre avec charge de s'y établir et de la cultiver.
Les colons avaient une condition légale très-distincte de celle des esclaves. A la différence de ceux-ci, ils contractaient de véritables mariages, qui conféraient à leur postérité, tous les droits légitimaires; ils servaient dans les armées; la redevance qu'ils payaient, était fixe et ne pouvait être élevée : circonstance, pour le dire en passant, qui favorisa merveilleusement l'essor de l'agriculture; enfin les colons se reconnaissaient capables de propriété. On donnait il est vrai à la leur, le même nom qu'à la propriété des esclaves : Peculium; mais le pécule des esclaves revenait au maître, tandis que non seulement les colons possédaient en propre leurs économies, mais encore les transmettaient à leurs enfants. — En compensation, le colon était attaché à la terre, qu'il ne devait pas quitter; et s'il fuyait, on avait droit de revendiquer sa personne, jusque dans les rangs du clergé. Le seul mode qui restait au cultivateur pour devenir libre, en dehors de la volonté du chef, était la prescription : c'est à dire, lorsqu'il avait joui pendant trente ans de la liberté, sans que nul le réclamât.
Après la conquête des Gaules par les Francs, le colonat fut profondément aggravé ; voici comment:
Sous la domination romaine, le propriétaire n'exerçait sur les colons que des droits purement civils, car la loi avait réservé à l'empereur, le pouvoir politique. De sorte que dans plusieurs cas, l'agriculteur échappait un instant à la dépendance privée. — Mais au contraire, dans la tribu germanique, la souveraineté étant réunie à la propriété, le colon se trouva ne plus relever de personne que de son maître seul, et lui appartint en entier.
Les conséquences en furent celles-ci : le seigneur, en sa qualité de souverain, imposait la capitation, en même temps que comme propriétaire, il percevait la redevance. Puis insensiblement la capitation se transforma en impôt, et devint la taille; or, comme c'était le seigneur qui la réglait sans contrôle, il arriva que la taille s'augmenta, selon les besoins du maître ou son bon plaisir. Ainsi, au point de vue politique et même matériel, la situation du colon fut empirée par l'invasion franque, puisqu'il n'eut plus de recours supérieur, et devint en résultat, complètement esclave. — Cet état dura jusqu'au XII° siècle, époque meilleure où le progrès commença. Ce fut alors que la plu part des évêques et des chefs d'abbayes, voulant primer les seigneurs laïques, accordèrent une assez grande quantité de privilèges aux serfs de leurs domaines religieux. (1)
(1)
Mably; Observations sur l'histoire de France.
Augustin Thierry ; Lettres sur l'histoire de France.
Guizot ; Histoire de la civilisation en Europe et en France.
Sismondi ; Histoire des Français.
Ces préliminaires historiques posés, localisons les faits.
Sous saint Géraud (834 à 920), ses fiefs, tous allodiaux, étaient tenus par des seigneurs anciens relevant de lui, ou par de» hommes d'armes nouveaux, qu'il investissait de ce droit.
Ces nobles feudataires habitaient des manoirs fortifiés. Leurs résidences, siéges de seigneuries plus ou moins considérables, devenaient naturellement la forteresse protectrice des terres qui en dépendaient.
Là, avait lieu la vie tout-à-fait primitive, c'est à dire la vie isolée. Les relations entre les colons et le château, bien que permanentes, n'étaient qu'à échéance et souvent même accidentelles. Ainsi le colon devait le service militaire; il portait sa redevance; il avait recours au seigneur pour lui demander justice; enfin il accourait chercher un abri derrière les remparts, lorsqu'il était menacé par l'ennemi. Voilà à quoi se bornaient les rapports usuels. — N'importe: quoique rares, ils n'en constituaient pas moins une véritable agrégation.
Toutefois, au X° siècle, un événement survint, qui opéra dans les campagnes des environs, une cohésion bien autrement puissante : je veux parler de l'érection du monastère d'Aurillac.
A la mort du comte Géraud, ses vastes domaines devinrent la propriété de l'abbaye qu'il avait fondée.
Cette abbaye, placée sous la mouvance directe du Saint-Siège, copia la cour pontificale dans l'administration de ses biens, et le soin qu'elle apportait à ses possessions agricoles.
Or, en ce temps, l'église n'était pas uniquement une croyance, c'était une institution; d'une main elle bénissait, de l'autre elle organisait.
Donc, l'abbaye s'attacha à élever des chapelles, sur tous les points de son territoire où il n'en existait pas encore.
L'église bâtie, produisit de suite un rayonnement attractif qui s'opéra de la circonférence au centre. Désormais ce ne fut plus le château, mais le clocher qui fut en vue. En effet, les offices religieux qui se célébraient chaque dimanche, attirèrent périodiquement dans le sanctuaire, les habitants des vallées voisines. Les colons prenant l'habitude de se rencontrer, profitèrent de cette occasion précieuse, pour parler entre eux d'affaires, conclure des marchés, opérer des échanges. La régularité des existences amena des besoins nouveaux qui provoquèrent des travaux plus variés. Non loin de l'église, vinrent s'établir certaines industries sédentaires : le forgeron, le cordonnier, le marchand, élevèrent en ce lieu leurs échoppes. D'un autre côté, le curé visitait les infirmes, allait consoler les affligés, et prescrivait des remèdes aux malades; car on sait que la médecine pendant cette époque barbare, était pratiquée par les prêtres, et devenait le complément de leur sainte mission. Ainsi donc se forma autour du clocher, un foyer de relations et d'affections, qui engloba une certaine étendue de roi. Bientôt on sentit la nécessité de tracer des chemins pour aller à l'église, ou d'améliorer les anciens. Ce n'est pas tout encore : comme l'élève des bestiaux avait toujours été la véritable fortune des montagnards, il existait depuis l'ère gauloise, de grands pâturages abandonnés à la jouissance commune, et dont chaque clan usait promiscuement. Les manants ( Du mot latin manere, rester), du fief comprirent qu'il fallait en réglementer l'usage, afin d'éviter pour l'avenir, d'interminables discussions. Aussitôt le viguier, fort do l'assentiment général, posa quelques principes de droit commun, d'où sont sorties plus tard nos coutumes judiciaires. Plus tard encore, profitant des dispositions du Code théodosien, le recteur songea à instituer un régime ecclésiastique qui tînt le milieu entre le droit municipal romain et celui du moyen âge. Alors, conformément aux traditions celtiques, furent désignés par la population rassemblée, quelques hommes notables, lesquels sous la dénomination de consuls ou de syndics, devaient s'occuper au profit de tous, des objets d'utilité publique. Il advint de cet ensemble de faits, qu'au bout d'un temps assez court, les habitants, liés par une réelle communauté d'avantages, se regardèrent comme membres d'une même famille. - A partir de ce jour, quelque chose de nouveau était fondé : la seigneurie resta bien la seigneurie, le fief fut toujours le fief, mais il y eut en plus, la paroisse.
Et bien, c'est cette paroisse, qui plusieurs siècles après, sépara les matières spirituelles des intérêts purement temporels; et s'aidant pour les régir d'un mécanisme administratif plus savant, devint à son tour la commune rurale.
L'église.
La commune de Naucelles doit évidemment son nom à son église (Nova Cella). Selon toute vraisemblance, la construction du monument primitif, remonte au X° siècle. C'est l'époque en effet, où l'abbaye nouvellement créée, se trouvant riche de jeunesse et d’ardeur, dut opérer hors des murs d’Aurillac, sa première expansion. Sans doute aussi, ce sont des religieux bénédictins qui desservirent la chapelle récente, car il était d'usage alors, que les moines exerçassent les fonctions ecclésiastiques, dans les terres de leur dépendance. Mais en 1215, le quatrième concile de Latran, ayant décidé que les membres du clergé régulier, se retireraient dans leurs cloîtres, ce fut des prêtres séculiers qui, sous le nom de recteurs, se trouvèrent désormais chargés de ce ministère. Or, le premier d'entre eux dont nos titres fassent mention, est Raymond, qui était recteur de Naucelles en 1290. La même année, Astorg, .seigneur de Messac, fit son testament en faveur de cette église, et un bourgeois nommé Pierre de Cros , lui légua également le pré du Moulin, en 1483.
L'église actuelle, dédiée à saint Christophe, doit dater de ce temps (XV° siècle). Elle est petite, et appartient au style ogival rustique, style impersonnel et tout à fait dénué de caractère et d'accent. Cet édifice n'a donc rien qui puisse nous occuper au point de vue architectural. Cependant tout humble qu'il était, ses pasteurs l'aimaient, et plusieurs en le quittant, lui firent une offrande, ou lui laissèrent un souvenir. Guillaume Salés, curé en 1540, donna une cloche à la fabrique. Plus tard, Géraud Claux, qui occupait le même poste en 1567, ordonna par acte testamentaire, que si l'église était dévastée, elle serait réparée aux frais de sa succession. Le legs probablement ne resta pas inutile, car on entrait au fort des guerres religieuses, et les huguenots qui en 1569, saccagèrent Aurillac avec tant de furie, ne durent certainement pas épargner les paroisses voisines. Pierre de Vigier, curé en 1676, eut pour successeur autre Joseph de Vigier, son parent. L'église reçut de ce dernier un ostensoir d'argent doré. En 1684, Jacques Moles, avocat, concéda une maison qu'il possédait à Naucelles, pour l'établissement d'une école de filles. Ainsi déjà s'éveillait l'intérêt porté aux classes agricoles; déjà dans les plus pauvres campagnes. les besoins intellectuels et moraux recevaient satisfaction. Après François Malvesin , curé de Naucelles en 1692, on compte Antoine Lintilhac qui le devint en 1704 , Noël Abège en 1712 , et enfin Joseph Souquières en 1751.
Je n'ai rien remarqué de curieux dans le mobilier appartenant à l'église, qu'un vieux émail, représentant un christ sur sa croix. Quoique altéré il est très-beau, et m'a paru de l'ère byzantine. — A cette occasion, je prendrai la liberté de relever une erreur archéologique fort répandue dans notre pays. Un grand nombre d'ecclésiastiques, en remarquant sur leurs châsses ou tableaux émaillés quelques lettres grecques, telles que l'alpha et l'oméga (principium et finis), se persuadent que ces objets sont des produits directs de l'art oriental, et viennent de Byzance. Ils se trompent. Il est certain que les croisés rapportèrent avec eux une foule de coffrets et d'ornements d’orfèvrerie, appartenant au style grec du bas-empire. Mais ces reliques pieuses, ne paraissent pas avoir été de l'émail, dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, c'est-à-dire du cristal fondant appliqué aux métaux : c'étaient plutôt des images et des bijoux recouverts de quelque enduit solide, qu'on pourrait assimiler au vernis de la poterie. Seulement l'Eglise catholique ayant immédiatement adopté leurs formes syriennes, à cause d'un certain sentiment religieux dont elles se trouvaient empreintes, la ville de Limoges les copia en émaillure, et à partir du XI° siècle, perfectionna notablement cette lucrative industrie. Mais alors, le travail des émaux n'était pas encore passé des doigts de l'artisan, aux mains plus inspirées de l'artiste. Ce qui le prouve, c'est que les copies faites,à Limoges sur ces modèles étrangers, s'exécutaient d'une manière si servile, que prenant les lettres arabes ou grecques, pour de simples ornements, on grava tout sans exception : et j'ai vu en Italie, des vases sacrés qui portent écrits, jusqu'à des versets du Coran. — Ainsi tenons pour positif, que ces émaux anciens, appartiennent malgré leur aspect oriental, à l'école limousine. Ils constituent donc une de nos richesses nationales, et montrent la souplesse de goût, en même temps que la fertilité du génie français (1)
(1) La manufacture de Limoges jeta un grand éclat sous François 1er. Cette école s'inspiranl des œuvres italiennes qu'accomplissaient à Fontainebleau, Primalice, André del Sarte, le Rosso, etc.. grandit, prit du souffle, et produisit des émailleurs dont le nom est devenu célèbre. — Citons parmi eux : Bernard Pénicaud, et son frère Jean (1501; ; — Léonard Limosin, le plus illustre de tous (1330); — postérieurement, les deux Courtois; — Martin et Albert Didier; — Jean Court; — les trois Nouailher, Jacques, Pierre et Jean-Baptiste; — enfin Noël et Jean Laudin (1695). Avec ces derniers finit la véritable émaillerie limousine.
LA TOUR.
La tour s'élève à quelques pas de l'église , sur un monticule artificiel. Elle est isolée. C'était un de ces monuments destinés à servir de signaux et où, dans les moments de danger, on plaçait un poste de guetteurs (guiatte). L'emploi de ces sentinelles consistait à donner l'alarme avec une cloche, une trompe, quelquefois même par des cris et de grands feux. Au moyen âge, dans ce temps où le pouvoir centralisé n'existait pas, les provinces avaient senti la nécessité de se défendre elles-mêmes, et de se précautionner contre des surprises, rapides souvent comme la foudre. Alors les seigneurs s'entendirent pour élever de distance en distance un certain nombre de tours, qui correspondaient avec les châteaux forts principaux. De sorte qu'en cas de guerre, la contrée entière, dans un même jour, pouvait être sous les armes.
Je crois devoir énumérer les tours connues dans le Cantal, et que l'on suppose avoir servi à cet usage:
Arrondissement d'Aurillac.
La tour de Puy-Mourier, commune de Raulhac.
— de Caylus, commune de Roussy.
— du Bex, commune d'Ytrac.
— de Belbès, commune d'Aurillac.
— de Couissi, dominant notre ville, à l'extrémité sud du bois de Lafage,
et dont l'emplacement étagé, se reconnaît parfaitement encore.
— de Saint-Simon, au bourg de ce nom.
— de Faliès, commune de Lascelle.
— de Naucelles, au bourg de ce nom.
— de Broussette, commune de Reilhac.
La tour de Marmanhac, au bourg de ce nom.
— de Vercuère, commune de Laroquevieille.
— de Marze, commune de Saint-Cernin.
Arrondissement de Mauriac.
La tour de Pralat, au bourg de Saint Chamant.
— de Leybros, commune de Saint-Bonnet.
— de Saint-Thomas, près de Mauriac.
— d'Arches, dans le bourg de ce nom.
— de l'Herm, commune de Méallet.
— de Marlas, commune d'Auzers.
Arrondissement de Murat
La tour de Bazilet, commune de Marchastel.
Arrondissement de Saint-Flour.
La tour de Valette, au bourg de Chaliers.
La tour de Naucelles paraît appartenir à la fin du IX° siècle. Sa forme figure un large carré, défendu autrefois à sa base par une enceinte fortifiée. Le sommet de l'édifice est aujourd'hui en ruine; mais en 1742 , on voyait encore les solides créneaux qui le couronnaient. La tour était terminée par une plate-forme destinée a recevoir un certain nombre d'hommes, ainsi que des machines et des provisions de pierres, ou autres projectiles. Sur un des angles, se trouvait une petite guérite maçonnée, faite pour abriter les sentinelles chargées d'observer les mouvements de l'ennemi. La hauteur de ces forteresses variait à l'infini : cependant leur élévation devait être naturellement en rapport avec l'espace qu'il s'agissait de surveiller. Celle de Naucelles que l'on prétend avoir été très-haute, possède un escalier ménagé dans l'épaisseur du mur, et conduisant jusqu'au troisième étage. II cessait à ce point, et l'on ne communiquait avec les parties supérieures, qu'au moyen d'une échelle, que chacun retirait après soi, crainte de trahison. De là on arrivait à la plate-forme, par une ouverture percée au milieu de la voûte.
Chaque tour avait des meurtrières : celles de Naucelles se distinguent encore. Ce sont de longues fentes verticales resserrées à l'extérieur, et s'élargissant à l'intérieur, destinées à l'introduction de l'air et du jour. C'est par là que les soldats lançaient leurs flèches, et plus tard, tiraient l'arbalète, dont l'usage s'était introduit en France à la fin du XII° siècle.
Indépendamment de sa destination comme signal, cette tour qui appartenait à l'abbaye, servit aussi de prison en plusieurs circonstances. Je lis dans la grande enquête , faite par l'ordre du roi Philippe-le-Hardi, sur la requête de l'abbé d'Aurillac par suite de contestations survenues entre lui et les consuls de cette ville, le fait suivant : — « 1258. — Astorg de Messac , dépose qu'il y a environ vingt-six ans, que le damoiseau (C'était le titre que l'on donnait à un gentilhomme, qui n'avait pas été armé chevalier) Henri, homme d'armes de l'abbé, conduisit à Naucelles, Bernard de Conques, d'Aurillac, arrêté dans la ville, à la suite d'un vol qu'il avait commis; il le livra à mon père et à Mgr Hugues de Messac, chevalier, mon oncle, qui gardait la tour de Naucelles pour l'abbé. Ils le mirent en prison dans cette tour, et il y mourut. — Un autre témoin dépose qu'il l'enterra dans le fossé (1) »
- (1)Traduction publié.' par M. le baron Delzons; — Annuaire du Cantal, 1849, p 219.
Nous devons dire encore, qu'à cette tour de Naucelles, s'attache une légende. Elle est intéressante; la voici.
Une Légende. — La Pardonnée.
On était au mois de mai de l'année 1388, et au plus vif de l'invasion anglaise en Auvergne (2).
(2) Cette invasion commencée en 1356, ne finit qu'en 1392.
Les Anglais s'étaient si fort avancés dans notre pays, qu'ils occupaient le château de Roquenatou. près de Marmanhac (3).
(3) Voyez les trois quittances constatant le séjour des Anglais dans ce château, en 1388. — 1er volume de la Statistique d'Auvergne,.
Craignant quelque tentative sur Aurillac les consuls de la ville, l'avaient mise en état de défense, et l'abbé venait de donner ordre au seigneur de Messac, de placer un guet dans la tour de Naucelles dont il était gardien. Ce guet surveillant la vallée, jusque dans ses plus lointains horizons, devait avertir de l'approche des ennemis, au moyen de trompes et de cloches qui pouvaient être facilement entendues du château de Saint-Etienne où résidait une garnison. Afin même que le poite de Naucelles fut plus vigilamment tenu, Mgr l'abbé y avait envoyé depuis quelques semaines, un jeune sergent morionné (4) nommé Hugues, tiré de ses propres troupes, et qu'il savait être très-sûr.
(4) Serviens morionatus; sergent portant casque. — Distinction de grade et d'arme.
Ce sergent d'armes qui commandait à dix hommes enfermés dans la tour, se montrait d'une grande sévérité de service. Il ne sortait que rarement de sa petite forteresse, surveillait rigoureusement la vigie, et à part les offices du dimanche, auxquels il assistait avec exactitude, on ne le voyait presque jamais.
Mais le dimanche, Hugues paraissait à l'église dans son costume militaire le plus éclatant. Il prenait invariablement sa place auprès du sire de Messac, toutefois sur un siége plus bas; et là, sans regarder autour de lui, indifférent même à la présence des jolies paysannes qui s'agenouillaient dans le sanctuaire, il conservait une physionomie sérieuse, et avait par moments sous cet air rigide, une expression de beauté étrange.
Or, parmi ces jeunes filles, il en était une appelée Luce, ou plus communément la Mongette; ce qui signifie en patois, petite religieuse. C'était une orpheline, vouée à la Vierge depuis son enfance, et dont le recteur s'était chargé par charité. Elle pouvait avoir alors dix-neuf ans. Comme elle se trouvait d'une santé délicate, ses occupations consistaient à décorer les autels des chapelles, à ouvrir et fermer l'église, et à distribuer quelques aumônes. On remarquait dans le regard de ses yeux bleus, dans le sourire de ses lèvres faiblement colorées, dans la nonchalance de sa démarche une sorte de langueur, qui semblait accuser l'absence ou le sommeil de toute passion vive. Et pourtant, toute enfant, le bon
recteur disait d'elle: « Il faut plaindre Mongette, car elle ne vit que par l'âme! »
Chose singulière, Luce qui avait un caractère naturellement gai et pétulant, possédait un grand fonds de défiance d'elle-même, allant souvent jusqu'à la timidité. Ainsi elle commença à regarder le sergent morionné pour s'en moquer et en rire; puis en considérant sa figure constamment grave et parfois menaçante, elle finit par en avoir peur.
Maintenant, comment expliquer à travers quelles pensées ou quelles sensations passa cette jeune fille, pour dire que sans avoir jamais parlé à cet homme , elle l'aima.
Du reste, comme ce sentiment était nouveau pour elle, il existait, que Mongette ne s'en doutait point.
Un jour, plus rêveuse que de coutume, elle s'en alla seule, promener du côté de la plaine. Cette journée, Luce ne savait où rester. Dans sa promenade elle marchait tantôt lentement, tantôt avec rapidité; tantôt joyeuse, tantôt triste. Une fois, en entendant une fauvette chanter, elle se mit à sourire; l'instant d'après, voyant au bord du sentier de belles pâquerettes qui badinaient dans l'herbe avec les papillons et la brise, les larmes lui vinrent aux yeux. Evidemment l'orpheline souffrait d'un malaise inconnu.
Au retour, elle trouva Hugues qui s'avançait vers elle et qui l'ayant jointe, lui dit de cet air sombre qui l'épouvantait et lui plaisait: « Dites fillette, c'est vous je crois qu'on nomme Luce; eh bien, voici un conseil : à l'avenir n'allez plus si loin par-là bas, car les autres (c'était ainsi qu'on désignait les Anglais) finiraient par vous prendre. »
Mongette qui, pour la première fois, entendait le soldat lui adresser quelques paroles d'intérêt, se prit à trembler de tous ses membres. Elle resta donc un instant indécise, et puis elle répondit très-vite et sans lever les yeux: « Un bon conseil annonce un ami; vous ne voudriez donc pas qu'il m'arrive de mal? » A cette question faite avec émotion et presque avec tendresse, Hugues répliqua
durement : « Oh! c'est pour le recteur que je dis cela, à cause de la peine qu'il pourrait en avoir; car pour moi, vous comprenez que je ne suis pas responsable de vous, je ne surveille que ma tour. »
Là dessus il lui tourna le dos et continua son chemin.
Luce blessée et rouge de confusion, s'éloigna interdite. La réponse du jeune homme lui avait paru aigre comme une injure: — « Est-ce qu'il aurait le cœur méchant, pensa-t-elle? »
Un autre jour, étant à l'église, il lui sembla que Hugues la fixait. Obéissant à une attraction magnétique et puissante, elle porta ses regards du côté des siens. Mais le sergent d’armes, fâché sans doute, détourna de suite la tête et regarda ailleurs.
« Il me hait, pensa Luce, c'est sûr.... et moi je l'aime! »
La pauvre fille avait connu qu'elle l'aimait, parce que la veille au soir, ayant recommencé trois fois de suite sa prière, trois fois de suite à son insu, le nom de Hugues s'y était mêlé (1).
(1) Croyance superstitieuse. — Vovez Marruaugy, Tristan le voyageur.
A partir de ce moment, Mongette évita toute occasion de rencontrer le soldat. A genoux près de l'autel de la Vierge, elle renferma dans sa poitrine ce doux amour, mélancolique et secret comme un sanglot étouffé.
Sur ces entrefaites, Mgr l'abbé envoya un remplaçant à Hugues, et lui ordonna de revenir au monastère.
Le matin de son départ, on le vit qui passait sous les fenêtres du recteur, murmurant sans intention peut-être, le commencement d'un virelai très-populaire en ce temps:
Je pars, adieu la belle fille,
Je pars avec grand mal au cœur
Luce n'en entendit pas davantage; elle se retira de la croisée, et dans le délire de sa joie, elle ne put que prononcer ce mot : « Enfin! »
Cet incident, quelque insignifiant qu'il parût être, décida de sa vie. Tant que Mongette avait vécu près de Hugues, se croyant détestée, elle souffrît en patience. Mais maintenant qu'il partait, l'aimant, son âme se brisait, et l'orpheline de se sentit plus le courage de rester où il n'était pas. Néanmoins sa volonté lutta encore. Elle redoubla ses prières, marcha, s'étourdit, se désola : rien n'y fit. Hélas! c'est qu'on ne peut pas désaimer comme on veut.
Une quinzaine de jours après, c'était l'après-midi du 25 juin, la malheureuse enfant s'arrêta à une résolution désespérée. Elle prit les clés de l’église, alla à l'autel de la Vierge, et là s'agenouillant devant son image, elle lui dit d'une voix entrecoupée de pleurs : « Sainte Vierge, j'ai longtemps gardé ces clés et orné votre autel. Aujourd'hui, je ne me sens pas assez pure pour remplir les mêmes soins, car je ne puis me défendre contre les tentations mauvaises. Vous ne venez pas à mon aide, vous m'abandonnez; eh bien ! Je me sens vaincue et je me rends. En partant, je vous remets les clés de l'église. Que deviendrai-je? Vous seule le savez; ayez donc pitié de moi.
Alors Mongette déposa les clés sur l'autel, sortit du sanctuaire, et suivant un sentier détourné, revint joindre le chemin d'Aurillac.
Il faisait trop jour encore lorsque la fugitive y arriva; aussi afin d'être moins remarquée, elle attendit pour entrer dans la ville, que la nuit fut venue. A neuf heures sonnantes, elle traversa la porte d'Aureinques, (1)et descendit la rue de ce nom, au moment où les argentiers fermaient leurs boutiques.
(1) Le nom de la rue d'Aureinques, lui venait des orfèvres qui y faisaient le commerce des paillettes d'or tirées de la Jordanne, aurei qui que.
Arrivée sur la petite place, en face de l'église de Notre-Dame-aux-Neiges, appelée la Communauté, Luce vit un grand feu qu'une foule d'écoliers venaient d'allumer en l'honneur de saint Jean (2).
(2) L'usage de ces feux est druidique. C'est un débris de l'ancienne fête du solstice, instituée en vue du culte du soleil.
Prenant alors la rue de la Pelleterie (actuellement rue du Collége), elle gagna la rue des Dames, proche le cloître de Saint-Géraud, où se trouvait une modeste hôtellerie destinée aux pélerins.
Dès le lendemain, Hugues reconnut Mongette qui sortait de l'abbaye. Il la suivit discrètement pas à pas, et sut ainsi sa demeure.
Bientôt, avouons-le, Luce affolée d'amour pour ce reitre, était devenue la plus coupable des créatures. Vertu, honneur, devoir, elle avait tout oublié; tout, excepté la Vierge, à laquelle chaque soir, sa bouche adressait une prière.
Une circonstance qui montre à quel point les passions pervertissent l'esprit, c'est que, quoique plongée dans le vice, elle se croyait heureuse. Enivrée, elle ne rougissait pas de ses torts, et semblait boire résolument sa honte. Peut-être rêvait-elle de longs jours ainsi, car Hugues sincère et bon , promettait d'être Adèle. Mais de même qu'il est écrit que l'arbre du mal ne produit que des fruits amers, de même toute faute amène vite son châtiment.
En effet, le dernier jour du mois de juillet, vers deux heures du soir, le tocsin d'alarme sonna au beffroi du monastère. C'était une rixe qui venait d'éclater à la porte du Buis, entre des habitants de la ville et quelques soldats de Mgr l'abbé. Hugues y courut. Dans sa précipitation, il ne songea pas à mettre son morion, et s'en alla avec une simple toque sur la tête. Comme il était très-brave et d'un caractère résolu, on assure qu'il entra vivement dans la mêlée, mais cependant sans colère. Malheureusement, un bourgeois plus hardi que les autres, l'ayant menacé par des paroles outrageantes, le sergent d'armes perdant patience, le blessa du manche de son poignard. Celui-ci rendu furieux, profita d'un moment où le garnisaire se détournait, et levant son sabre, il lui fendit le crâne. Hugues tomba sur place, pour ne plus se relever.
Ceux qui font attention à chaque chose, avaient remarqué, que le matin, en sortant de sa chambre, et presque au seuil de la maison, Hugues fit un faux pas qui jeta son morion à terre. Qu'alors il était remonté, et avait changé cette massive coiffure contre un toquet de drap, en disant : « Tu es plus léger, et pour le danger que j'ai à courir aujourd'hui, tu es tout aussi solide. » — Pourtant c'était le contraire, car si Hugues avait eu le casque au moment de la querelle, il est plus que probable qu'il ne fût pas mort. Mais nul n'échappe a sa destinée!
L'ayant vu tomber inanimé, les bourgeois s'enfuirent et le tumulte cessa.
Pendant que les soldats portaient le corps de leur camarade dans une maladrerie voisine, de nombreux rassemblements de curieux se formèrent, et une grande rumeur courut dans le quartier. Luce entendant du bruit, et voyant les habitants qui se précipitaient vers le pont, y alla aussi. Comme elle suivait le courant, ce courant la fit pénétrer dans une maison où tout le monde entrait. Ce fut pour elle un horrible spectacle! Dans une salle sombre, pleine de confusion, on voyait étendu sur le plancher, un cadavre dont la figure était tout ensanglantée. Un médecin étant arrivé, et ayant essuyé le visage, elle crut reconnaître Hugues et se sentit défaillir. Blémie comme au jour de son trépas, elle le considéra avidement plusieurs fois, doutant encore de son malheur. C'était bien lui! Une large blessure avait mis à nu le cerveau et fait une plaie béante où étaient adhérents d'épais caillots de sang noir. Les cheveux s'en trouvaient si souillés, qu'on ne reconnaissait plus leur couleur. Un œil avait jailli de son orbite, l'autre ouvert encore, paraissait regarder. La bouche était calme, mais recouverte d'une mousse rougeâtre qui flottait sur les lèvres. Ses bras tombaient immobiles de chaque côté; et au quatrième doigt de la main gauche, étincelait une bague d'argent, que Luce y avait placée.
Mongette sortit on chancelant. Il lui semblait qu'elle était ivre, car les maison» tournaient autour d'elle. Quelques personnes l'ayant arrêtée pour s informer de ce qu'elle avait vu, la jeune fille leva la tête sans pouvoir leur répondre. Mais ce mouvement lui fit remarquer qu'il y avait une statue de la Vierge sur le portail de la maison où Hugues avait été déposé. Il lui vint alors la pensée que la Vierge aurait pitié du pauvre mort, et qu'elle intercéderait pour le salut de son âme. A l'heure actuelle, s'oubliant elle-même, Luce pour toute grâce, ne demanda rien de plus.
Le jour suivant, la cloche ayant sonné les obsèques, l'orpheline voulut accompagner le cercueil jusqu'au cimetière. Elle vit mettre le sergent d'armes dans sa fosse, puis lorsque la terre eut sourdement retenti sur les planches de la bière, tout le monde se sépara.
C'était une matinée brumeuse. Des nuages gris couraient dans l'espace, et laissaient traîner çà et là leurs lourdes vapeurs.
Après que la foule fut partie, l'infortunée s'agenouilla sur cette tombe à peine comblée. Alors, il faut le dire, son cœur eut un instant d'immense désespoir. En effet se voyant seule, abandonnée de tous et déshonorée, elle su demanda si elle ne ferait pas bien de suivre Hugues, et d'aller dormir pour toujours près de lui, de son paisible sommeil.
Pendant une semaine, Mongette nourrit cette idée, et resta presque folle. Du reste, dénuée de ressources, elle ne soutenait sa vie, qu'en allant chaque matin, chercher à l'aumônerie du monastère, la nourriture que les moines de St-Géraud distribuaient aux pèlerins et aux indigents qui se présentaient (1).
(1) Le monastère avait une aumônerie située sur l'emplacement actuel de la rue du Buis, tout près de la source, nommée encore de nos jours. Fontaine de l'Aumône.
Cependant, la fièvre ne quittait plus Luce. Le mal empirant, quelques personnes charitables s'occupèrent de son sort et obtinrent qu'elle pût entrer à l'hôpital Saint-Jean. C'était un établissement d'origine assez récente, situé rue Saint-Jacques, qu'un illustre enfant d'Aurillac, nommé Guillaume Beauféti, avait fait construire en 1320 (2).
(2) 1319). — Bulle du pape Jean XXII, donnant autorisation à Guillaume Beauféti, évêque de Paris, de fonder à Aurillac l'hôpital Saint-Jean.
On la garda plusieurs jours dans un lit, entre la vie et la mort. Mais comme Dieu n'avait pas encore marqué son heure, Luce se rétablit.
Voilà que pendant sa convalescence, un vieux moine qui desservait l'hospice et en visitait les malades, s'aperçut que Mongette savait lire et écrire. Il crut même observer qu'elle était intelligente et adroite de ses mains. Alors voyant que nul ne la réclamait, il lui fit donner une cellule inoccupée, et là il l'employait à colorier de petites images de la Vierge que l'on vendait ensuite aux personnes pieuses, sous le porche de l'église. Quelquefois afin d'encourager Luce dans ce travail, le prêtre lui disait: « Courage ma fille, il y a au ciel une Reine puissante qui vous voit et vous protégera. » — Et Luce résignée, se contentait de regarder du côté du cimetière, et y fixait ses grands yeux, tout humides d'espoir.
La pauvre Mongette demeura quelque temps dans cet asile, recouvrant pour son corps un peu de force, et pour son âme un peu de paix. Néanmoins une préoccupation inattendue, vint encore la troubler. Le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, elle fut prise pendant la messe d'un si violent désir de revoir Naucelles, qu'elle le compara plus tard, à un accès de fièvre douloureux. Toute la journée se passa à combattre ce désir, qui malgré tout, s'était transformé sur le soir, en impétueuse frénésie. En vain la raison de Luce lui montrait mille obstacles à un pareil retour. Que dirait le recteur? Sans doute il devait la maudire ou l'avoir oubliée? Et puis, comment oserait-elle reparaître aux yeux de la paroisse entière, ayant au front une tache si grande ? Inutiles efforts. Ces réflexions faiblissaient contre une impulsion inexorable, car l'orpheline finit par sentir des espèces de chaînes qui l'entraînaient.
La nuit, lui laissa toute son anxiété, sans lui apporter aucun repos. Le lendemain, ce fut pis encore. L'envie de s'en aller persista avec tant de fureur, que vers les deux heures de l'après-midi, une force surhumaine la souleva toute droite sur son escabeau, et elle entendit distinctement une voix intérieure qui lui disait : « Luce, pars !» — « Eh bien, soit! » dit-elle ; — et elle partit.
Mongette refit le même chemin qu'elle avait parcouru deux mois et demi auparavant. Elle sortit par la porte d'Aurinques , laissa à sa droite le château de Saint-Etienne , et monta vers le Mallus. On appelait ainsi l'ancien endroit des plaids; il s'y trouvait alors ainsi qu'aujourd'hui, un arbre et une croix (1).
(1) Croux-Malli. — Ainsi nommée du lieu où, des l'époque carlovingienne, le comte ou seigneur tenait avec ses conseillers, les assises de justice.
Le temps était doux; le ciel calme et pur. Un beau soleil glissait ses rayons à travers la cime des ormes qui bordaient la route, et allait mourir en pluie d'or sur les prés. Il y avait à l'horizon des teintes chaudes, et dans la campagne, de suaves harmonies. C'était une de ces heures adorables où la nature exhale sa vie par tout son corps; où l'âme silencieuse, absorbe les moindres bruits de l'air, et aime à écouter le tintement d'une cloche , le froissement des herbes , la plainte des ruisseaux. — Mais Luce marchait trop concentrée pour prendre garde a ces merveilles, ni pour éprouver ces émotions. Seulement, au sommet de la côte elle 's'assit, et cueillit distraitement quelques fleurs sauvages, pâles et inodores comme les débris d'un bonheur passé.
Enfin après une heure de marche, interrompue sans cesse par l'inquiétude et l'agitation, elle arriva aux premières maisons du village. Mongette ayant aperçu le sacristain qui bêchait un coin de terre, non loin de la tour, s'approcha. Laissant alors retomber son voile de manière à cacher la moitié de sa figure, elle lui demanda en tremblant, « s'il n'y avait pas autrefois à Naucelles , une orpheline nommée Luce, qui habitait chez le recteur? »
—« Certainement, dit cet homme, sans se déranger de son travail, non seulement elle y était jadis , mais elle y demeure encore. C'est une sainte fille que Mongette, et si vous voulez lui parler, allez à l'église et vous la trouverez probablement dans la chapelle de la Vierge, priant Dieu. »
En entendant ces paroles incompréhensibles, Luce crut que cet homme qui était vieux, avait perdu la raison. Et comme le sacristain reprenait sa bêche, sans plus s'occuper de lui répondre, elle n'insista pas davantage, et s'en alla toute triste.
En passant devant l'église, Luce la vit ouverte et entra.
Heureusement, l'enceinte paraissait déserte, et une légère obscurité y régnait déjà. La jeune fille marcha doucement et avec des battements de cœur extraordinaires, vers cet autel de la Vierge, qu'elle aimait tant et qu'elle connaissait si bien.
Le sacristain ne l'avait pas trompée; une femme était là à genoux et priait. Mongette remarqua que cette femme, visible à peine, portait un costume exactement pareil au sien. Cette circonstance la frappant, elle se souleva sur ses pieds, regarda sur l'autel, et y aperçut la clef de l'église placée au même endroit et de la même manière qu'elfe l'y avait posée, le jour qu'elle s'était enfuie. Des souvenirs déchirants envahirent alors si cruellement son esprit, qu'elle laissa tomber sa tête dans ses mains et se mit à pleurer.
Un quart-d'heure s'écoula ainsi. On n'entendait rien dans la nef, que le bruit de sa respiration oppressée, et quelques soupirs du vent qui pénétrait par les fenêtres.
Enfin voyant que l'étrangère restait immobile, l'orpheline fit un effort, et s'avança vers elle, afin de lui parler.
Mais celle-ci devinant son intention, se retourna, et la regarda avec fixité.
Ciel! que devint Luce, quand elle crut se reconnaître elle-même. Oui, c'était sa taille, son air, son visage, ses joues creusées par l'ongle du chagrin, ses yeux rougis par la trace des larmes.
Interdite, elle tremblait comme la feuille, n'osant faire aucune question, lorsque cette femme qui était restée jusque là agenouillée, se releva lentement, et lui dit:
— « Je t'attendais! »
— « Moi! dit Luce, et qui donc êtes-vous? »
— « Qui je suis?... Je suis celle à qui tu as confié la clef de cette église en t'en allant; celle que tu as toujours invoquée, même au milieu de tes fautes; celle dont tu as peint si souvent l'image, dans ta petite chambre de l'hôpital: je suis la sainte Vierge! »
Les genoux de Luce fléchirent, et elle tomba prosternée.
— « Ecoute, continua la Vierge, j'ai eu pitié de toi! Depuis que tu as quitté le recteur, j'ai pris ta place, et j'ai fait ton service sous ton habit et ta figure. Ainsi personne ne connaît ton absence, ni ne sait ton péché. Retourne donc remplir tes devoirs habituels, repens-toi de tes égarements et aie toujours confiance en moi. »
Puis, la céleste vision disparut.
Luce ayant retrouvé ses sens, vit dans ce miracle la grâce de la sainte Vierge, et la miséricorde de Dieu. A partir de ce moment, elle reprit ses occupations premières, et redevint la pieuse fille d'autrefois. Nul même n'eût jamais su ces détails, si Mongette n'avait exigé par pénitence, que son confesseur les publierait après sa mort.
J'ai ouï dire qu'en 1550, on voyait encore dans le cimetière de Naucelles une vieille dalle fracturée en deux endroits. Cette tombe n'était connue des villageois que sous le nom de : la peyre de la perdounade.
— Le fond de la légende qui précède, appartient incontestablement au XiV° siècle, car il en porte la couleur, et me semble exprimer très-exactement le mouvement des pensées et des besoins de l'âme humaine, à cette époque d'ardente foi. Il y a en effet dans la vie intellectuelle de chaque contrée, une période spécialement favorable à la légende, c'est celle où se rencontre peu de maturité sociale, et beaucoup de piété. Sous l'influence de ces conditions, on voit éclore une sève particulière, indiquant le naïf déploiement de l'imagination qui s'essaie. Alors viennent ces beaux contes, dont la mémoire du peuple s'empare pour toujours.
Quant à moi, j'ai rapporté cette légende, parce qu'elle me semble pleine d'un sentiment exquis. — Au point de vue religieux, elle est parfumée de tout le génie chrétien qui se résume dans ce mot : le pardon! — Au point de vue poétique, je ne connais rien de plus gracieux, même chez les anciens. — Enfin , quant au style, j'ai tâché de conserver au récit, sa fraîche candeur, afin qu'il pût ressembler a ces reposoirs de campagne, avec leurs cierges allumés en plein air , et leurs bouquets de lys qui s'effeuillent sur la nappe blanche.
DOMAINES NOTABLES.
Monthéli. — Au XV° siècle, Pierre de La Salle, chevalier, possédait ce fief, qui passa vers 1446, dans une nouvelle famille, par le mariage de Marguerite de La Salle avec Christophe de Conquans. Un titre, daté d'avril 1505, constate que le seigneur de Monthéli avait droit d'entretenir un colombier près de son château, privilége comme on sait, essentiellement nobiliaire.
En 1560, ce domaine appartenait au fameux capitaine Monthéli, lieutenant de Charles de Brezons, gouverneur de la Haute-Auvergne. Brezons et Monthéli, catholiques outrés, deviennent deux noms inséparables, car tous deux sont célèbres, mais d'une célébrité de sang. Nos annales racontent que la réputation de cruauté du nouveau gouverneur était telle, qu'en apprenant son arrivée dans la province, la consternation se répandit parmi tous les protestants. La plupart se réfugièrent dans des campagnes éloignées, d'autres jusque dans le Limousin. Les événements qui survinrent, prouvèrent combien ils avaient sagement agi. Brezons se rendit à Aurillac, au commencement do 1561, accompagné de Monthéli, lequel commandait une compagnie de méchants routiers, ramassés un peu partout. Le jour de leur entrée dans la ville, en traversant la rue des Fargues, une pierre tombée de la fenêtre d'une maison appartenant à quelque bourgeois huguenot, vint atteindre Brezons au bras, et lui fit une contusion légère. Sans s'informer si l'accident qui venait d'avoir lieu, était volontaire, ou simplement dû au hasard, le gouverneur s'écria qu'on attentait à sa vie. Alors Monthéli irrité, groupa ses soldats, leur indiqua du doigt la maison coupable, et les poussa sus en criant: à sac! à sac! — L'habitation fut envahie, et huit personnes qui s'y trouvaient, parmi lesquelles on comptait des femmes et même des enfants, furent tuées sans merci.
L'année suivante, Brezons dont les yeux étaient constamment ouverts sur les calvinistes, apprit que plusieurs d'entre eux so rassemblaient, pour tenir des conciliabules dans une grange, hors de la porte Saint-Marcel Mon Monthéli reçut ordre de les surprendre et de les châtier. Un soir, sur l'avis qui lui en parvint, s'étant transporté avec ses sbires, à l'endroit indiqué, il pénétra dans le bâtiment, et trouva une quinzaine de gens inoffensifs écoutant une lecture faite par l'un d'eux. Le capitaine alla droit au prédicateur, l'insulta, et le frappa au visage. Celui-ci supporta cet outrage avec patience, et sans récriminer. Mais l'un des hommes de l'assemblée ayant voulu protester contre ces violences, Monthéli sortit sa dague et l'en perça. La mêlée alors devint générale, et comme les huguenots n'étaient pas armés, plusieurs restèrent sur le carreau.
« L'on ne pourrait bonnement exprimer, dit l'historiographe de Serre, l'indignité des pilleries et meurtres que ces deux hommes commirent avec leurs satellites. Ils massacrèrent cruellement en divers cantons, pillèrent quelques châteaux et infinies maisons particulières; volèrent grand nombre de marchands; violèrent plusieurs femmes et filles, bref conclurent d'égorger tous ceux qui avaient fait profession de la religion réformée en ces quartiers-là... (Puget de la Serre, historiographe de France, né à Toulouse.)
Cependant des plaintes si nombreuses s'élevèrent à la fois, que Charles IX mécontent, déposa Brezons de sa charge de gouverneur. (Je possède un curieux portrait sur bois, de Charles de Brezons; belle peinture qui est de François Porbus ou de son école. Ce cadre a 21 centimètres de hauteur sur 16 de large. Brezons est peint en buste, tète nue, vêtu d'un pourpoint de velours et de soie. Aux deux côtés de la collerette, sont attachées et pendent sur la poitrine, huit passementeries élégantes, qu'on appelait dans ce temps, des dentellières, te front est grand, les yeux secs, la barbe inculte et les cheveux ras. Une longue moustache surmonte sa bouche d'une expression soucieuse. On ne saurait se faire une idée de cette physionomie hautaine, et qui révèle à la fois autant de dureté que de tristesse.)
Il ne faut pas se le dissimuler, c'est cette injuste persécution, qui amena peu après, lors de la prise d'Aurillac, les réactions terribles que nous raconterons quelques lignes plus bas. Les protestants ayant alors le dessus, firent périr en dix mois, environ quatre cents catholiques. — Puis, vaincus à leur tour, le jour de la Saint-Barthélemy, ils expièrent les triomphes passés, par la mort de quatre-vingts des leurs.... — En vérité le sang répandu trouble et enivre ; il porte à la tête plus encore que le vin. . .
Envisagé par son côté philosophique, le protestantisme qui fit tant de mal à notre pays, fut fécond ailleurs. Sous cette forme religieuse, s'agitait en Europe, le problème éternel qui fait le fond de toute société humaine, c'est-à-dire la lutte de l'autorité et de la liberté. Il y eut sans doute des excès déplorables, des crimes inutiles, d'odieuses barbaries. Mais au résultat, l'esprit d'examen sortit de ces révoltes, et l'acier des âmes se retrempa dans ces sources d'expiation.
Le capitaine Monthéli ne vit pas tout cela : toutefois sa destinée ne fut pas meilleure. Dans l'année 1567, les consuls venaient de le désigner pour surveiller M. de Duras, qui semblait méditer un coup de main sur Aurillac, lorsque avant de partir, il voulut revoir ses champs de Monthéli. Le capitaine s'en allait paisiblement accompagné de deux salades (Soldais, ainsi nommés du casque dont ils étaient couverts), quand au bas de la côte de Verniols un taureau qui traversa précipitamment la route, effraya son cheval, et le cavalier désarçonné, fut jeté a terre. La chute n'était rien; mais par une circonstance fatale, le pied gauche de Monthéli, armé d'un long éperon, resta engagé dans l'étrier, et le capitaine fut traîné assez loin, la tête frappant contre les pavés. Il parait que l'animal furieux ne put être arrêté qu'au seuil même de la maison que le malheureux venait de faire bâtir, et qui a été démolie depuis peu. On le releva mutilé, et il expira quelques heures après.
Sa mort fit passer le domaine en la propriété de Jacques Lacarrière. Jean, issu du précédent, détenait ce bien dans l'année 1649, et Joseph Lacarrière en 1688. Ultérieurement Jeanne de Lacarrière l'apporta en dot à Louis de La Chesnaye ; et finalement leur fils commun, Dieudonné de La Chesnaye, hérita du fief avant 1789. — Monthéli appartient aujourd'hui à M. François Majonenc, ancien banquier, qui y a fait des constructions considérables et des améliorations bien entendues.
Cologne.
— C'était jadis un château fortifié, dont il ne reste plus actuellement qu'une tour massive, qui domine la rivière d'Authre. Vers la fin du XIII° siècle, il appartenait à Jehan Bruni. Postérieurement, et sous la date du 27 août 1342, nous trouvons un hommage rendu à l'abbé d'Aurillac par Astorg Bruni, descendant du précédent. Cet acte est curieux à signaler, car il montre combien se maintenait vivace dans la Haute-Auvergne, le principe de l'allodialité des terres. Chez nous, la liberté du sol formait le droit commun, l'assujettissement n'était que l'exception. Ecoutez du reste comment s'exprime ce titre, que je ne cite que par extraits.
Astorg Bruni, damoiseau, seigneur de Cologne, reconnaît tenir de révérend père en Dieu, dom Aymerie, abbé d'Aurillac et du monastère, en fief franc, libre et d'honneur, comme du seigneur supérieur, 1° le château de Cologne, situé dans les affars de la Bouygue, avec les affars et mas ci-dessous dénommés, etc.. (Suit une énumération de dix immeubles.)
Sauf et réservé par ledit seigneur Astorg Bruni et ses héritiers, du consentement dudit abbé, sur les fonds ci-dessus reconnus, l'entière juridiction haute, moyenne et basse, et le domaine direct et mixte. Dom Aymerie, abbé, reconnaissant que ledit Astorg Bruni et ses prédécesseurs, ont toujours joui dans les biens ci-dessus reconnus, de la juridiction haute, moyenne et basse, et du domaine direct et mixte, — ne s'est rien réservé sur tout, que la supériorité et le ressort: S'est encore réservé le reconnaissant, que ni l'abbé actuel, ni ses successeurs, ne pourront traduire en justice, ni lui ni ses héritiers, ni aucun des tenanciers des susdits biens, pour cause civile ou criminelle, à moins qu'il ne s'agisse de la supériorité ou du ressort, et en ce cas même, à sa cour d'Aurillac seulement. .. Convenu enfin que pour quelque cause que ce soit, que le reconnaissant et ses successeurs pussent être inculpés et trouvés répréhensibles, les choses ci-dessus ne pourront tomber en commise, ni être remises entre les mains de l'abbé ni de ses successeurs.
Sous le bénéfice de toutes ces réserves, Astorg Bruni fléchit le genou, met ses mains dans celles de l'abbé, lui rend hommage, reçoit le baiser de paix et projet de défendre sa personne et ses biens. — Témoins, Guy de Merle, camérier; Gauffre de Tournemire, prieur de Vezac; noble Raoul d'Escorailles, chevalier; EusLache Fabri, damoiseau; maître Jean de Crozet, jurisconsulte; Pierre de Merle, et Bertrand de Naucaze, damoiseaux. »
La terre de Cologne passa ensuite par acquisition, à messire Pierre de Saint-Martial, seigneur de Drugeac et de Nozières, qui en fit hommage à l'abbé d'Aurillac en 1389. Plus tard, la famille Vernhe de Montsalvy, en eut la possession, et l'un de ses membres, Jean do Vernhe était seigneur de Cologne vers 1140. Cent huit ans après (1548) Guy de Montsalvy, vendit moyennant 12,000 livres, le fief et ses dépendances, à François d'Escorailles, dont la fille Françoise, les porta en dot en 1564, à noble Robert de Lignerac, avec la seigneurie de Neyrestan.
En 1572, un fait horrible, conséquence des guerres religieuses, se passa au château de Cologne. Mais pour l'intelligence de cet événement, nous devons remonter un peu plus haut.
C'est au mois de septembre 1569, que les protestants Tenus du Rouergue et du Quercy, prirent par surprise la ville d'Aurillac. Personne n'ignore les dévastations qu'ils y commirent, et les cruautés sanglantes qu'ils exercèrent contre les habitants. Ils y étaient depuis six mois, lorsqu'en 1570, le comte de Saint-Hérem, gouverneur de l'Auvergne, voulant reprendre cette ville, se ménagea des intelligences secrètes avec quelques citoyens influents. La trame fut découverte, et une foule de conjurés, dans le nombre desquels figuraient Vigier, Fraissy, Veyre, Fortet, Bobési, Capmas, etc., furent mis à mort. Un surcroît de tyrannie fut donc à l'ordre du jour. Il serait trop long de raconter ce tissu d'atrocités, d'autant plus qu'elles sont connues, et se trouvent consignées dans l'information faite contre Lamire, en octobre 1572.
Ce Lamire qui joua un grand rôle dans ces affaires, était conseiller du sénéchal de Toulouse, et envoyé en qualité de commissaire général, par les princes de Navarre et de Condé.
Cependant les huguenots furent contraints de quitter Aurillac en août 1570, lors de l'édit de pacification, connu sous le nom d'Edit de Longjumeau. Paralysés dans leur vengeance, les catholiques Aurillacois, se soumirent aux actes accomplis, et parurent avoir oublié tout ressentiment. Probablement même, le temps qui est si puissant, eût à la longue calmé l'irritation des partis, et amené une fusion toujours désirable après les discordes civiles. Mais par malheur, sur ces entrefaites, le tocsin de la Saint-Barthélemy vint à sonner.
Un marchand nommé Pierre Moles, en apporta la nouvelle à Aurillac. Au dire de plusieurs historiens, des ordres de massacrer les protestants, avaient été immédiatement transmis à tous les gouverneurs provinciaux Quelques-uns cependant crurent devoir refuser le concours meurtrier qu'on exigeait d'eux. Saint-Hérem, assure-t-on, fut de ce nombre. Je ne sais si le fait est exact, ou si ses instructions clémentes furent dépassées ici. Ce qu'il y a de positif, c'est que le 5 septembre 1572, sur les conseils de Moles, les officiers du roi firent précipitamment fermer les portes de la ville, et on emprisonna dans les salles-basses de l'hôtel Malras (aujourd'hui palais de justice et maison Geneste), quatre-vingts protestants qui n'avaient pu s'enfuir. Ce qui n'est encore que trop réel, c'est que la nuit suivante, soixante-huit d'entre eux furent impitoyablement égorgés.
Douze restaient. Je ne sais pourquoi, le lendemain, un mandement des consuls ordonna de les transférer au château de Cologne. Peut-être la tuerie de la veille, avait-elle produit une sensation si affreuse, qu'on ne voulut pas la renouveler. Ou plutôt peut-être, espéra-t on qu'en entraînant ces malheureux hors des murs et en leur accordant un sursis, ils se décideraient à abjurer. Ce qui donne quelque vraisemblance a cette dernière supposition, c'est que les prisonniers furent accompagnés dans leur voyage, par un cordelier et deux prêtres de la communauté. Tant il y a, qu'ils restèrent cinq jours enfermés à Cologne. Que se passa-t-il pendant ce temps? On ne sait. Mais le 11 septembre au matin, les douze condamnés reçurent l'ordre de monter sur une terrasse qui se trouvait dans la partie la plus élevée des fortifications, et là ils apprirent qu'on allait les exécuter à coups d'arquebuse. Les huguenots, sans manifester aucun effroi, ayant demandé quelques instants pour recommander leur âme à Dieu, ce délai leur fut accordé. Il parait qu’'alors, tous se mirent à genoux, et calmes, chantèrent des cantiques. Cela dura un quart-d'heure. Puis, s'étant tus, ils attendirent. Le chef militaire profita de ce moment, pour faire à ses soldats, le signal convenu. A la première décharge, neuf des suppliciés tombèrent morts. Presque aussitôt, les trois autres, qui n'étaient que blessés, se relevèrent, et fous de terreur, ils enjambèrent le parapet du mur, et se jetèrent en bas. Les deux premiers étant tombés d'une grande hauteur, sur un sol pierreux, ne bougèrent plus. Le dernier trouva sous lui une flaque de boue détrempée qui amortit sa chute, et il put sortir du fossé. L'instant d'après, on le vit courir du côté de la rivière. Si le fuyard avait eu la pensée de se retourner vers le château, ce coup d'œil l'eût sauvé sans doute, car s'apercevant que personne ne le poursuivait, il aurait probablement choisi une direction moins dangereuse. Mais dans son trouble, le huguenot voulut franchir l'eau, et ses forces l'ayant abandonné, il se noya.
Le soir même, on trouva son cadavre arrêté entre deux racines d'arbres.
L'on voit par ce qui précède, que les guerres civiles offrent cela de hideux, qu'elles atrophient le cœur. L'homme alors, n'ayant plus ni sensibilité ni sens moral, se change en bête carnassière, et de tous ses instincts, ne garde que les mauvais!
Continuons l'histoire du fief de Cologne.
En 1588, par un étrange retour des choses d'ici-bas, les chances de la guerre avaient mis ce même château, aux mains des calvinistes. Ceux-ci s'y établirent fortement, et à partir de cette époque, il servit de repaire à des partisans armés qui rançonnaient les habitants des environs, autorisés disaient-ils à piller, par le motif que les tenanciers ne payaient plus les droits seigneuriaux. Leurs déprédations devinrent si excessives, que l'année suivante (1589), le sire de Missjlha fit le siége du manoir, et s'en empara. Edme de Lignerac rentra donc dans le domaine de ses aïeux, et tenait ce fief en 1610. Cinq ans après, Annet de Plats, seigneur de Curemonte, gentilhomme de la chambre du roi, et mari de Jeanne de Lignerac, acquit le château de Cologne, avec le moulin, les terres, les rentes en dépendant, et les ruines du fort de Neyrestan, moyennant la somme de 49,000 livres (1). En 1674, Cologne fut revendu par noble Joseph de Plats aux jésuites du collége d'Aurillac, et resta la propriété de cet établissement d'instruction, jusqu'à la révolution. Possédé depuis par la famille Pontanier, il appartient à M, l'abbé Bénech, ancien curé de la Martinique.
Sédeyrac.
— Agréable campagne, sur la route de Tulle. — Patrice de Montal de Cruèghe, fils de Pons, était seigneur de Sédeyrac en 1625. En 1668, Raymond Cipière, avocat d'Aurillac, le tenait en franc fief dépendant du comte de Carladès, et lui en rendit hommage à cette époque. Peu après, Joseph Daguzon fut propriétaire de la terre, dont sa descendance jouissait encore vers 1745. Cet immeuble important passa ensuite aux mains des prêtres de la communauté d'Aurillac, et devint le patrimoine de l'église paroissiale de Notre-Dame-aux-Neiges. Sédeyrac acquis plus tard, de la famille Lintilhac, par M. Besse père, conseiller de préfecture, est actuellement la propriété de ses héritiers.
Le Claux.
— Le Claux est une belle maison moderne, construite sur l'emplacement d'un vieux château, disparu aujourd'hui, comme l'ancienne famille dont il portait le nom. Bernard de Claux possédait ce domaine, dès le milieu du XIII° siècle. Géraud de Veyre, bourgeois d'Aurillac, un des auteurs de cette vaillante lignée qui défendit si courageusement notre ville en 1581, devint seigneur du Claux, au commencement de 1506. Ce ne fut que longtemps après que le fief fut vendu par Charles de Veyre, et nous le trouvons en 1779, la possession de Gabriel de Vigier d'Orcet, receveur des tailles de Mauriac et de Saint-Flour, auquel Marie Delsol de Volpilhac, l'avait porté en dot. Celle-ci, ayant épousé en secondes noces, M. Grasset, ancien officier, le domaine du Claux devint, par donation contractuelle, la propriété de ce dernier, qui l'a laissé à ses deux fils.
Cette habitation, l'une des plus remarquables du pays, mérite d'être visitée, tant pour l'aspect de son site superbe, qu'à cause de quelques peintures curieuses que l'on y conserve soigneusement. MM. Grasset, cultivant les arts, font avec bienveillance, les honneurs de leur charmant musée. Parmi les tableaux , j'ai remarqué deux paysages, que l'on pourrait attribuer à Rosa de Tivoli, car ils ont sa manière; — et une espèce de fête, appartenant évidemment à l'école de Van-der-Meulen. Une toile, représentant la mort de Pyrame et Thisbé, m'a paru digne d'intérêt. Mais le morceau capital par excellence, est le portrait d'une béguine vieille et ridée, dont la figure semble pétrie dans lo clair-obscur. C'est une peinture crue, mais rayonnante d'effet, et d'un magnifique sentiment réaliste. On doit donner ce cadre à Ribéra, grand peintre, qui, à une époque où l'idéal n'existait plus, sut retrouver dans l'énergique reproduction des formes, et dans la témérité du pinceau, une nouvelle poésie avec un nouvel art.
COUTUMES JUDICIAIRES.
On peut dire en thèse générale, qu'après l'invasion germaine, chaque fraction de race eut sa loi propre. Selon que cette race était franque, bourguignonne ou visigothe, elle eut sa règle visigothe, bourguignonne ou salique. La législation alors n'était point inhérente au territoire, mais tenait à la personne, car chacun à son gré choisissait sa loi. Cela dura jusqu'au X° siècle ; au tout était changé. Le régime féodal ayant parqué les serfs dans les domaines ruraux, la loi forcément devint territoriale. Telle est l'origine des coutumes : elles provinrent de l'immobilisation du paysan à la glèbe, et chaque localité formant un petit Etat, posséda les siennes. Bien que dans ce travail de formation, l'élément romain prédominât, il est évident cependant que la législation gauloise dut laisser sa forte trace, et la législation germanique apporter ses principes nouveaux. — Ainsi la communauté vient des Celtes. Chez les Gaulois, la femme n'avait pas consenti à être simplement l'esclave de l'homme, elle s'était élevée à la dignité d'épouse, de compagne, d'égale. Ce que les Gaulois avaient fait pour la personne de la femme, la jurisprudence latine le fit pour ses biens, qu'elle voulut protéger contre tous périls : c'est donc au droit romain qu'on doit le régime dotal. Il faut attribuer aux Bourguignons tout ce qui touche aux successions, et resserre les liens de la famille. Quant aux épreuves Judiciaires, au duel légal, ces procédures d'une barbarie sans alliage, sentent la chair vive du Germain.
La Haute-Auvergne était régie simultanément par le droit écrit et le droit coutumier. C'est là une singularité unique en France. Toutes les propriétés appartenant aux ecclésiastiques, ou celles des seigneurs qui relevaient d'eux, suivaient le droit écrit. La raison en est simple : d'un côté la loi latine était l'ancien droit du clergé, depuis Louis-le-Débonnaire; de l'autre, les prêtres saisissaient cette occasion de rester attachés à ce qui avait le plus de relation avec la cour de Rome. Au contraire, toutes les seigneuries des barons laïques, les fiefs de leurs vassaux et arrière-vassaux, étaient soumis au droit coutumier. Jusque-là il n'y a rien d'anormal. Mais plus tard, A la suite des donations, successions, transmissions ou mutations, il se fit un mélange on ne peut plus extraordinaire des biens, et par conséquent de la législation qui les suivait dans les diverses mains où ils passaient. Non seulement des localités contiguës ou voisines furent réglées par une loi différente, mais encore on vit des terres qui, les jours pairs, se trouvaient sous l'empire du droit écrit, et les jours impairs sous celui do la coutume. Jusqu'à des maisons, dont le premier étage eut une loi, et le second une autre. Ce sont encore ces mutations qui expliquent comment des fiefs d'église se trouvaient régis par la coutume, et des domaines laïques gouvernés par le droit romain. C'est que ceux-là avaient été donnés ou vendus par des seigneurs laïques, tandis que les derniers appartenaient primitivement à des membres du clergé.
Revenons aux coutumes. Il y en avait de deux espèces : celles qui étaient approuvées par le souverain et portaient le nom de lois, ou coutumes générales: — et celles qui n'étant point revêtues du sceau de l'autorité publique, prenaient la dénomination de coutumes particulières, ou usages locaux.
Avant le XVI° siècle, de nombreuses contestations que l'on ne pouvait souvent résoudre que par le difficile moyen des enquêtes par turbe, avaient fait sentir la nécessité de rédiger par écrit les coutumes de la France. Louis XII fit recueillir en 1510, celles de l'Auvergne. Cependant dans cette importante codification, n'entrèrent pas les coutumes locales, qui sont innombrables pour le haut-pays. Ces usages particuliers, remarquables par leur grand sens et leur saine raison, sont destinés a satisfaire une foule de besoins locaux, minimes peut-être par eux-mêmes, mais importants à cause de leur fréquence et de leurs retours multipliés. Les coutumes privées de la Haute-Auvergne tiennent généralement aux pâturages, terres, haies, aux mitoyennetés des murs, congés des maisons, et formes de procédure. En voici deux, qui m'ont toujours paru curieuses. L'une d'elles est la coutume du village de St-Clément, canton de Vic, qui porte: — « Au seigneur supérieur de l'héritage, appartient le terme étant entre deux héritages, tant que les pieds du seigneur de l'héritage se peuvent étendre, quand il est assis sur ledit terme, et le résidu appartient au seigneur de la propriété qui est au-dessous. » — Ainsi, selon que le seigneur supérieur avait les jambes plus ou moins longues, sa part dans le talus, était plus ou moins considérable. C'est déjà bizarre, mais ce qui l'était encore plus, c'est qu'à chaque génération ou à chaque vente de la seigneurie, la mesure, comme on le voit, était exposée à changer. Aujourd'hui, l'usage des lieux fixe définitivement à un mètre, ce toisage jadis si arbitraire.
L'autre coutume est celle de Vic, portant: — « La rivière de Cère ne tolle ni ne baille; c'est à savoir que quand elle prend d'aucunes possessions par inondation, ou autrement petit à petit, de çà ou de là de l'eau, est permis à icelui qui perd, suivre sa possession. » — Ainsi voilà un usage, chose rare ! qui rejette l'alluvion; le motif en est que la Cère, pleine de caprices et de méandres, n'a jamais eu de lit fixe.
La singularité de deux droits différents, vivant cote à côte, et régnant en frères sur une contrée qu'ils s'étaient partagée, a préoccupé les esprits sérieux. Une théorie récente et ingénieuse trouve la cause de ce fait, dans la position exceptionnelle de l'Auvergne, qui, placée au milieu de la France, participait aux deux législations, comme étant l'endroit où elles venaient se mêler et se fondre. Cela parait exact. On conçoit sans peine que le droit coutumier, robuste à l'est de la Gaule, s'affaiblissait au fur et à mesure qu'il s'éloignait de son point de départ, et dans sa marche absorbante usait son énergie. Le droit romain, au contraire, seul en possession du sud, y avait enfoncé de vigoureuses racines; de sorte que là où la tradition germanique épuisée, perdait ses forces, la loi latine vivace, trouvait toutes les siennes. Or, l'Auvergne, situation centrale, devint le lieu de jonction où les deux droits se rencontrèrent. Chacun d'eux prit alors sa place, vint jusqu'à la limite, se mit en contact avec l'autre, et la soudure se fit.
La coutume de Naucelles, applicable du reste à d'autres communes de l'arrondissement d'Aurillac, disait : — « Nul habitant ne peut tenir ez fraux (Du mot frui, jouir) communs, sinon le bétail qu'il peut hiverner des foins et pailles qu'il cueillit aux villages dont dépendent les pâturaux.
Ainsi donc, en règle générale, aucun tenancier du Naucelles ne pouvait estiver dans les pâturages communaux, plus de bestiaux qu'il n'en pouvait hiverner. Ce principe admis, la première condition pour jouir du pacage, était celle d'habitant, et la seconde, celle d'être propriétaire. L'une attribuait le droit, l'autre en déterminait l'objet et l'étendue.
En établissant cet usage, la coutume avait voulu que les tènements communaux ne fussent jamais chargés d'une plus grande quantité de bestiaux qu'ils n'en pouvaient nourrir. Il est certain, comme l'explique le commentateur, que si, dans une montagne de cinquante vaches, on en introduit cent, aucune ne s'y engraissera. Elles ne donneront pas de lait, ou en donneront moins; elles n'auront pas de veaux, ou bien la qualité en sera défectueuse.
Habituellement, dans les montagnes communes, on ne souffrait pas le mélange des vaches avec les brebis; parce que les brebis broutent l'herbe plus près de sa racine, que les bêtes à cornes.
Bien que ceux qui no recueillaient pas de fourrages, n'eussent point droit, pour leurs bestiaux, aux pacages communs, cependant la tolérance antique admettait une exception en faveur des pauvres. Aussi chaque ménage indigent avait le privilège d'introduire dans les fraux, une chèvre, un porc, ou une certaine quantité de volailles à son choix, mais pour leur subsistance seulement, et non pour les vendre.
Enfin une dernière convention tacite voulait, qu'en matière de jouissances herbagères, l'été fut censé commencé au milieu de mai, et fini au 50 octobre de chaque année (5 mois Le reste du temps était considéré comme hiver (6 mois 1/2).
Cette coutume, dont une longue expérience a fait ressortir la sagesse, se trouve encore observée aujourd'hui.
TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES.
Différents objets antiques, tenant à la science de l'archéologie et de la numismatique , ont été découverts sur le territoire de la commune de Naucelles. Malheureusement, il en est un grand nombre qui ont disparu, et dont on n'a pas même conservé le souvenir. Je ne parlerai donc que de eux que nous possédons. En voici l'énumération chronologique:
1° — Amulette gauloise. — C'est un caillou de serpentine, en forme d'œuf de pigeon aplati, ayant quatre centimètres de longueur sur trois de largeur. Cette pierre verdâtre, est percée dans sa partie supérieure, par un trou destiné à recevoir un cordon, au moyen duquel on la portait suspendue. Sur l'un des côtés, se trouve grossièrement gravée la forme d'un soleil avec ses rayons; sur l'autre, on remarque un signe ressemblant à un râteau, mais qui n'est autre chose qu'une lettre celtique majuscule, telle qu'on en voit sur certaines médailles gauloises.
Les bergers gaulois se servaient de ce talisman, pour l'attacher au cou de leurs béliers, ce qui, dans leur croyance, préservait le troupeau de toute maladie. Dans le moyen âge au contraire, les paysannes le portaient sur la poitrine, les unes prétendant que cela rendait le lait aux nourrices; les autres, que cela guérissait des migraines; d'autres enfin pensaient que l'amulette avait la vertu d'éloigner le tonnerre. Cette rareté précieuse , fut trouvée enfouie sous le premier empire, dans la cour même du presbytère, par M. Conthe, alors desservant do Naucelles. Le curé l'échangea avec M. Grassal, libraire, contre une gravure de piété; et c'est de ce dernier que je l'ai eue en 1833.
2°— Petite médaille romaine en argent, exhumée en 1829, dans le grand communal du village, par un cultivateur qui travaillait a arracher des mottes de gazon. Elle porte au milieu du champ, la tête du jeune César (fils de Septime Sévère et frère de Caracalla), avec l'inscription : p. Septimius. Geta. Caes. — Au revers, l statue de Rome debout, et autour : Provid. Deobum. — Cette médaille remonte à l'an 211 ou 212, après Jésus-Christ.
3°, — Un denier d'argent auvergnat, trouvé depuis une douzaine d'années, dans le petit jardin qui est au pied de la tour. Cette pièce porte, au champ, la ville de Clermont en buste, la tête ornée de la couronne murale. Ou lit autour: s. Maria. — Au revers, se trouve une croix, avec la légende : Urbs. Arverna. — C'est probablement une des monnaies frappées à Clermont en 1095, lors de la prédication de la première croisade, par le pape Urbain II.
4°—Tiers de sol d'argent, trouvé en 1841, dans les fondations d'une maison du bourg. Le champ représente une tête d'évêque, vu de face, ayant la mitre en tête et l'étole au cou. Autour, l'inscription suivante : Petrus. Episcopus. — Le revers porte une croix avec double légende. D'abord : Ave Maria Gratia Plena. Puis, dans le cercle intérieur : Camera. Civ.
5° — Un écu d'or à l'agnelet, trouvé entre deux rochers, par M. Nozières père, de Gabre , et qu'il voulut bien me céder en 1842. On voit dans le champ, un agneau nimbé, la tête tournée vers une croix à banderoles, placée à ses cotés. A la base de la croix, on lit : Ioa. Bex. (Jean, roi). Et autour, la légende : Ag-Dei.
Qui. Toll. Peca. MUNDi MISEBERE. Nob. — Au revers, s'étale une grande croix ouvragée, entourée de fleurs de lys, avec l'inscription : Cb. (Christus) Régnat, Imperat. Vincit. — Cet écu, merveilleusement conservé; est du milieu du XIV° siècle.
6° — Poids, trouvé en 1836, dans une terre dépendant du village de Veyrières. — Il porte sur une des faces, l'écusson crossé et mitre de Charles-de St-Nectaire. abbé d'Aurillac (5 billettes en fuseaux), et autour, cette légende : Poix De Horilag. 1544. — De l'autre face, les armoiries d'Aurillac. Ce poids est curieux, comme application irrécusable d'un article de la seconde paix qui voulait que les poids dont on se servirait à l'avenir dans la ville, fussent poinçonnés en langue romane senhah), par Mgr l'abbé et les consuls. »
7° — Enfin un autre poids, trouvé dans un pâtural , non loin de la Réginie, portant d'un côte une tour, de l'autre un B. (Bouillon). C'était un poids appartenant a la principauté de La Tour, en Basse-Auvergne, laquelle avait été un apanage de la maison de Bouillon. — Il m'a été donné par M. le docteur Meynial, médecin de l'hospice des aliénés d'Aurillac.
LES VILLAGES ET HAMEAUX DE LA COMMUNE SONT:
1° L'Ardenne, hameau, près du bourg. 2° Le Bruel, hameau.
2° Cologne (voir ce que nous eu avons dit plus haut).
3° Colinette, village, au sud de Cologne.
4° Le Claux (voir plus haut).
6° La Croux, hameau.
7° Gabre, village, près de Reilhac.
8° Issart, hameau, sur l'ancienne route impériale.
9° Lombert, village, sur la hauteur.
10° Maison-Neuve, village, sur la route impériale, à la jonction de celle de Laroquebrou (les Quatre-Chemins).
11° Monlheli (voir plus haut).
12° Varet-Bas, moulin, qu'on appelle aussi Caumeil.
13° Varet-Haut, village.
14° Vaut exiles, village situé à mi-coteau, en avant du bourg.
15°Veyrières, village. Il relevait jadis du chapitre de St-Géraud d'Aurillac, et Begon de Veilhan, en sa qualité de camérier du monastère, était seigneur de Veyrières, en 1393.
16° Viers-Bas. hameau.
17° Viers-Haut, hameau.
18° La Vigne, hameau, peu éloigné du bourg.
Un dernier mot. La population actuelle de la commune est de 522 habitants; et la part affectée à Naucelles, fut de 2,350 livres, dans la répartition de la taille, en 1696.
En finissant cet article, trop long sans doute, je prie qu'on me pardonne une foule de détails dans lequels j'ai cru devoir entrer, et qu'on trouvera peut-être insignifiants ou oiseux. Mais ce n'est pas tout-à-fait ma faute, car la commune de Naucelles, ainsi qu'on a pu s'en apercevoir, est une des plus petites et des moins intéressantes du département.
Henri DURIF,
Juge de Paix.